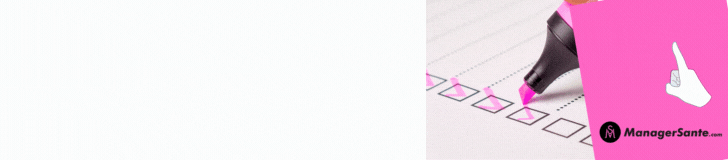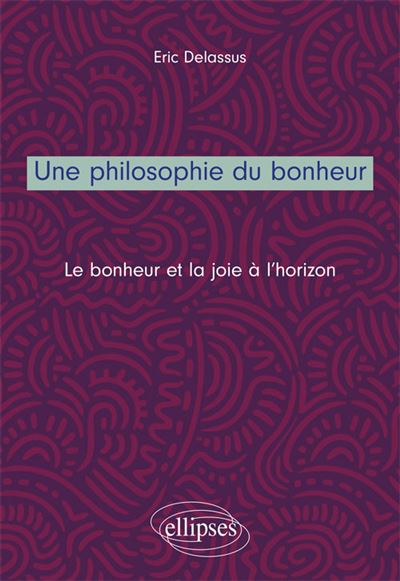N°74 Janvier 2024
Nouvel Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School).
Il est co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Octobre 2021 chez LEH Edition, sous la direction de Jean-Luc STANISLAS, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins
Intervention prononcée à l’ENS de Lyon pour le séminaire organisé dans le cadre du Collège Internationale de Philosophie par Julie Henry : Relire l’éthique en santé à l’aune d’une anthropologie spinoziste : Philosophie de l’âge classique et médecine d’aujourd’hui.
Relire la première partie de cet article.
Toute la question est donc de savoir si, malgré la maladie, malgré l’état de passivité dans lequel il se trouve, le malade est en mesure de reconquérir une certaine activité et de pouvoir continuer à vivre en homme libre.
Pour répondre à cette question, il apparaît essentiel de préciser à nouveau le sens de la notion de conatus ainsi que la nature de la distinction corps / esprit chez Spinoza.
Tout d’abord, si le conatus peut se définir comme l’effort de tout individu pour persévérer dans l’être, il convient de préciser que chez l’homme, il se manifeste sous la forme du désir qui est avant tout puissance d’agir. Autrement dit, il n’est pas simplement une tendance à perdurer indéfiniment, il est surtout une force qui cherche à produire des effets au-delà d’elle-même et qui par là même est en mesure de s’opposer aux effets néfastes que certaines causes externes peuvent exercer sur lui. Envisagé sous cet angle, il peut donc être considéré, comme le souligne d’ailleurs Laurent Bove dans son livre La stratégie du conatus comme une force de résistance, comme une puissance active qui en s’efforçant d’accroître sa puissance repousse et combat tout ce qui pourrait la diminuer :
…nulle chose n’a en soi rien qui puisse la détruire, autrement dit, qui supprime son existence ; mais au contraire, elle s’oppose à tout ce qui peut supprimer son existence, et par suite, autant qu’elle peut, et qu’il est en elle, elle s’efforce de persévérer dans son être [1].
C’est cette force d’opposition que Laurent Bove qualifie de force de résistance et c’est cette capacité à résister à des forces qui dépassent l’individu qui relève de la stratégie :
C’est tout d’abord de cette dynamique de la résistance active du conatus à un écrasement total par des forces extérieures plus puissantes que l’affirmation de l’existence se dit stratégie. À la racine de toute existence, il y a la résistance. Résistance et stratégie suivent nécessairement de l’essence même de chaque être existant comme il en « suit nécessairement ce qui sert à sa conservation » [2].
C’est pourquoi, encore plus que n’importe quel autre individu, l’homme malade doit mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour, quoi qu’il en soit, résister aux forces qui pourraient le détruire. Et s’il n’a pas la force de le faire seule, d’autres peuvent l’aider à concevoir et appliquer ces stratégies, ceux qui le soignent et affirment leur puissance d’être et d’agir par ce désir de se rendre utile à d’autres hommes. Il convient donc pour aider le malade à mieux affronter sa condition, afin qu’il la vive le moins mal possible et le plus activement possible, de faire en sorte qu’il ne se laisse pas totalement écraser par les causes externes qui s’exercent sur lui.
Il va donc falloir parfois ruser avec la maladie, l’assumer pour mieux la vaincre. C’est ici qu’intervient donc la notion d’acceptation, qui, tout en prenant acte de la maladie et en essayant d’en comprendre les causes, permet au malade de résister aux affects destructeurs, aux passions tristes qu’elle peut engendrer afin de conserver suffisamment de forces pour tenter de la vaincre.

L’acceptation : une stratégie à adopter face à la maladie ?
Parmi les attitudes les plus fréquentes face à la maladie, si l’on excepte le déni qui devient extrêmement difficile, voire impossible, lorsque les symptômes sont criants, il y en a principalement deux par lesquels le malade peut manifester son désarroi et sa détresse, la révolte et la résignation, et toute deux expriment et manifestent une certaine forme de passivité dans la mesure où elles résultent d’une certaine incompréhension de la situation à laquelle on se trouve confronté. C’est pourquoi l’acceptation peut apparaître comme la meilleure stratégie à adopter face à la maladie. En effet, une telle attitude ne va pas de soi, elle semble plutôt aller vers une approbation, alors qu’au contraire, la maladie, c’est ce que l’on refuse, ce contre quoi le malade veut lutter pour pouvoir continuer à s’affirmer comme puissance. C’est donc pour cette raison que l’acceptation peut, en un certain sens, relever de la stratégie, voire de la ruse avec la maladie. Mais, en réalité, il s’agit de la seule attitude possible, celle qui consiste à comprendre pour rester actif et ne pas se laisser écraser par la fortune. De même que nous n’avons aucun intérêt à rire des hommes ou à les blâmer pour tenter de penser une cité dans laquelle régnerait la concorde, nous n’avons rien à gagner à nous désoler d’être malade si nous voulons regagner la santé. Il nous faut d’abord essayer de comprendre, autant les motifs qui poussent les hommes à se conduire de la manière la plus déraisonnable qui soit, que les raisons qui peuvent expliquer la maladie. Il n’y a pas de différence fondamentale entre les deux phénomènes, les comportements humains parce que l’homme n’est pas dans la nature « comme un empire dans un empire » sont, au même titre que les maladies, les conséquences de causes naturelles par lesquelles s’exprime la puissance de Dieu ou de la Nature.
Accepter, en effet, ce n’est pas se résigner [3], ce n’est pas subir passivement un effet dont on ne comprend pas la cause. Accepter, c’est adhérer au réel dont on a compris la nécessité, ce qui ne signifie pas que pour autant l’on s’y soumet. Accepter la maladie, ce n’est pas s’installer en elle, s’y complaire, ce qui serait la manifestation d’une certaine impuissance et aussi d’une certaine incompréhension de la maladie. Accepter la maladie, c’est tout d’abord comprendre que la maladie est un phénomène naturel contre lequel on ne peut agir qu’en recourant à des causes elles-mêmes naturelles, c’est donc en même temps être disposé à résister aux effets qu’elle peut produire sur nous. Il reste cependant à préciser de quelle manière elle peut être comprise et sous quelle forme elle doit l’être pour permettre effectivement au malade d’affronter sa condition en faisant preuve d’une réelle force d’âme.
Accepter signifie d’abord comprendre, il reste cependant à déterminer de quelle manière il est souhaitable de comprendre la maladie pour mieux l’accepter. Les lecteurs de L’Ethique ou du Traité de la réforme de l’entendement le savent, Spinoza distingue trois genres de perception ou trois modes de connaissance.
Le premier genre de connaissance désigne la connaissance imaginative que nous acquérons par ouï-dire ou par expérience vague et qui génère nos opinions. Il s’agit principalement de la perception des effets résultant des affections que nous subissons de l’extérieur.
Le second genre de connaissance désigne la connaissance démonstrative, il s’agit d’une connaissance qui porte sur le général, de la connaissance scientifique, c’est-à-dire d’une connaissance qui, bien que vraie, reste encore très abstraite.
Le troisième genre de connaissance désigne, quant à lui, la forme de connaissance la plus accomplie puisqu’il désigne la connaissance intuitive, c’est-à-dire la perception immédiate des liens qui unissent les choses singulières à la nature tout entière, c’est-à-dire à Dieu tel que l’entend Spinoza.
Le terme d’intuition ne doit donc pas être compris ici dans son acception commune et ordinaire qui renvoie à un pressentiment dont la cause nous échappe, à une perception des choses dont l’origine serait incertaine et mystérieuse. Par intuition, il faut entendre ici une perception certaine et immédiate du vrai par l’esprit qui, en tant qu’il exprime la puissance même de Dieu, en tant qu’il est une manière d’être de la substance, se perçoit comme tel et parvient ainsi au souverain bien tel qu’il est défini par Spinoza dans le Traité de la réforme de T entendement, c’est-à-dire « connaissance qu’à l’esprit de son union à la nature tout entière ».
Dans la mesure où l’esprit est « idée du corps », la connaissance du troisième genre est celle par laquelle toute idée se sait pleinement idée du corps et se perçoit comme la pensée des liens qui nous unissent à la nature tout entière. Elle est perception immédiate de cette idée vraie que nous avons, comme cela est écrit dans le Traité de la réforme de l’entendement et qui est la perception que l’esprit a de lui-même comme idée du corps et de toute idée qui est en lui comme idée du corps. C’est donc la perception des choses singulières comme expression de la puissance du Dieu-Nature au travers de l’idée du corps qui caractérise la connaissance du troisième genre et qui explique que, comme l’écrit Spinoza dans la Proposition XXIV d’Ethique V :
Plus nous comprenons les choses singulières plus nous comprenons Dieu.
Il peut sembler étrange d’affirmer que toute idée est idée du corps, surtout lorsqu’il s’agit d’idées qui peuvent paraître très abstraites, mais dire que toute idée est idée du corps, ce n’est pas dire que toute idée est idée d’un corps, le plus souvent elle est idée des rapports que les corps entretiennent les uns avec les autres. Ainsi, par exemple, l’idée de justice n’est pas l’idée d’un corps, elle n’a pas pour objet une chose matérielle, elle est cependant idée du corps dans la mesure où elle est l’idée des rapports qu’un corps peut entretenir avec d’autres corps pour former de manière durable un corps plus grand, qui n’est autre que la société, c’est-à- dire ce que l’on peut également appeler le corps social. Et, c’est au travers de la perception que chacun a de son corps dans son union avec Dieu qu’il pense cette idée. Spinoza résume d’ailleurs cela très clairement dans la lettre LXIV à Schuller du 29 juillet 1675 lorsqu’il écrit :
Le pouvoir de connaître appartenant à l’esprit ne s’étend donc qu’à ce que cette idée du corps contient en elle-même.
Aussi, dans la mesure où toute idée est idée du corps, il est permis de penser que c’est en construisant une idée cohérente du corps que l’on est en mesure de mieux accepter une affection comme la maladie. La maladie, qui n’est jamais qu’une manière d’être uni à la nature, même si cette manière ne nous convient pas. Accepter, non pour approuver, mais pour résister.

Comprendre et avoir conscience du caractère naturel de la maladie.
Il convient donc désormais de s’interroger sur le mode de connaissance le mieux adapté pour permettre cette acceptation, en n’oubliant pas qu’il faut prendre en considération le fait que tous les malades ne sont pas des philosophes et qu’il importe de rendre accessible une certaine compréhension de sa condition, même à l’ignorant. Cela nécessite donc la mise en œuvre d’une stratégie afin de rendre possible la résistance aux causes externes qui peuvent venir nous détruire ou diminuer notre puissance.
Ce qui rend le plus souvent difficile l’acceptation de la maladie, c’est que nous la percevons tout d’abord selon le premier genre de connaissance, c’est-à-dire par ouï-dire ou par expérience vague. Ainsi, celui à qui l’on annonce une maladie grave, alors qu’il n’en ressent pas encore les symptômes peut être gagné par l’angoisse ou l’effroi parce qu’il imagine qu’il devra subir tout ce qu’il a entendu au sujet de cette maladie (les malades qui se renseignent sur internet). Il pourra aussi se référer à l’expérience qu’il a pu avoir de cette maladie si elle a touché l’un de ses semblables.
S’il ressent les symptômes de la maladie, il percevra également la maladie par expérience vague, c’est-à-dire qu’il en percevra les effets sans en connaître les causes, il percevra la manière dont son corps est affecté et ressentira un certain nombre d’affects qui seront les corrélats de ces affections, mais qui se trouveront souvent augmentés par son ignorance des causes de sa maladie. C’est pourquoi, la souffrance étant souvent liée, dans la plupart des cultures, à l’idée de punition, la maladie sera souvent vécue comme une injustice, une malédiction, voire une punition si le malade souffre pour une quelconque raison d’un fort sentiment de culpabilité. Ainsi perçue, la maladie donne le plus souvent lieu à un accroissement de souffrance provenant de ce que le malade cherche désespérément à donner du sens à sa maladie. Or, comme l’expose Spinoza dans l’appendice à la première partie de l’Ethique, rien dans la nature n’a de sens, rien n’est déterminé par des causes finales, il n’y a que des causes efficientes et antécédentes dans la nature et cela vaut pour la maladie qui n’est qu’un phénomène naturel comme un autre. Aussi, la tendance actuelle à vouloir donner du sens à tout, n’est-elle pas nécessairement la meilleure voie qui soit pour accepter la maladie afin de mieux lui résister.
Le meilleur moyen d’accepter la maladie, c’est certainement de comprendre qu’en elle- même, elle n’a pas de sens, ou que son seul sens, c’est d’être un phénomène naturel comme un autre produit par des causes efficientes. Accepter la maladie suppose donc tout d’abord, sinon que l’on perçoive ces causes précisément, au moins que l’on ait conscience de ce caractère simplement naturelle de la maladie.
On pourrait donc en conclure que le meilleur moyen d’accepter la maladie, c’est de la comprendre selon le second genre de connaissance, c’est-à-dire, pour parler simplement, selon le mode de la connaissance de type scientifique.
Cependant, l’expérience nous montre qu’il n’en est rien et que ce genre de connaissance n’a pas la puissance d’apaiser les passions tristes que peut engendrer la conscience d’être malade. Si c’était le cas, en effet, la plupart des médecins seraient en mesure d’accepter la maladie avec sérénité quand ils en sont victimes. Or, il n’en est rien et le plus souvent la connaissance qui est la leur des risques qu’ils encourent ne fait qu’augmenter leurs craintes et intensifier leurs angoisses. Ainsi, cette connaissance, bien que rationnelle ne rend pas le malade plus actif, voire augmente sa passivité en accroissant sa tristesse. La raison en est que cette connaissance est beaucoup trop abstraite en générale et que les affects qui lui sont liés ne concernent pas l’individu dans sa singularité. En tant que connaissance, elle peut procurer à celui qui l’acquiert et la maîtrise une joie intellectuelle, comme peut le faire n’importe quelle autre science, mais elle ne modifie pas l’individu dans sa singularité. À moins que celui qui possède cette connaissance générale lorsqu’il l’applique à lui-même en tant qu’individu singulier le fasse de telle sorte qu’elle est alors perçue dans le registre de la connaissance du premier genre, c’est-à-dire comme s’il s’agissait d’une connaissance par ouï-dire ou par expérience vague. Tel médecin se souvient d’un cas que lui a décrit un confrère et dont l’issue fut malheureuse, tel autre se souvient d’un de ses patients atteint de la même pathologie et qu’il n’est pas parvenu à traiter. Ou pire encore ! La connaissance rationnelle des conséquences possibles d’une maladie interprétée sous l’emprise des passions tristes accroit plus celles-ci qu’elle ne les apaise.
Pour aller plus loin :
[1] Spinoza, Éthique, troisième partie, démonstration de la proposition VI, Op. cit., p. 217.
[2] Laurent Bove, La stratégie du conatus, Vrin, Paris, 1996, p. 14.
[3] Lire à ce sujet mon article : « Sagesse et résignation », La précarité de la vie – Sagesse de l’homme vulnérable, volume I, L’Harmattan, Paris, 2014, p. 13-23.
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS, Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de ManagerSante.com
Biographie de l'auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il a publié plusieurs ouvrages :
– le 25 Septembre 2018 intitulé ” Ce que peut un corps”, aux Editions l’Harmattan.
– un ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un dernier ouvrage, sous la Direction de Jean-Luc STANISLAS, publié le 04 Octobre 2021 chez LEH Edition, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins.
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019