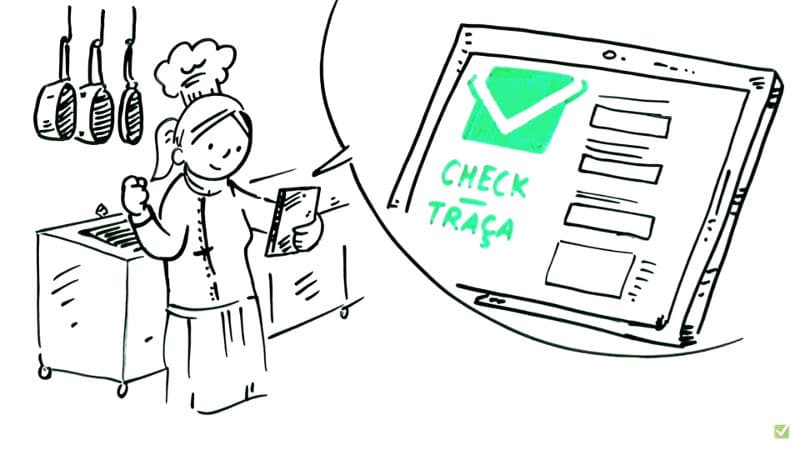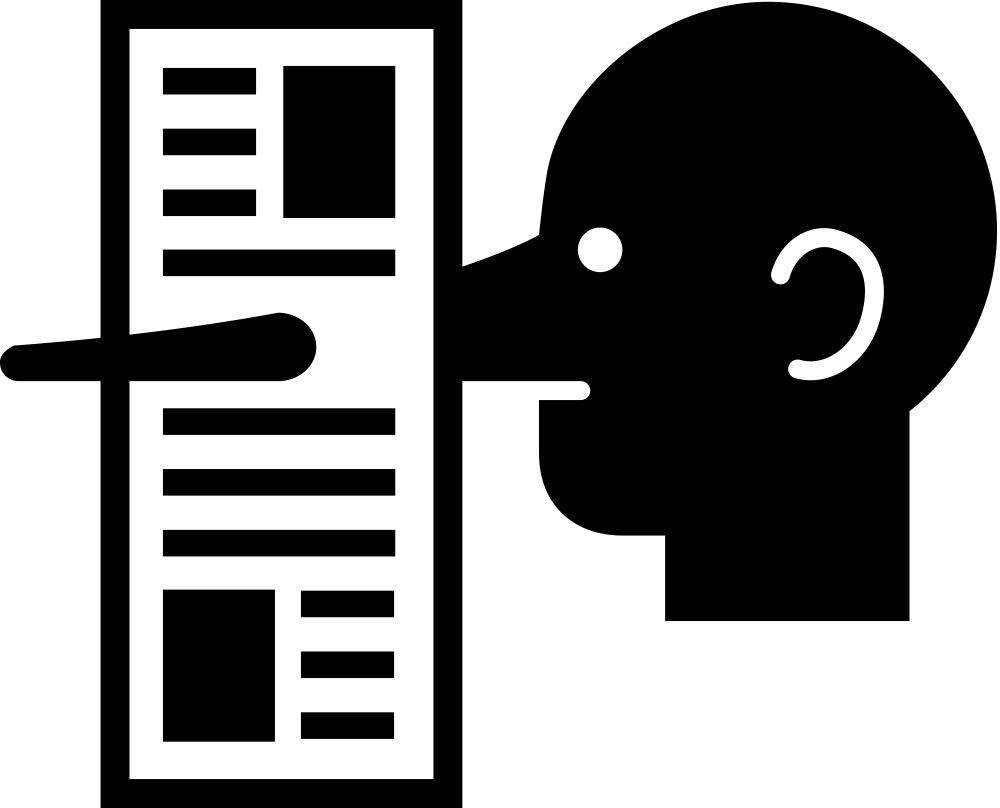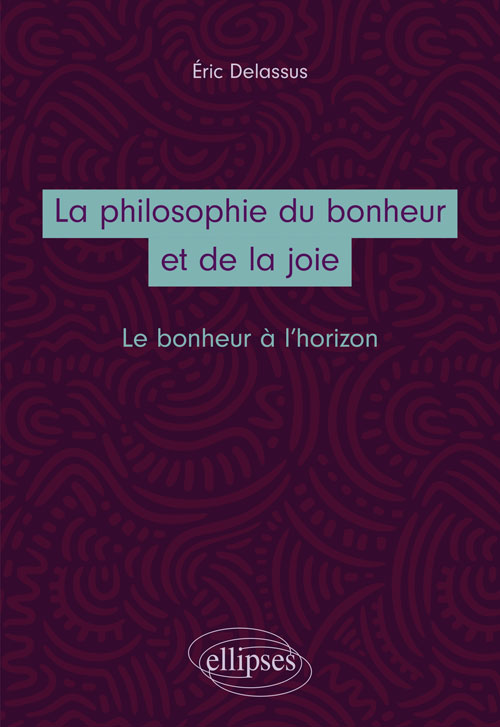N°23, Avril 2019
Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School), dans le cadre d’une conférence donnée au Centre Hospitalier Théophile Roussel, le 13 Septembre 2018
Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est publié en Avril 2019, portant le titre suivant : « La philosophie du bonheur et de la joie : le bonheur à l’hôrizon« , aux Editions Ellipses
Relire la 2ème partie de cet article
N’y a-t-il pas finalement quelque chose de mortifère dans cette tendance à vouloir tout consigner par écrit ?
À vouloir substituer à la parole vivante et pleine de la chaleur de l’amour ou de la haine, de la joie ou de la tristesse, du bonheur ou de la colère, la froideur d’un discours écrit qui est, de plus, généralement formaté et normé administrativement de telle sorte que rien ne puisse transpirer en lui de ce qui émane de la subjectivité de son rédacteur, la vie se trouve comme étouffée. C’est d’ailleurs ce que fait remarquer Walter J. Ong lorsqu’il souligne le lien qui unit l’écriture et la mort :
L’un des paradoxes les plus surprenant de l’écriture est son association étroite avec la mort. Platon suggère cette association lorsqu’il dénonce l’écriture comme une simple chose destructrice de mémoire, totalement inhumaine. Elle est aussi largement manifeste dans d’innombrables références à l’écriture (et/ou à l’imprimé) que l’on peut retrouver dans les dictionnaires imprimés de citations, depuis II Corinthiens III, 6 (« la lettre tue l’esprit, l’esprit vivifie ») et Horace qualifiant ses Odes de « monument » (Odes III.30.1), annonçant sa propre mort, jusqu’à Henry Vaughan assurant à Sir Thjomas Bodley que dans la bibliothèque Bodléienne d’Oxford, « chaque livre est une épitaphe » et même au-delà[1].
Qu’apporte l’usage de la « parole » en complément de l’écrit dans les relations professionnelles ?
Dans la parole, il y a une part de spontanéité qui laisse s’exprimer aussi bien la conscience que l’inconscient, nous parlons tout autant que la parole parle en nous. Probablement, d’ailleurs, est-ce plus la parole qui parle en nous ou qui parle de nous, que nous qui parlons, mais c’est précisément qui en fait toute la dimension vivante et imprévisible. Dimension que l’écrit tend à gommer et parfois même à étouffer. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai la vertu thérapeutique de la parole, vous en savez certainement beaucoup plus que moi sur la question. Il n’y a d’ailleurs pas que l’approche psychanalytique qui suppose cette propriété qu’aurait la parole d’être son propre sujet et de ne pas réduire la parole à l’action du sujet humain qui l’utiliserait comme un simple moyen, comme un média, dirait-on aujourd’hui. Ainsi, Heidegger écrit-il dans un texte intitulé « la parole » et repris dans un livre ayant pour titre Acheminement vers la parole :
La parole est parlante. Cela veut dire aussi et d’abord : la parole parle. La parole ? Et non l’homme ?
Que faut-il entendre par là ? Heidegger ne nie pas que l’homme parle, mais ce qu’il laisse ici entendre, c’est que le sujet du discours est d’abord dans la parole qui n’obéit pas nécessairement à la seule volonté du locuteur. La parole, en tant qu’action par laquelle un locuteur s’exprime à partir d’un système de signes bien précis n’est certainement pas apparue en obéissant à une intention consciente et réfléchie et les langues, même si elles sont conventionnelles, n’ont pas été intentionnellement construites de toute pièce par ceux qui les parlent. Les langues se sont construites et se construisent d’elles-mêmes par l’usage qu’en font ceux qui les parlent. C’est pourquoi les règles syntaxiques ne précédent pas la langue, mais se dégagent progressivement de son usage.
Si l’homme parle, cela ne signifie pas qu’il utilise la parole comme un moyen lui permettant de dire ce qu’il a à dire, si l’homme parle, c’est principalement parce qu’il est habité par la parole, constitué par la parole. Il est plus d’ailleurs constitué par la parole que constituant de cette parole. Il n’est donc pas sujet de la parole, au sens où il lui serait logiquement, voire chronologiquement antérieur, mais ils se constitue comme sujet grâce à la parole qui s’est constituée en lui. Heidegger écrit d’ailleurs das le même ouvrage :
On dit que l’homme possède la parole par nature. L’enseignement traditionnel veut que l’homme soit, à la différence de la plante et de la bête, le vivant capable de parole. Cette affirmation ne signifie pas seulement qu’à côté d’autres facultés, l’homme possède aussi celle de parler. Elle veut dire que c’est bien la parole qui rend l’homme capable d’être le vivant qu’il est en tant qu’homme. L’homme est homme en tant qu’il est celui qui parle.
Et c’est bien de la parole qu’il est ici question et non de l’Écrit. Certes, l’écrit a des vertus, et ce n’est pas moi qui passe une bonne partie de ma vie à écrire ou à lire des livres et des articles qui dirait le contraire. Néanmoins, ce qu’il importe de souligner ici, c’est l’ambivalence du langage, tant sous sa forme orale qu’écrite.
Le discours oral et écrit constituent-t-ils l’expression sincère de la personne qui s’y emploie ?
Une légende veut qu’un beau jour le poète Ésope – celui qui est considéré comme l’inventeur de la fable et qui inspira Jean de La Fontaine – qui était un esclave, fut convoqué par son maître qui lui demanda quelle était la meilleure des choses et d’en faire l’éloge. Ésope se plia à l’exercice et déclara que la meilleure des choses était la langue, car elle permet de louer les dieux, d’exprimer sa pensée et de formuler des serments. Satisfait du discours composé par son esclave, le maître lui demanda le jour suivant de présenter la pire des choses et Ésope expliqua qu’il s’agissait également de la langue. Pourquoi ? Parce qu’elle permet le mensonge, le parjure, la tromperie. Cela semble-t-il vaut autant pour sa forme orale que pour sa forme écrite.
Si l’expression orale permet, comme le démontre Platon, par la bouche de Socrate, dans le Phèdre, de laisser s’exprimer une pensée vivante, principalement lorsque cette pensée se construit dans et par le dialogue, elle est aussi ce qui rend possible la sophistique, c’est-à-dire usage trompeur des mots de la parole. De même, si l’écriture présente de nombreuses vertus, entre autres celle de permettre une construction plus rigoureuse de la pensée et une structuration plus cohérente des idées, elle peut aussi avoir pour conséquence la perte de vie du discours. Toute la question est donc de savoir comment procéder pour que l’écriture et la parole parviennent à s’articuler sans que l’une se développe aux dépens de l’autre.
Pour atteindre ce but, il est nécessaire que la parole et l’écriture puisse fonctionner ensemble, de la même manière que le recto et le verso d’une même feuille de papier, en considérant la parole comme le recto, c’est-à-dire ce avec quoi on entre en relation en premier et qui donne son sens à l’autre face de la feuille, car comme cela a été précisé plus haut, l’oralité est la condition même de l’existence de l’écrit. Aussi, à trop séparer les données écrites et les échanges oraux, risque-t-on d’accroître notre vulnérabilité en la niant.
Comment l’écrit et l’oral s’articulent-t-ils dans les relations de travail, notamment à l’hôpital ?
En effet, l’un des paradigmes que nous devons aujourd’hui intégrer de plus en plus dans le fonctionnement des organisations est celui de la vulnérabilité en opposition à l’autonomie. En effet, le modèle selon lequel beaucoup d’organisations fonctionnent encore aujourd’hui est celui fondé sur la relation contractuelle entre des individus jugés autonome.
Or, l’expérience montre que cette prétendue autonomie individuelle reste en grande partie une abstraction, c’est-à-dire une conception de l’être humain totalement séparée, disjointe des conditions réelles dans lesquelles se tisse les relations humaines. Aussi, à cette conception de l’être humain perçu et traité comme un individu autonome, je préfère substituer l’idée de personne vulnérable.
La vulnérabilité ne se réduisant pas ici à la fragilité, mais se définissant principalement par la dépendance. Ainsi, prise en ce sens, n’y a-t-il pas que les personnes fragiles qui soient vulnérables : le nouveau-né, la personne âgée, la personne en situation de précarité ou de handicap, la personne malade. Si l’on définit la vulnérabilité par la dépendance, nous sommes tous vulnérables, car, tout simplement, nous avons tous besoin les uns des autres.
Ainsi, un établissement de santé n’est pas une organisation constituée de personnes autonomes devant s’occuper et prendre soin de personne vulnérables, ce sont des personnes vulnérables accompagnant d’autres personnes vulnérables. Certes, il y a différents types de vulnérabilité. Peut-être y a-t-il des degrés dans la vulnérabilité ? Cependant, personne ne peut se dire invulnérable, car personne ne peut prétendre ne dépendre de personne.
Doit-on entretenir le lien social « parlé », au delà de la « traçabilité » écrite de nos actes professionnels ?
Il me semble qu’à trop vouloir demander aux acteurs d’une organisation de consigner le plus possible de données pas écrit, on risque fort de rompre les liens qui constituent cette vulnérabilité. D’autant que, comme cela a été précisé, plus haut la transmission des données écrites ne se fait plus de mains en mains, mais par l’intermédiaire de réseaux informatiques qui escamotent le contact et la rencontre effective entre les personnes.
Mais rompre les liens, ce n’est pas supprimer la vulnérabilité, bien au contraire, ce n’est pas parce que les liens sont rompus que nous n’avons plus besoin les uns des autres, bien au contraire.
Par la rupture, ou en tout cas l’appauvrissement de ces liens, la nécessité de la relation devient d’autant plus criante et engendre un sentiment de solitude qui ne fait qu’accroître la vulnérabilité, la rendant d’autant plus difficile à assumer que les occasions d’échanger avec les autres se trouvent limitées. C’est lorsque de telles ruptures se produisent que la vulnérabilité se transforme en fragilité, voire en impuissance. Car la vulnérabilité n’est en rien un signe d’impuissance, elle est même une source de puissance – en prenant ce terme au sens de capacité d’agir, voire au sens de capabilité comme l’entendent l’économiste Amartya Sen ou la philosophe Martha Nussbaum – lorsqu’elle est assumée et que la relation à l’autre est vécue comme l’occasion d’un enrichissement, comme interaction par laquelle la puissance d’agir de chacun augmente.
Il est donc indispensable pour cela que les échanges ne se fassent pas uniquement par écrit, mais qu’ils donnent lieu également à des échanges oraux, à des rencontres au cours desquelles la parole est à l’œuvre. Une parole qui s’exprime dans le dialogue et la confrontation, une parole à partir de laquelle peuvent aussi se manifester les conflits et les oppositions, car l’inflation de l’écrit risque également d’étouffer les conflits, de les empêcher, ce qui, comme chacun sait, ne contribue jamais à les résoudre. Il est souvent préférable que le conflit éclate, qu’il se manifeste parfois par des éclats de voix, pour qu’il puisse être identifié et reconnu et que l’on puisse ensuite faire le nécessaire pour tenter de le résoudre.
Doit-on finalement reconsidérer « l’oralité secondaire » pour retrouver le juste équilibre entre l’écrit et la parole au travail ?
Aussi, faut-il certainement recourir à l’écriture pour communiquer à l’intérieur des équipes un certain nombre d’informations, pour laisser une trace de certains événements et décrire des situations, mais ce qui importe ensuite, c’est d’en parler. Il importe donc de faire en sorte que le temps consacré à la relation par écrit de ce qui intervient dans la vie au travail ne viennent pas occuper la totalité du temps consacré au dialogue et à la communication.
Il est donc indispensable de réserver dans le temps de travail des moments de rencontre durant lesquels ce qui a pu faire l’objet de rapport écrit, ce qui est consigné dans des dossiers, puisse donner lieu à une parole vivante et animée. Il nous faut pour cela nous inscrire dans ce que Walter J. Ong nomme l’oralité secondaire, c’est-à-dire une oralité qui suppose l’écrit et se constitue par rapport à lui.
- L’oralité primaire concerne les peuples qui ne connaissent pas l’écriture est qui sont spontanément tournés vers l’extérieur et animés par un fort sentiment du collectif. Ne connaissant pas l’écriture, et par conséquent la lecture, ils ne sont pas animés par cette tendance à se retourner vers son intériorité et à se couper du monde et des autres pour se plonger dans un discours qui a été retranscrit sur un support matériel.
- L’oralité secondaire présente de nombreux caractères communs avec l’oralité primaire, mais s’en différencie dans la mesure où elle est un retour vers l’oralité après un passage par l’écrit, après avoir vécu l’expérience de l’intériorité que supposent l’écriture et la lecture. Cette oralité s’avère donc plus consciente et volontaire et nourrit un sentiment du collectif plus élargi, dans la mesure où il s’étend au-delà de la seule communauté à laquelle on appartient, ce sentiment collectif et celui de l’appartenance au village planétaire dont parle Marshall McLuhann qui considère que le développement des médias de masse et des technologies de l’information et de la communication peuvent conduire à une remise en question de la suprématie de l’écrit. Cette oralité secondaire résulte donc d’un retour à l’oralité qui se présente comme alternative à l’écrit. Comme l’écrit Ong :
Contrairement aux membres d’une culture orale primaire qui sont tournés vers l’extérieur parce qu’ils n’ont guère eu l’occasion de se tourner vers l’intérieur, nous sommes tournés vers l’extérieur justement parce que nous nous sommes tournés vers l’intérieur[2].
C’est en s’inscrivant dans cette oralité secondaire que l’on peut faire de l’écrit l’objet d’une parole afin de lui donner toute sa signification.
Ce qui est écrit n’a de sens que si l’on en parle, c’est pourquoi l’écrit ne pourra jamais se substituer à la parole, c’est pourquoi lorsqu’il tente de le faire, il l’étouffe et la refoule, mais ne la remplace pas. Par conséquent, si l’on veut éviter un retour trop violent du refoulé, il faut écrire, mais pour parler et non pour se taire.
Pour aller plus loin :
[1] Walter J. Ong, op. cit., p. 100.
[2] Walter J. Ong, op. cit., p. 154.
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS,Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie , co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Septembre 2018 intitulé « Ce que peut un corps » aux Editions l’Harmattan, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de www.managersante.com
Biographie de l’auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il vient de co-publier un nouvel ouvrage le 25 Septembre 2018 intitulé » Ce que peut un corps », aux Editions l’Harmattan,
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019
Résumé : Et si le bonheur n’était pas vraiment fait pour nous ? Si nous ne l’avions inventé que comme un idéal nécessaire et inaccessible ? Nécessaire, car il est l’horizon en fonction duquel nous nous orientons dans l’existence, mais inaccessible car, comme tout horizon, il s’éloigne d’autant qu’on s’en approche. Telle est la thèse défendue dans ce livre qui n’est en rien pessimiste. Le bonheur y est présenté comme un horizon inaccessible, mais sa poursuite est appréhendée comme la source de toutes nos joies. Parce que l’être humain est désir, il se satisfait plus de la joie que du bonheur. La joie exprime la force de la vie, tandis que le bonheur perçu comme accord avec soi a quelque chose à voir avec la mort. Cette philosophie de la joie et du bonheur est présentée tout au long d’un parcours qui, sans se vouloir exhaustif, convoque différents penseurs qui se sont interrogés sur la condition humaine et la possibilité pour l’être humain d’accéder à la vie heureuse. (lire un EXTRAIT de son ouvrage)
Et suivez l’actualité sur www.managersante.com,
Officiel du Salon Européen Paris Healtcare Week 2019
Paris-Porte de Versailles [#PHW19] du 21>23 Mai 2019