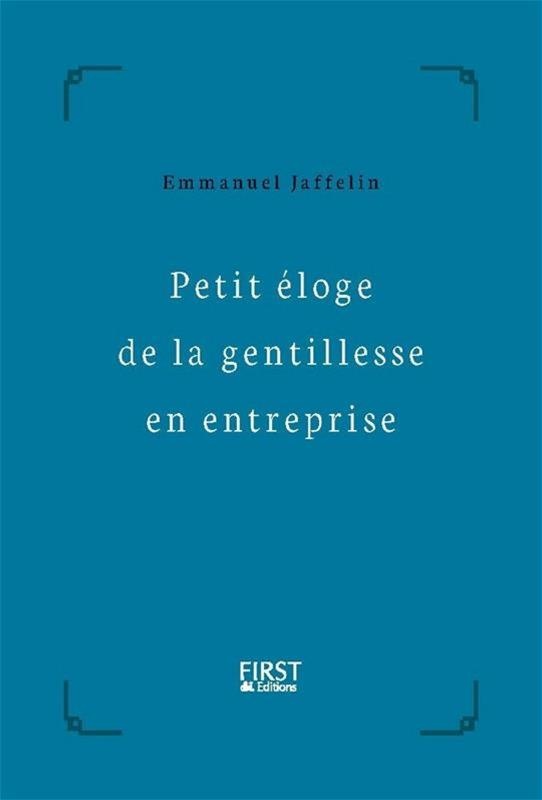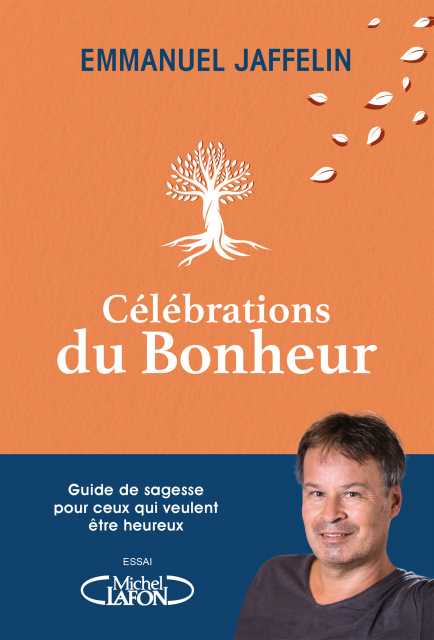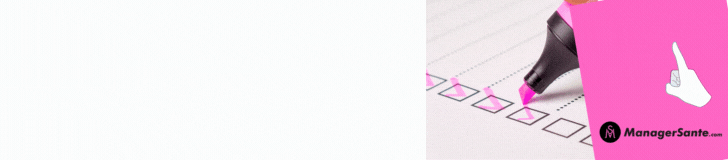Nouvel article rédigé pour notre plateforme média ManagerSante.com par Emmanuel JAFFELIN, Philosophe, professeur, conférencier, écrivain, intervenant dans les médias, ancien diplomate en Afrique et en Amérique latine.
Il enseigne au lycée Lakanal de Sceaux. Il intervient désormais en entreprise pour prôner et défendre la gentillesse dans les ressources humaines.
Auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier publié en 2021 « Célébrations du bonheur » (Edition Michel Lafon).
« Ce qui n’est pas utile à l’essaim n’est pas non plus utile à l’abeille. » Marc AurÈLE, Pensées (170-178).
À première vue, le philosophe et l’entrepreneur font aussi bon ménage que l’eau et le feu. L’un passe pour avoir la tête dans les nuages en laissant les choses filer au cours de l’eau ; l’autre a les pieds sur terre et revendique une pratique de forgeron. Contemplation versus transformation. Socrate contre Vulcain. Athènes contre Rome. Ainsi conçue, la relation des deux hommes semble contradictoire, irréconciliable, vouant l’un à la contemplation, l’autre à l’action. Pourtant, à considérer les choses de plus haut et sans dramaturgie, ces deux hommes n’ont pas vocation à s’opposer ; il se peut même qu’ils aient une affaire commune à mener. En effet, qu’est-ce qu’une entreprise, sinon un dispositif inventé par les hommes pour produire de la richesse ? Et qu’est-ce que la philosophie, sinon une discipline imaginée par les hommes pour qu’ils se conduisent avec sagesse ? Sauf à préjuger de la nature exclusive de la richesse et de la sagesse, il est possible de penser l’entreprise comme un objet éminemment philosophique, comme en témoignent les questions qui suivent : peut-on être pauvre et philosophe ? La sagesse est-elle une richesse ? Et, si tel est le cas, quelle est la nature de cette richesse ? La philosophie aurait-elle pu se développer indépendamment de la société et de l’économie ? Comme nous le pressentons, la relation entre le philosophe et l’entrepreneur est riche de promesses.
Historiquement, la philosophie s’est toujours intéressée à l’entreprise, même si nous peinons à retrouver dans le visage actuel de celle-ci les traits qui s’y dessinaient à ses débuts. En distinguant deux formes d’acquisition de la richesse — l’économie et la chrématistique —, Aristote nous montre que la réflexion sur l’entreprise ne date pas d’hier : « On peut se demander si l’art d’acquérir la richesse est identique à l’art économique, ou s’il en est une partie ou l’auxiliaire. […] On voit clairement que l’économique n’est pas identique à la chrématistique. Il revient à ce dernier de procurer, à l’autre d’utiliser. Quel autre art que l’économie s’occupera de l’utilisation des biens dans la maison[1] ? » Cette distinction entre deux visages de l’acte d’entreprendre se révèle fondamentale : par l’économie, la production de richesse se révèle utile ; par la chrématistique, elle dévoile son caractère pathologique. L’économie crée de la richesse pour la répandre, au moins dans le domaine (oïkos), la chrématistique produit de la richesse pour la stocker. Dans XEthique à Nicomaque, le philosophe soutient ainsi que la chrématistique « consiste à placer la richesse dans la possession de monnaie en abondance » et s’avère de fait contre-nature[2]. Il y aurait donc une bonne économie, conforme à la nature et permettant de pourvoir aux besoins du domaine, et une mauvaise économie, difforme et contre-nature parce qu’elle confond l’argent et la richesse et prend un moyen pour une fin. Par la chrématistique, l’économie perd de vue son but naturel – produire de la richesse – pour s’enticher d’une fausse richesse, l’argent, tenue à tort pour un but.
La réflexion économique d’Aristote est inséparable de sa biologie qui montre des êtres devant s’accomplir, chaque être vivant (bios) ayant sa raison d’être, à savoir une âme (psuchè). Dans sa théorie des trois âmes[3], il assigne à chaque être vivant une finalité (télos) : la plante, poussée par son âme végétative, vit pour croître ; l’animal, mû par son âme sensitive, vit pour sentir ; l’homme, tiré par son âme rationnelle, aspire à la société et au bonheur. L’homme dispose ainsi d’une double raison d’être : il doit vivre socialement et être heureux. Beau programme ! Le double télos de l’homme ne lui enjoint pas seulement l’être, mais le bien-être. Il est cet animal sociable (zoon politikon) qui recherche le bonheur (eudaimonia). A la différence des deux autres espèces, il ne s’agit pour l’homme ni de survivre ni de vivre, mais de bien vivre.
Nous devinons alors que l’entreprise doit – sauf à se faire inhumaine – concourir à ce double but : elle a certes vocation à produire de la richesse, mais elle ne peut le faire contre l’essence même de l’humanité. Produire pour le domaine (oikos) suppose de respecter, voire de favoriser l’épanouissement de l’homme (son télos). Or – et c’est là que le bât blesse – l’entreprise est rarement vécue comme le lieu de réalisation de l’humanité ; pourtant, si le but de l’homme est de vivre heureux en communauté, l’entreprise doit contribuer à le réaliser. Tout se passe comme si l’entreprise s’affranchissait de ce but pour se constituer en un lieu d’extra-territorialité dans lequel le bonheur et la sociabilité n’auraient pas à s’appliquer.
L’abeille et le frelon
Ainsi, malgré tous les livres écrits sur l’entreprise, les relations humaines qu’elle abrite, qu’elle fabrique et dont elle se nourrit, changent peu. Tout se passe comme si la réalité économique résistait au projet d’humaniser l’entreprise, comme si la logique entrepreneuriale neutralisait toutes les autres et envoyait par le fond la noble idée de mettre l’homme en son centre. Tous les discours se sont heurtés à cette irréductibilité : celui des religieux, des psychologues, des sociologues et, last but not least, celui des philosophes. Alors, à quoi bon commettre un ouvrage de plus dans un océan de livres qui attirent, au mieux, la sympathie mais ne changent jamais la réalité ?
Le projet d’écrire un livre qui ne soit ni un constat ni un réquisitoire, mais un regard ouvrant l’entreprise à elle-même et à sa double finalité – produire de la richesse et du bien-être – me paraît une raison suffisante pour passer à l’abordage. Il ne s’agit pas d’en découdre avec l’entreprise, mais au contraire de valoriser son pouvoir de coudre le tissu social. L’entreprise n’est pas un trou noir tirant l’humanité vers le bas ; elle peut être une voie que l’humanité emprunte pour s’élever. Si les êtres humains passent l’essentiel de leur temps, après l’enfance et avant la retraite, à travailler, il ne faut pas que ce moment représente une mauvaise parenthèse dans une vie, mais qu’il soit l’un des facteurs du vivre-ensemble. Platon recourt à l’image du tisserand pour expliquer le rôle de l’homme politique : « Car c’est là toute la fonction de ce royal art du tissage : de ne jamais laisser le divorce s’établir entre le caractère tempéré et le caractère énergique, de les ourdir ensemble, au contraire, par la communauté d’opinion, d’honneur, de gloire, par l’échange mutuel de gages[4]. » Le tisserand royal n’est autre que l’homme politique, celui qui peut nouer le même avec l’autre, l’un avec le multiple. Comme le dit Platon, « tisser, c’est en somme faire un entrelacement[5] » ; or, n’est-ce pas là aussi le rôle de l’entrepreneur et de tout salarié ? De la même manière que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, la vie économique produit de la socialisation sans le vouloir : elle est un art d’entrelacer (sumplokê) les hommes. L’entreprise produit ainsi non des ressources humaines mais des relations humaines.
Depuis deux siècles et demi, l’Occident cultive cette fable qui voudrait que la cité (polis) soit le fruit de la politique. Les révolutions américaine (1776) et française (1789) auraient ainsi consacré la vie politique comme ce pouvoir auquel tous les citoyens sont sommés de participer. Partager le pouvoir, par le vote ou la charge issue de l’élection, constituerait le cœur et la noble source de la vie sociale. Or, si nous nous souvenons que polis signifie aussi bien la société que YEtat – deux idées que nous séparons mais que réunit la cité grecque -, il nous faut aussi admettre que la vie de l’homme en communauté ne se réduit pas à son organisation politique. La vie sociale vient d’ailleurs, j’oserais même dire qu’elle vient de partout : de l’individu, de la famille, de l’école, du lieu de culte, du sport, de l’art et bien sûr du travail. C’est précisément parce que l’homme transpire le social dans ses faits et gestes qu’il se distingue des autres animaux. Si la vie sociale culmine dans la politique, elle s’édifie notamment par le travail et la création de richesses. Dès lors, l’économie ne doit être ni opposée ni subordonnée à la politique, mais reconnue comme l’un de ses fondements. Une société qui ne créerait pas de richesses et qui serait an-économique ou anti-économique serait anémique ; la politique n’y ferait pas long feu.
Tout homme qui travaille poursuit ainsi deux buts qui ne se concurrencent pas, mais qui, comme l’eau et la terre, se mélangent : créer de la richesse et vivre heureux en société. Le rôle de l’entreprise apparaît alors clairement : si elle ne recherche pas immédiatement la sociabilité, elle ne saurait la mettre sous le boisseau. L’un des signes de cette finalité eudémonique se lit dans l’attitude des entrepreneurs et des salariés qui prennent leur retraite et qui éprouvent regret et nostalgie à l’heure de quitter l’entreprise pour laquelle ils ont travaillé. Ce n’est pas seulement une page de leur vie qu’ils tournent ; c’est une forme de socialisation et donc une partie d’eux-mêmes qu’ils amputent. Pourquoi manifesteraient-ils de telles émotions si l’entreprise ne constituait pas une activité tissant humeur et humanité ou, comme le dit Platon, « tempérance » et « énergie » ?
Il s’agit de penser l’entreprise comme le confluent des deux sources d’épanouissement de l’homme : l’une consistant à satisfaire ses besoins – tâche directe que l’entreprise assume – et l’autre visant à réaliser l’essence même de la vie humaine, le bonheur en commun – tâche à laquelle doivent se ramener toutes les activités humaines. En d’autres termes, l’entreprise doit réaliser une activité spécifique, celle qui lui est propre et qui recherche la satisfaction des besoins de l’homme, et une activité générique, celle qui distingue le genre humain de toutes les autres espèces vivantes en recherchant cette vie heureuse en société. Convenons que la satisfaction des besoins n’a jamais rendu heureux personne : elle assure uniquement la survie et le confort de l’homme. Seule la réalisation de ce qui fait l’humanité de l’homme contribue à son bonheur. De facto, l’entreprise déploie une finalité (économique) qui est au service d’une finalité supérieure. Nommer cette finalité supérieure « humaniste » permet seulement de dégager l’entreprise de l’emprise que prétendrait exercer sur elle la politique. Ce n’est donc pas la politique qui pilote l’entreprise et lui dicte sa loi ; c’est l’entreprise qui doit concourir à la vie harmonieuse de l’homme dans la cité.
Dans la nature, une autre espèce vivante semble assujettie à une double finalité : il s’agit de l’abeille, animal social et industrieux s’il en est, souvent pris comme exemple par les économistes[6]. En butinant les fleurs, l’abeille ne se contente pas de rapporter son butin à la ruche : elle contribue à la pollinisation en laissant échapper des grains de pollen que le vent colporte vers d’autres fleurs ou en frottant son ventre sur les étamines qu’elle approche. Tout à son affaire, elle réalise une finalité seconde, que la nature semble lui assigner en la faisant participer à son insu à la sexualité végétale ; en retour, la reproduction végétale lui permet, la saison suivante, de butiner les fleurs de nouvelles plantes. Il n’est donc pas absurde de penser que l’entrepreneur, à l’instar de l’abeille, pollinise la société en créant par son activité une bonne humeur, une sociabilité qui se répercute à l’extérieur par le biais de salariés épanouis et équilibrés par leur travail.
Nous comprenons, a contrario, qu’une abeille qui mettrait un point d’honneur à rapporter intégralement à la ruche le pollen qu’elle recueille même involontairement se nuirait à elle-même en appauvrissant son territoire et en hypothéquant son avenir. N’est-ce pas là d’ailleurs l’attitude de l’entrepreneur cupide ou cynique qui considère que le maximum de richesse doit être amassé au détriment de tout le reste (ses salariés, l’environnement, la société et ses valeurs) ? Et ce genre d’entrepreneur, n’est-il pas, d’ailleurs, plutôt frelon qu’abeille ? Platon nous brosse ainsi le portrait de ce frelon : « Il est sordide, […] fait argent de tout et ne songe qu’à thésauriser […]. Il contient ses mauvais désirs par une sorte de sage violence, non pas en les persuadant qu’il vaut mieux ne pas leur céder, ni en les adoucissant au moyen de la raison, mais en pesant sur eux par contrainte et par peur, car il tremble pour ce qu’il a[7]. » Le philosophe nous invite à reconnaître dans l’homme cupide l’oligarque : l’homme de l’avoir est une ombre de l’homme.
Le tisserand et la richesse
Tout entrepreneur n’est heureusement pas frelon, loin s’en faut. Cependant, le contexte dans lequel l’entreprise exerce son activité ne relève pas de la cueillette comme la pratiquent les abeilles, mais d’une action belliqueuse. Tout se passe en effet comme si les entreprises, avant même de satisfaire des besoins, devaient auparavant livrer un combat à d’autres entreprises pour leur « prendre des parts de marché ». La modernité se caractérise d’ailleurs par une nouvelle définition de la richesse qui n’est plus envisagée comme l’abondance de biens satisfaisant nos besoins – antique conception[8] – mais comme l’allocation de ressources rares. Autrefois conçue comme un excès, la richesse est aujourd’hui pensée comme un manque[9].
L’entreprise se définit alors comme cet ensemble de moyens mis en œuvre pour se procurer cette rareté dans un contexte concurrentiel. Le marché est son nouveau champ de bataille, les salariés ses nouveaux soldats, les directeurs de nouveaux chefs de division combattante et les entrepreneurs ses nouveaux stratèges. Difficile de prôner la sérénité au sein de l’entreprise quand on pense la guerre en dehors. Si le microcosme exprime pour les anciens le macrocosme, l’entreprise manifeste fidèlement, pour nos contemporains, les principes de la macroéconomie !
Cet ouvrage n’a pas l’ambition de changer directement l’entreprise ou ses pratiques managériales ; il se donne pour but d’orienter autrement le regard de ses différents acteurs afin que ceux-ci contribuent, au quotidien, à faire de leur lieu de travail, non seulement a great place to work\ mais le prolongement de relations empathiques que nous vivons en famille, avec nos amis et dans tous les lieux qui « font lien ». Que la gentillesse rende possible un continuum suavitatis[10] [11] entre les différentes sphères dans lesquelles nous vivons constitue l’enjeu de ce livre. Bien sûr, la famille n’est pas l’école qui, elle-même, n’est ni sportive ni entrepreneuriale. Mais ces sphères ne sont pas des bulles étanches : elles s’interpénétrent et se trouvent en interaction permanente. Pourquoi faudrait-il alors que la logique économique l’emporte sur toute psychologie ? Comment peut-on prôner des logiques de management qui divisent les salariés (pour mieux régner sur eux) alors même que la double essence de l’homme, psychique et sociale, l’invite à l’union ? Allons jusqu’au bout de notre raisonnement : pourquoi ériger le cynisme en modèle alors qu’il nuit à tout le monde, y compris à ceux qui le distillent dans l’entreprise ? Et si des entreprises parviennent à respecter la double finalité de l’homme, n’est-ce pas l’ensemble de l’économie qui, à terme, est susceptible de se modifier en profondeur ?
L’objet de cet ouvrage est de proposer une « gentrifi- cation[12] » de l’entreprise. J’entends par « gentrification » le pouvoir de nous anoblir par la gentillesse et d’ennoblir par celle-ci les relations humaines dans l’entreprise. Si ce que j’écris ici n’est pas étranger à la raison – cette capacité de chaque homme à comprendre et à partager une information -, alors l’entreprise s’éclairera d’un jour nouveau pour être envisagée comme un métier à tisser de relations humaines solides, douces et fructueuses.
Notes :
[1] Aristote, La Politique, I, 1256a, Vrin, 1995. Chrématistikos signifie « qui permet de gagner de l’argent ».
[2] Parce qu’elle n’est pas digne de l’humanité, Aristote propose de réserver la chrématistique aux métèques. Aristote distinguera plus tard la chrématistique naturelle et la chrématistique commerciale, la première alimentant le domaine tandis que la seconde « consiste à placer la richesse dans la possession de monnaie en abondance » (Éthique à Nicomaque, 1096, Garnier-Flammarion, 1993, p. 59).
[3] Aristote, De l’âme, Garnier-Flammarion, 1993.
[4] Platon, Le Politique, 310e, Garnier-Flammarion, 1993.
[5] Ibid., 280a.
[6] Bernard Mandeville, La Fable des abeilles (1714), Vrin, 1998. Ce livre défend le point de vue utilitariste de l’égoïsme en expliquant que le vice privé contribue à la vertu publique.
[7] Platon, La République, livre VIII, 554d, traduction Victor Cousin, Paris, 1832.
[8] On la trouve au IVe siècle av. J.-C dans l’Economique de Xénophon, qui la définit comme patrimoine de la famille ou de la cité.
[9] Ce qu’on peut déduire de la célèbre définition de l’économie comme une « relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages alternatifs », que fournit, en 1932, Lionel Robbins dans La Nature et la Signification de la science économique. George Stigler ira plus loin dans cette voie en définissant, en 1972, l’économie comme « l’allocation des ressources rares entre des fins concurrentes lorsque l’objectif de l’allocation est de maximiser le profit » (La Théorie des prix, Dunod, 1993).
[10] Great Place to Work est un institut qui labellise dans le monde entier chaque année « les entreprises où il fait bon travailler ».
[11] Une continuité de douceur.
[12] Ce néologisme est inspiré du terme anglais gentry qui désigne la noblesse non titrée.