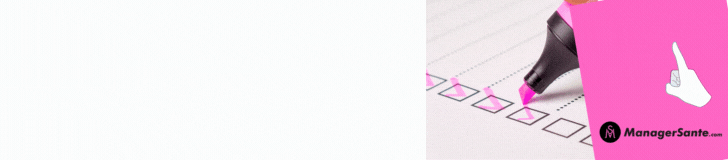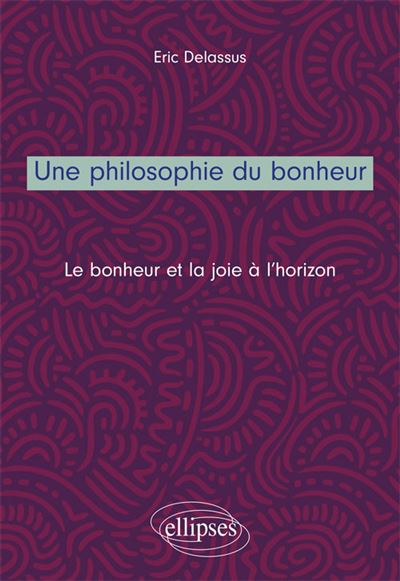N°62, Décembre 2022
Nouvel Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School). Il est co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un nouvel ouvrage publié depuis le04 Octobre 2021 chez LEH Edition, sous la direction de Jean-Luc STANISLAS, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins
Relire la troisième partie de cet article.
C’est dans ce cadre que se manifeste nécessairement la dimension affective de la prise de décision médicale ; dimension affective qui est le plus souvent l’expression de la sollicitude des soignants, mais qui ne doit pas pour autant relever d’une compassion qui n’aurait d’autre effet que d’obscurcir leur jugement. Cependant, il n’est pas souhaitable non plus de bannir tout affect de la prise de décision. Indépendamment du fait qu’il est peu probable qu’un tel fonctionnement soit possible, « nos idées ne sont pas des peintures muettes sur un tableau[1]», il nous faut convenir que c’est précisément la dimension affective qui fait l’humanité de la relation de soin. Rien de plus déplaisant, et parfois même de plus angoissant, qu’un thérapeute ou un soignant qui se conduit comme le plus froid des monstres froids sous prétexte qu’il doit faire preuve de la plus totale objectivité scientifique pour établir son diagnostic.
C’est un tel reproche que l’on pourrait d’ailleurs adresser à l’EBM (ou evidence-based medicine, que l’on traduit en français par l’expression « médecine par les preuves » ou « médecine factuelle ») lorsqu’elle conduit à réduire la médecine à une pratique purement technoscientifique. En effet, si l’EBM a le mérite de fonder la pratique médicale et la prise de décision sur l’utilisation des données scientifiques dont dispose la médecine, elle ne doit pas pour autant réduire le patient à un simple objet, à un corps sans âme.

Le rôle des affects dans la prise de décision médicale
Mais, si les affects jouent nécessairement un rôle dans la décision médicale, ils ne peuvent pas non plus exercer une pression tyrannique sur les choix à faire. Ici, apprendre à décider, c’est apprendre à domestiquer ses affects, sans les faire taire, mais sans non plus les laisser s’emballer au risque de se laisser dominer par eux. Le sujet doit se comporter face à ses passions comme un cocher dirigeant son attelage. En effet, s’il retient excessivement les rennes, il ne peut avancer, mais s’il les lâche, les chevaux s’emballent et c’est l’accident assuré. Il s’agit donc de faire preuve d’empathie sans tomber dans la compassion, de comprendre ce que ressent le patient sans pour autant être affecté par un pathos identique, mais sans non plus être « a-pathique », c’est-à-dire dénué de tout sentiment et de toute sensibilité.
La question se pose de savoir quel type de sentiments, quel genre d’affects, peuvent jouer, chez le soignant, un rôle déterminant dans ses choix et ses décisions, sans pour autant donner lieu à un mode de fonctionnement « patho-logique », c’est-à-dire dans lequel l’ordre des passions l’emporterait sur celui du raisonnable – l’ordre du raisonnable n’étant pas justement celui d’une rationalité froide et désincarnée, mais bien au contraire d’une raison sensible à l’écoute de la souffrance et du désir du patient. Une raison qui mépriserait les affects tant des patients que des soignants serait pour le coup totalement déraisonnable, dans la mesure où elle occulterait dans l’analyse du problème qu’elle doit traiter une dimension essentielle de la vie du malade et un registre causal sans lequel ce dernier ne peut être compris et sans lequel tous les facteurs décisionnels ne peuvent être identifiés. Une telle conception de la raison est en réalité inconcevable, dans la mesure où elle ne pourrait concerner qu’un être totalement désincarné qui ne peut qu’être le produit de notre imagination. Pour reprendre une réflexion d’Henri Atlan :
L’exercice de la raison n’est pas désincarné. Il nécessite le corps et ses passions. En outre, en quel sens le choix des fins dans le processus de décision rationnelle est-il libre ? N’est-il pas dicté lui aussi par les lois du désir et de ses déterminations psychosociales – comme le mimétisme et l’envie par exemple – et biologique[2] ?
L’esprit humain est tout autant producteur d’affects que d’idée, et parce que la raison est celle d’un être qui se perçoit de manière égale en tant que corps et en tant qu’esprit, il n’y a pas d’affect qui ne soit en rapport avec une idée, ni d’idée qui ne soit génératrice d’affect :
Par affect, j’entends les affections du corps, qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient, la puissance d’agir de ce corps, et en même temps les idées de ces affections[3].
Le caractère positif d’un affect, sa capacité à produire des effets bénéfiques, tant du point de vue de l’utilité propre que de l’utilité commune, dépend donc du degré d’adéquation ou d’inadéquation de l’idée qui l’accompagne. L’affect est le moteur de nos actions et des décisions qui les précèdent. Bien décider ne peut procéder d’une impossible évacuation des affects, mais relève au contraire d’une culture des affects dont les effets ne peuvent être que bénéfiques, tant pour celui qui les ressent que pour ceux sur qui ou avec qui il agit.

Entre miséricorde et sollicitude du médecin
S’il est un affect qui peut jouer ce rôle, c’est peut-être celui que Spinoza nomme miséricorde :
La miséricorde et l’amour, en tant qu’il affecte un homme de telle sorte qu’il est content du bonheur d’autrui, et, au contraire, qu’il est triste du malheur d’autrui[4].
Jacqueline Lagrée apparente d’ailleurs cet affect à ce que, dans un vocabulaire plus contemporain, nous appelons sollicitude :
La sollicitude n’est pas la pitié, faiblesse plus encore que vertu, mais le service et la miséricorde au sens spinoziste, car c’est un mouvement réfléchi et perpétuellement confronté à la réflexion sur le vrai bien de l’autre [5].
Réfléchir sur la nature de cette vertu, c’est d’ailleurs aussi réfléchir sur la nature même des motivations qui peuvent pousser un homme à exercer la médecine, motivations qui ne peuvent être étrangères aux déterminations d’une décision médicale. On peut, en effet, choisir d’exercer cette profession par goût pour la chose scientifique, mais alors mieux vaut devenir chercheur ; par désir de richesse et de statut social, ce qui est un cas de figure plus fréquent et qui n’est pas sans conséquence sur l’attitude de certains médecins au plan de l’éthique. Cependant, et fort heureusement, la réalité est souvent plus complexe et le désir de venir en aide à ses semblables et de tout simplement les soigner, même lorsqu’il ne joue pas le rôle principal, est rarement étranger à ces motivations. On pourrait certes soupçonner la présence, derrière ces intentions en apparence altruistes, d’un désir de puissance sans limite, et il y a probablement une part de vérité dans un tel jugement. Mais, il n’y a finalement rien de désavantageux à voir une passion, même égoïste, se mettre au service des autres hommes. D’autant que ce désir, s’il est éclairé par la réflexion, peut voir sa nature se transformer et trouver ses propres limites. Si l’on rapproche comme nous l’avons fait plus haut la sollicitude du médecin de la miséricorde telle que définie par Spinoza on s’aperçoit que cette dernière est en quelque sorte un mixte de tristesse et de joie. Elle comporte une composante de tristesse qui, pour le coup, ne diminue pas la puissance de celui qui la ressent, parce qu’elle s’accompagne du désir d’y mettre fin. Il convient de préciser que cet affect est tout d’abord une joie, puisque c’est un amour (l’amour se définissant comme une joie qu’accompagne l’idée d’une cause externe) et, comme c’est une joie, il exprime une puissance, puisque « la joie est le passage d’une moindre à une plus grande perfection », puissance (potentia) ne devant pas ici être confondue avec pouvoir (potestas). Il ne s’agit pas pour le sujet agissant d’exercer un quelconque pouvoir sur autrui, mais plutôt de réaliser sa puissance d’être et d’agir en accroissant sa perfection ainsi que celle d’autrui, sans laquelle la sienne propre se trouve diminuée. Et si, dans la réalité, potentia et potestas sont souvent mêlées de manière quasiment inextricable, il reste difficile de concevoir un acte authentiquement médical qui ne soit animé par une certaine sollicitude envers les autres hommes. Bref, il s’agit de contribuer à accroître sa puissance en accroissant celle d’autrui. La démarche est donc ici solidaire, au sens où la solidarité est la vertu de ce qui tient ensemble, de ce qui maintient la solidité d’un tout par l’action des parties les unes sur les autres. Ce souci solidaire peut être assimilé à la force d’âme qui allie fermeté et générosité, c’est-à-dire la vertu par laquelle l’individu cherche à persévérer dans l’être tout en contribuant à la conservation de l’être d’autrui.
Je ramène à la Force d’âme les actions qui suivent des affections se rapportant à l’âme en tant qu’elle connaît, et je divise la Force d’âme en Fermeté et Générosité. Par Fermeté j’entends un Désir par lequel un individu s’efforce à se conserver en vertu du seul commandement de la Raison. Par Générosité j’entends un Désir par lequel un individu s’efforce en vertu du seul commandement de la raison à assister les autres hommes et à établir entre eux et lui un lien d’amitié [6].
Il ne peut donc y avoir de véritable décision médicale que n’anime un tant soit peu cette force d’âme. Cependant, une telle vertu n’a rien d’innée et ne peut être cultivée que par l’expérience et l’habitude qui s’acquièrent durant les années de formation au cours desquelles le futur et jeune médecin accompagne ses confrères plus âgés et aguerris. Cette culture par l’expérience ne peut néanmoins porter ses fruits que si elle est soutenue par l’acquisition de tout l’attirail conceptuel nécessaire pour nourrir le travail réflexif qui doit l’accompagner. On voit là l’intérêt que présente l’enseignement de « philosophie et sciences humaines » qui commence à occuper la place qu’il mérite dans les études médicales. Sans cela, l’habitude risque fort de devenir une routine, source d’indifférence et d’insensibilité. En effet, les vertus de l’habitude ne peuvent se manifester si cette dernière s’acquiert de manière purement mécanique. Il faut nécessairement qu’à l’habitude soit jointe la réflexion pour que la répétition de situations analogues ne débouche pas sur une simple accoutumance à la souffrance d’autrui, qui deviendrait ainsi plus supportable.

La réflexion philosophique sur la décision et l’action médicale
Comprendre la fonction que peut jouer l’habitude dans la décision médicale nécessite que l’on introduise une dimension de temporalité dans le processus décisionnel, non seulement en tenant compte du temps de la décision et de la durée limitée de la délibération, toujours trop courte en raison de l’urgence de l’action, mais aussi en prenant en considération l’influence qu’ont pu jouer toutes les décisions précédentes sur la décision présente. Si la réflexion philosophique sur la décision et l’action qui s’en suit est toujours rétrospective, c’est que l’urgence de l’action ne permet pas un regard réflexif sur ce qui est en train de se jouer. Cela ne signifie pas pour autant que la réflexion est inutile. Réfléchir sur une décision et sur ses conséquences après coup aide à se préparer à la décision suivante, pas tant pour tirer des leçons des événements passés que pour se mettre dans des dispositions mieux adaptées à la prise de décision. De même que l’histoire ne repasse jamais les plats, il est rare qu’un médecin rencontre des problèmes éthiques quasiment identiques et qu’il puisse prendre modèle sur une situation précédente pour régler une difficulté présente. Le propre même des problèmes d’éthique médicale consiste dans leur caractère atypique, par définition une question dont on possède déjà la réponse ne présente aucun caractère problématique. Les acquis de l’expérience ne consistent donc pas en la matière à fournir au praticien des modèles de comportement issus de la résolution de difficultés rencontrés antérieurement, pour les plaquer ensuite sur des situations similaires, mais à nourrir une certaine disposition d’esprit dans l’appréhension des problèmes.
Le rôle de l’habitude dans la prise de décision ne relève donc pas de la leçon rétrospective, mais concerne davantage la manière dont doivent être appréhendés les problèmes que leurs solutions. En effet, l’habitude repose essentiellement sur la répétition de situations qui, même si elles sont toutes singulières, peuvent être considérées comme comparables. La comparaison, pour ce qui concerne les situations qui peuvent donner lieu à une prise de décision médicale, relève plus de l’analogie que de la simple similitude. C’est en effet dans le rapport du soignant avec le contexte de la situation elle-même que se situent les ressemblances. Il s’agit le plus souvent d’une configuration d’événements dans laquelle il se trouve, avec les autres membres de l’équipe de soins, face à un malade ainsi qu’à ses proches, dans une situation génératrice d’affects souvent envahissants, situation qui appelle plusieurs solutions possibles dont aucune ne peut être jugée pleinement satisfaisante.
La tentation serait, pour le soignant inexpérimenté, de choisir spontanément la solution qui diminuerait l’intensité des affects qui l’assaillent. Le problème étant bien entendu qu’il ne s’agirait pas nécessairement de la meilleure solution pour le patient. Mais, comme déjà souligné, il ne s’agit pas non plus de bâillonner notre affectivité et d’établir entre le soignant et le patient une distance qui pourrait se situer aux limites de l’inhumanité. C’est un tel effet que risque de produire l’habitude lorsqu’elle n’est pas secondée par la réflexion. Ne risque-t-on pas alors de s’accoutumer plus ou moins à la souffrance et, peut-être pour se protéger, de finir par placer au second plan le fait qu’il est un autre, de ne voir d’abord dans le malade que sa maladie et non la personne ? Mais peut-on réellement ne regarder le patient que comme une image abstraite et déconnecter la perception qu’on en a des affects qu’elle produit, pour finalement ne plus être ému d’une quelconque manière par ce qu’il est en train de vivre ? Une telle attitude est probablement impossible à adopter totalement pour un soignant, mais elle est parfois présentée comme une sorte de condition idéale à l’objectivité scientifique. L’idée étant que, si l’on pouvait être totalement dénué d’affects, il serait plus facile de prendre la bonne décision, puisque celle-ci ne se réglerait que sur des données objectives et des justifications purement rationnelles. Cependant, penser cela, c’est oublier qu’il n’y a pas de décision sans affect, c’est omettre de prendre en compte que, pour décider, il faut en ressentir la nécessité. Raisonner ainsi, c’est occulter le fait que nous sommes soumis à la nécessité des affects et que ce sont les lois de l’affectivité qui nous font ressentir la nécessité de décider. Une trop grande distanciation qui conduirait à une apparente indifférence aurait pour conséquence l’absence même de décision et ne serait finalement que la manifestation d’affects non réfléchis. C’est la raison pour laquelle la solution n’est pas dans l’absence d’affects, dans la disparition des sentiments ou des émotions, ce qui est proprement impossible, mais dans l’usage que l’on doit en faire et qui repose sur une expérience réfléchie.
Si la fonction de l’habitude n’est ni de tirer des leçons du passé, ni d’entraîner l’accoutumance, c’est qu’elle joue dans la décision médicale un autre rôle relevant de l’analyse rétrospective des comportements. Le médecin, ou le soignant, animé par cette sollicitude proche de la miséricorde spinoziste cherchera toujours, après avoir pris une décision, les éléments qui sont intervenus dans son choix, les raisons, les affects, les éléments intersubjectifs qui se sont entrecroisés et qui ont produit sa décision. Si certains affects trop prégnants ont pu le conduire à prendre une orientation inadéquate, le travail de compréhension qu’il aura effectué ne pourra être ensuite sans effet sur ce qu’il ressentira dans d’autres circonstances. La vertu de l’habitude tient donc ici dans ce que la répétition de situations analogues modifie pour chacune d’elle la nature même de ce qui est ressenti par le soignant. Chaque situation éclaire en quelque sorte la suivante et vient modifier le ressenti de la situation. Si ce ressenti est à chaque fois différent, c’est non seulement parce que chaque patient est différent, mais c’est aussi parce que la vie affective s’inscrit dans une temporalité qui exerce une action effective sur les affects eux-mêmes. Un sentiment ou une émotion que l’on ressent pour la première fois face à une scène d’un type qui nous était jusque-là inconnu ne se reproduira jamais de la même façon ; il ne sera pas ressenti de manière identique la seconde fois parce que, précisément, c’est la deuxième fois. Parce que le souvenir de la première fois vient en quelque sorte colorer d’une nuance différente les fois suivantes, chaque émotion, chaque sentiment ou affect, fait en quelque sorte écho et vient retentir sur le ressenti des affects ultérieurs. Et si à cet écho vient s’ajouter la dimension réflexive, la prise de décision présente bénéficiera de l’éclairage des expériences précédentes. Pour reprendre ce qu’écrit Pierre Le Coz :
Lorsqu’une décision est suivie d’une méditation méthodiquement organisée sur le contexte, les émotions, les principes éthiques et les règles qui ont été prises dans des circonstances analogues porteront l’écho de cette réflexion. Un examen de conscience rétrospectif appliqué à ce qui a été décidé peut constituer une archive précieuse pour limiter la part que renfermeront les décisions futures[7].
Conclusion :
C’est donc par une habitude réglée sur l’expérience et éclairée par un retour réflexif permettant la saisie du mouvement immanent à l’intention qui préside à la décision que le futur médecin ou soignant pourra apprendre à décider, non pas en appliquant une règle extérieure à la dynamique décisionnelle elle-même, mais en en saisissant la logique interne qu’il pourra spontanément épouser.
Eléments bibliographiques :
[1] B. Spinoza, Éthique, deuxième partie, scolie de la proposition XLIII.
[2] H. Atlan, op. cit., p. 31-32.
[3] B. Spinoza, op. cit., troisième partie, définitions des affects, définition III.
[4] Ibid., troisième partie, définitions des affects, définition XXIV.
[5] n 23. J. Lagrée, « La vie sans fin… Aspects philosophiques », dans J.-M. Boles, F. Lemaire, Fin de vie en
réanimation, Paris, Elsevier, 2004.
[6] n 24. B. Spinoza, op. cit., troisième partie, scolie de la proposition LIX.
[7] n 25. P. Le Coz, op. cit., p. 184.
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS, Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de ManagerSante.com
Biographie de l'auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il a publié plusieurs ouvrages :
– le 25 Septembre 2018 intitulé ” Ce que peut un corps”, aux Editions l’Harmattan.
– un ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un dernier ouvrage, sous la Direction de Jean-Luc STANISLAS, publié le 04 Octobre 2021 chez LEH Edition, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins.
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019