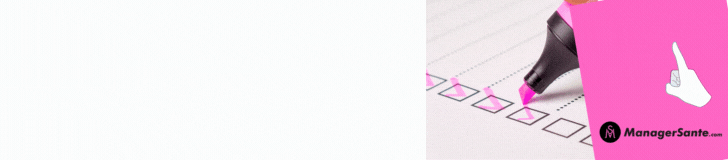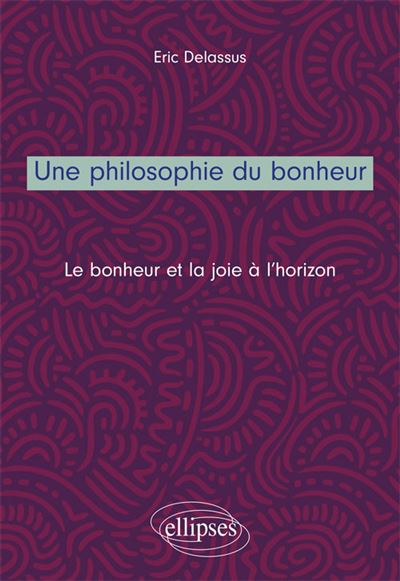N°75 Mars 2024
Nouvel Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School).
Il est co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Octobre 2021 chez LEH Edition, sous la direction de Jean-Luc STANISLAS, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins
Intervention prononcée à l’ENS de Lyon pour le séminaire organisé dans le cadre du Collège Internationale de Philosophie par Julie Henry : Relire l’éthique en santé à l’aune d’une anthropologie spinoziste : Philosophie de l’âge classique et médecine d’aujourd’hui.
Relire la deuxième partie de cet article.
Il semblerait qu’il ne reste plus que la connaissance du troisième genre pour permettre au malade d’accepter la maladie et de résister à ces passions tristes. En effet, cette connaissance, en tant qu’elle est connaissance des choses singulières et de leur union à Dieu, en tant qu’elle est perception immédiate des liens qui nous unissent à la nature tout entière, apparaît comme la seule en mesure de produire en nous des affects positifs, de nous aider à percevoir notre corps, même malade, comme expression de la puissance divine, et donc d’en avoir une idée plus cohérente.
Un affect qui est une passion cesse d’être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte [1].
L’Esprit, en tant qu’il comprend toutes les choses comme nécessaires, a en cela plus de puissance sur les affects, autrement dit, en pâtit moins [2].
Le problème, c’est que cette connaissance est la plus difficile à atteindre et qu’elle n’accompagne pas en permanence notre existence.
Autrement dit, s’il en va ainsi, seuls les sages seraient en mesure d’être sauvés, seuls ceux qui ont la capacité de suivre le chemin tracé par Spinoza dans l’Ethique seraient en mesure de cultiver cette force de résistance et de pouvoir continuer à augmenter leur puissance, malgré la maladie. Est-ce à dire qu’il n’y a pas de salut possible pour les ignorants, qu’il n’est pas possible pour eux d’accéder à une force de résistance suffisante, de trouver le moyen d’opposer à la puissance des causes externes une force suffisante pour réduire leurs effets ? Ici également, nous savons par expérience qu’il n’en est rien, bon nombre d’entre nous ont pu connaître des personnes qui ont su trouver, souvent en étant aidé par d’autres pour cela, les moyens d’affronter la maladie alors que pourtant, ils étaient incapables de comprendre un traitre mot de l’Ethique et encore moins de parvenir à la connaissance du troisième genre. Ne faut-il pas voire là, une autre manifestation de cette stratégie du conatus à laquelle il était fait référence plus haut ?
Avoir la force d’affronter la maladie nécessite, nous l’avons souligné l’acceptation, c’est- à-dire l’adhésion active à un réel que l’on n’approuve pas nécessairement, mais dont on prend acte pour mieux agir sur lui, voire pour mieux s’y opposer. Toute la question est alors de savoir comment accepter ce réel lorsque l’on ne dépasse pas le simple degré de la connaissance du premier genre, ou même du second genre. Comment faire pour se libérer des idées fictives qui génèrent des passions tristes comme le sentiment d’injustice, le désespoir ou le découragement, lorsque, précisément, on n’a pas nécessairement la capacité de dépasser la connaissance imaginative ? Comment, dans ces conditions, transmuer une imagination qui produit des représentations qui diminuent ma puissance d’être et d’agir en une imagination capable de produire d’autres représentations susceptibles d’accroître ma perfection ?
Si l’imagination, lorsqu’elle est mal orientée, peut avoir des effets terribles et destructeurs, il est également possible, lorsqu’elle correctement guidée, de la voir engendrer des affects éminemment positifs. En effet, si l’idée vraie est nécessairement porteuse de joie, c’est-à-dire d’un affect exprimant une augmentation de ma perfection, l’idée fictive n’est pas, quant à elle, nécessairement porteuse de tristesse. Pour la simple et bonne raison que l’idée fictive n’est jamais totalement fausse, une idée fictive nous dit Spinoza, est toujours une idée mutilée, c’est-à-dire incomplète, à laquelle il manque quelque chose, mais une idée parce qu’elle est toujours idée de ce qui est, idée du corps, contient toujours une part de vérité. Il n’y a pas d’idée absolument fausse, parce qu’il n’est tout simplement pas possible de penser ce qui n’est pas II n’y a pas de positivité du faux. Ainsi, l’idée du soleil que je perçois comme se situant à une distance beaucoup plus proche qu’il n’est réellement n’est pas totalement fausse. Si j’adhère à cette idée inadéquate du soleil, cela ne signifie pas pour autant que ce que je pense est totalement faux. Il est vrai que mon corps est affecté par le soleil de telle sorte que je le perçoive comme se situant à environ deux cents pieds. Si mon idée est fausse, c’est parce que je confonds la manière dont je suis affecté par le soleil et le soleil lui-même. Je perçois donc le soleil « de manière mutilée, confuse, et sans ordre pour l’intellect ». Il s’agit donc d’une connaissance du soleil par expérience vague, c’est-à-dire d’une connaissance des effets qu’il produit sur moi sans connaissance précise de la nature de leurs causes. Il n’empêche qu’il y a une part de vrai dans une telle idée. Ne faudrait-il pas, pour aider le malade à mieux accepter sa condition, cultiver cette part de vérité qui est en lui ?
Cela, Spinoza l’a perçu à propos de la religion, qui peut être pour l’ignorant une voie de salut à condition qu’elle porte à agir de manière juste et charitable. Ainsi, les représentations que véhiculent les croyances religieuses peuvent-elles aussi bien conduire au fanatisme que donner lieu à des actions d’une grande humanité. N’est-il pas possible de déplacer ce qu’expose Spinoza d’un point de vue théologico-politique sur un terrain plus individuel et existentiel ? Et, si ce déplacement est envisageable, comment faire en sorte qu’il s’accomplisse de manière satisfaisante ?

Inviter le malade à faire le récit de son existence
La question est, en effet, de savoir comment aider celui qui se sent dépossédé de son existence par la maladie à reprendre celle-ci en main, à redevenir acteur de cette existence qui lui échappe tout en restant au simple niveau de la connaissance du premier genre.
Cette connaissance, nous l’avons dit, se résume principalement à la perception des effets que subit l’individu sans connaissance de leurs causes, ou en en ayant une connaissance qui reste trop abstraite pour qu’elle puisse produire des affects correspondant à une augmentation de puissance. Comme cela a été déjà souligné également, si le malade ressent une intense impression de vulnérabilité, c’est parce que, en plus des tourments que lui impose sa maladie, il vit celle-ci comme une rupture injustifiable, comme un séisme venant instaurer le chaos dans sa vie. Dans ces conditions, l’aider à retrouver un peu de son autonomie perdue nécessite que soit trouvé le moyen de réintroduire dans sa vie de la continuité et de la cohérence, c’est- à-dire l’aider à reconstruire une idée plus cohérente de son corps. Or, l’un des moyens pour parvenir à ce but tout en se situant dans le champ de la perception immédiate des choses et de leur représentation selon l’imagination n’est autre que le récit. Inviter le malade à faire le récit de son existence en y introduisant tous les événements qui ne dépendent pas de lui et dont malheureusement la maladie fait partie, c’est lui proposer de reconstruire cette vie en devenant sujet de cette reconstruction, en devenant actif dans la reprise en main de ce qu’il a d’abord vécu comme lui échappant. Le recours à cette voie narrative rejoint d’ailleurs certaines des réflexions de Paul Ricœur qui écrit dans Temps et récit :
Je vois dans les intrigues que nous inventons le moyen privilégié par lequel
nous reconfigurons notre expérience temporelle confuse, informe et à la limite muette [3].
On peut d’ailleurs souligner au passage que Spinoza lui-même n’hésite pas, dans une certaine mesure, à recourir à la voie narrative lorsque, dans le Traité de la réforme de l’entendement, il expose comment l’on passe de la recherche des biens ordinaires à celle du Souverain Bien, il nous fait le récit de la réorientation de l’esprit selon le processus immanent à la démarche réflexive.
Le récit semble donc être l’une des premières formes de la réflexivité par laquelle notre perception des choses peut évoluer. C’est pourquoi aider le malade à se raconter et à intégrer la maladie dans le récit de sa vie peut apparaître comme une voie possible pour lui permettre d’y voir plus clair en son esprit en construisant une représentation plus « cohérente de son corps ».
Cette voie narrative permet également de déplacer l’analyse que fait Spinoza du rôle sociopolitique de la religion dans le Traité théologico-politique sur le plan de la recherche du salut individuel, dans la mesure où, l’Écriture étant principalement constituée de récits, ces derniers peuvent jouer un rôle paradigmatique permettant au malade d’y inscrire son propre parcours. Il est alors possible pour ce dernier de faire usage de la religion pour trouver le réconfort nécessaire pour affronter la maladie. Il peut de la sorte s’extraire de la passivité dans laquelle la maladie l’a placé pour reprendre en main son existence en se constituant comme l’auteur d’un récit qu’il aura lui- même élaboré et produit. Ce passage de la passivité vers une plus grande activité peut donc contribuer à accroître le sentiment de sa puissance d’être, c’est-à-dire sa joie. Le terme de joie peut sembler inadapté lorsque l’on connaît les affres dans lesquelles peut être plongé le patient victime d’une pathologie lourde. Peut-on encore parler de joie, lorsque l’on est confronté à la dimension tragique de l’existence humaine ? Cela a-t-il encore un sens pour qui est atteint d’une maladie incurable ou qui sait que sa fin est proche ?
Si l’on se réfère à la définition de la joie que donne Spinoza, il semble pourtant que ce terme convient parfaitement dans la mesure où la joie est avant tout un affect par lequel l’esprit passe à une perfection plus grande : « La Joie est le passage de l’homme d’une moindre perfection à une plus grande ». Cette dimension transitoire de la joie permet de considérer que relève de cet affect tout sentiment concernant la moindre amélioration de son état pouvant donner au malade le sentiment qu’il peut encore être actif. C’est pourquoi être l’auteur du récit de sa propre vie peut contribuer à cet accroissement de puissance par la reprise en main d’une existence que la maladie est en train de ravir. La voie narrative peut donc être une source d’acceptation, si l’on entend par là prendre acte d’une situation sans nécessairement l’approuver ou la justifier, mais essentiellement pour la comprendre, la prendre avec soi, pour mieux ensuite s’en libérer en agissant de manière adaptée pour tenter d’enrayer les mécanismes qui pourraient nous détruire.
En conclusion :
Être malade renvoie donc d’abord à une expérience vécue et la maladie ne se réduit pas à ses signes objectifs, signes qui peuvent permettre de dire à une personne qu’elle a une maladie. Mais réduire ainsi la maladie c’est oublier que la traiter, c’est aussi prendre en charge le malade, c’est-à-dire une personne affectée non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit, puisque corps est esprit ne sont peut-être finalement qu’une seule et même chose. Accompagner le malade signifie donc aussi l’aider à être malade et par conséquent l’aider à accepter la maladie. Cette acceptation ne relève en rien de la soumission à un mal auquel on s’abandonnerait sans résistance, bien au contraire. Accepter, ce n’est pas se résigner, ce n’est pas non plus approuver aveuglément. Il s’agit plutôt ici de prendre acte d’une situation, d’assumer une condition, celle de la personne malade, afin de permettre l’expression de toutes les forces de résistance qui peuvent se mobiliser pour empêcher la destruction du corps. Ces forces qui désignent ce que Spinoza nomme conatus, effort pour persévérer dans l’être, pour accroître sa puissance d’être et donc d’agir, sont capables de s’investir d’une multiplicité de manières et dans une grande diversité de chemins. Elles sont capables de mettre en œuvre des stratégies complexes et originales pour se sauver de ce qui s’oppose à leur déploiement. C’est pourquoi la voie purement rationnelle n’est pas la seule possible pour parvenir au salut, accepter peut aussi passer par l’appropriation de ce qui ne dépend pas de nous en l’intégrant dans un récit dont on est l’auteur. Accompagner le malade, c’est donc accompagner ces forces de résistance qui sont présentes en tout individu parce qu’il est un individu, et tant qu’il est encore un individu le conatus est toujours et nécessairement présent en lui puisque, par définition, c’est le conatus qui maintient cette individualité. Il y a donc en toute personne, même la plus vulnérable, une puissance à cultiver et c’est cette puissance dans la vulnérabilité qu’il faut sans cesse s’efforcer de stimuler pour permettre au malade d’accéder à la joie, c’est-à-dire de ressentir cet affect que quiconque peut ressentir dès qu’il sent sa puissance augmenter. C’est cette puissance dans la vulnérabilité qu’il faut cultiver pour faire progresser le malade vers une certaine forme d’autonomie, mais une autonomie qui n’a rien à voir avec la totale indépendance, une autonomie qui relève plutôt de la vie selon la seule nécessité de sa nature, ce qui, chez les hommes, ne s’oppose à la nécessaire dépendance qui les relie les uns aux autres. Les hommes qui vivent selon la seule nécessité de leur nature sont des hommes dont la puissance s’enracine dans la conscience qu’ils ont de leur vulnérabilité, d’une vulnérabilité acceptée et qui nécessite que nous nous rendions tous utiles les uns aux autres. C’est pourquoi l’autonomie vers laquelle il faut accompagner le malade, mais que nous devons également tous viser, ne peut être qu’une autonomie solidaire, c’est-à-dire une autonomie qui consiste à vivre selon la nécessité de notre nature pour soi, avec et pour les autres hommes.
Pour aller plus loin :
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS, Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de ManagerSante.com
Biographie de l'auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il a publié plusieurs ouvrages :
– le 25 Septembre 2018 intitulé ” Ce que peut un corps”, aux Editions l’Harmattan.
– un ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un dernier ouvrage, sous la Direction de Jean-Luc STANISLAS, publié le 04 Octobre 2021 chez LEH Edition, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins.
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019