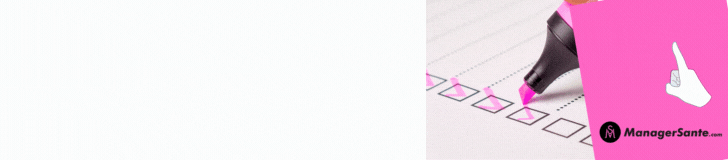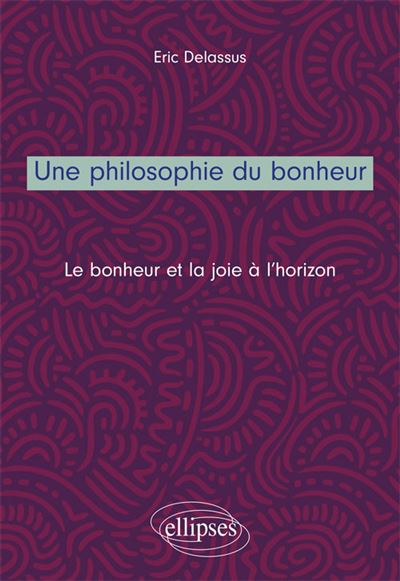N°74 Janvier 2024
Nouvel Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School).
Il est co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Octobre 2021 chez LEH Edition, sous la direction de Jean-Luc STANISLAS, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins
Intervention prononcée à l’ENS de Lyon pour le séminaire organisé dans le cadre du Collège Internationale de Philosophie par Julie Henry : Relire l’éthique en santé à l’aune d’une anthropologie spinoziste : Philosophie de l’âge classique et médecine d’aujourd’hui.
L’acceptation est souvent assimilée à la résignation, c’est-à-dire à une attitude pas- sive de soumission. Or, si l’on comprend l’acceptation comme l’acte par lequel celui qui comprend ce qui lui arrive en prend acte, sans pour autant l’approuver, mais au contraire pour mieux s’y opposer, elle peut apparaître comme le chemin qu’il faut nécessairement emprunter pour mieux résister aux assauts des causes externes qui pourraient nous dé- truire. C’est en ce sens qu’être malade, qui ne signifie pas tout à fait la même chose qu’avoir une maladie, nécessite que soit emprunté un tel chemin. Dans la mesure où la compréhension des causes qui nous déterminent nous rend nécessairement plus puis- sants, notre conatus, cet effort par lequel nous persévérons dans l’être, ne peut que se trouver renforcé par l’acceptation en nous donnant la « force d’âme » indispensable pour appréhender la maladie avec une certaine équanimité. Reste à définir les modalités d’une telle compréhension. Si pour le philosophe, cela passe par la connaissance intuitive, pour l’ignorant qui en reste à la connaissance imaginative, cela passe certainement par le récit qui permet au malade d’être l’auteur d’une reconfiguration cohérente des événements heureux ou malheureux qui jalonnent son existence.

Si la maladie est considérée comme une « chose de fortune » selon Spinoza, elle n’est donc pas en notre pouvoir
Si j’ai choisi de traiter certaines questions d’éthique médicale à partir de l’œuvre de Spinoza, c’est avant tout parce que Spinoza lui-même m’a, en un certain sens, invité à le faire en présentant ainsi l’utilité de sa doctrine dans le scolie qui clôt la seconde partie de l’Ethique :
…elle enseigne comment nous devons nous comporter à l’égard des choses de fortune, autrement dit, de celles qui ne sont pas en notre pouvoir, c’est-à-dire, à l’égard des choses qui ne suivent pas de notre nature ; à savoir attendre et supporter d’une âme égale l’un et l’autre visage de la fortune : parce que tout suit du décret éternel de Dieu avec la même nécessité que de l’essence du triangle, il suit que ses trois angles sont égaux à deux droits.[1]
Par « choses de fortune », il ne faut pas entendre ici des choses qui se produiraient par hasard et qui ne seraient déterminées par aucune cause précise, des choses qui pourraient se produire ou ne pas se produire. Dans la mesure où la philosophie de Spinoza est un déterminisme, tout ce qui se produit est nécessaire. Aussi, si l’on peut parler de choses contingentes dans la nature, il ne faut pas pour autant opposer le contingent au nécessaire, mais y voir une certaine manifestation de la nécessité naturelle. En effet, il faut distinguer deux expressions de la nécessité, celle qui relève des causes internes, ce qui s’inscrit dans la nature d’une chose et ce qui relève des causes externes, c’est-à-dire ce qui résulte de l’affection d’une chose par une autre chose. Par conséquent, si la maladie peut être considérée comme une « chose de fortune », c’est parce qu’elle n’est pas inscrite dans la nature de l’homme, elle ne peut provenir que de causes externes. Elle obéit cependant à des lois naturelles constantes et nécessaires. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai qualifié, dans mon livre sur l’éthique médicale revisitée à la lumière de l’éthique spinoziste, la maladie, comme la mort d’ailleurs, d’accident inévitable. La mort et la maladie sont des accidents car ni l’une, ni l’autre ne sont inscrites dans la nature de n’importe quel être vivant, mais inévitable parce que la condition de tout être vivant, le rapport qu’il entretient avec son milieu, le conduit nécessairement à subir des agressions extérieures qui finiront toujours par venir à bout de lui malgré sa tendance à persévérer dans l’être qui, comme nous le développerons un peu plus loin, lui permet de résister autant qu’il peut à toutes les affections qui pourraient le détruire.
Cette nécessité relève donc de ce que Spinoza nomme le « décret éternel de Dieu ». Il convient également ici de préciser le sens à donner à cette expression. On pourrait croire, en effet, par l’utilisation du mot « décret », qu’il s’agit de la décision d’un Dieu personnel qui imposerait ses caprices aux hommes comme un despote fait subir à ses sujets les effets de son bon plaisir. Or, une telle conception de Dieu, Spinoza la remet en cause dans toute son œuvre. L’idée d’un Dieu qui gouvernerait le monde comme un monarque son royaume, n’a absolument rien à voir avec le Dieu-Nature qui nous est présenté dans la première partie de l’Ethique. Il faut donc entendre par décret la seule expression et la manifestation de la nécessité naturelle. Les choses de fortune, comme, par exemple la maladie, sont des phénomènes naturels comme les autres obéissant à des lois constantes et nécessaires. Par conséquent, la maladie n’est pas un mal en soi, elle n’est un mal que du point de vue de l’homme qui en souffre et qui ressent parfois un sentiment d’impuissance face aux causes externes qui l’affectent. Si la maladie est un mal pour l’être vivant qui en est affecté, on peut dire, en un certain sens, s’il s’agit, par exemple, d’une pathologie virale, qu’elle est un bien pour le virus qui vit aux dépens de l’organisme qu’il infecte.
On peut donc s’autoriser à penser que la maladie occupe l’une des premières places parmi les choses de fortune qui ne sont pas en notre pouvoir et qu’il est difficile pour beaucoup d’entre nous de supporter d’une âme égale. La maladie, lorsqu’elle nous affecte, vient semer le trouble dans toute notre vie, elle ne se limite pas à de simples symptômes objectivement décelables, mais ses effets viennent s’insinuer dans les plus petits interstices de notre existence. C’est pourquoi d’ailleurs, on n’a pas simplement une maladie, on est malade, ce qui ne signifie pas tout à fait la même chose. Ce caractère, à la fois pesant et envahissant, de la maladie avec son cortège d’inconfort, de souffrance mais aussi de peur et d’angoisse, fait que, lorsque nous n’adoptons pas face à elle une attitude de déni, nous la percevons et l’interprétons comme étant de l’ordre de l’injustice ou de l’absurdité, ce qui la rend en général encore plus difficile à supporter. Or, précisément, si la philosophie de Spinoza nous apprend à « supporter d’une âme égale » tous les aspects de la fortune, elle est donc en mesure d’apporter une aide tant au malade qu’à ceux qui le soignent et à tous ceux qui ont à l’accompagner d’une manière ou d’une autre. Tâche qui, pour le moins, n’est pas aisée, puisqu’il s’agit d’aider le malade à accepter ce qu’en même temps, il refuse, de lui apprendre à supporter ce à quoi il se doit de résister.

Être malade, accepter pour résister
Il va donc nous falloir ici expliquer ce que signifie en termes spinozistes « être malade » et montrer en quoi l’acceptation accroit la puissance du malade et lui permet de ressaisir une existence dont il a le sentiment qu’elle lui est ravie par la maladie.
Aussi, ai-je choisi pour titre à mon propos : Être malade, accepter pour résister, car il me semble que cette idée est au cœur même des enseignements que la pensée de Spinoza peut nous apporter sur ce sujet.
Lorsque nous parlons de la maladie, nous avons souvent coutume d’employer deux expressions que nous utilisons parfois indifféremment, être malade ou avoir une maladie. Cependant, si on les analyse de manière plus approfondie, on s’aperçoit assez rapidement que ces deux formulations ne sont pas interchangeables et qu’elles ne renvoient pas exactement au même type de réalité.
On peut, en effet, avoir une maladie sans être malade et peut-être même peut-on être malade sans avoir de maladie bien précise. Ainsi, lorsque la maladie est asymptomatique, le patient n’est pas malade au sens où il ne se perçoit pas comme tel et ne vit pas sa condition comme celle d’une personne malade. C’est d’ailleurs une difficulté pour les soignants de devoir prendre en charge ce type de situation, surtout si les traitements qui doivent ensuite être administrés au patient présentent des effets secondaires qui le rendront effectivement malade.
Que répondre, en effet, à un patient qui reproche à son médecin, après sa première chimiothérapie, qu’il l’a rendu malade alors que pour lui, auparavant, tout allait bien ?
On peut considérer qu’auparavant, il avait une maladie, la tumeur détectée ou des résultats d’analyse attestant une infection en sont la preuve, mais qu’il n’était pas malade. Il n’est même pas totalement sans fondement de dire que c’est parfois la médecine qui rend malade le patient, parce qu’elle découvre la maladie avant lui et qu’en lui apprenant qu’il est atteint de telle ou telle pathologie elle lui fait découvrir ce qu’il était bien heureux d’ignorer jusque- là. Ainsi, même avant d’avoir ressenti les premiers symptômes, le patient devient malade parce qu’il se sait malade, et, de celui qui a une maladie, il devient celui qui est malade. Tout simplement parce que la perception qu’il a de son corps s’est trouvée modifiée et que son esprit, qui n’est autre que l’idée de son corps, se trouve alors affecté par cette prise de conscience.
Être malade, c’est donc, tout d’abord, changer d’état d’esprit. Si l’on prend cette expression à la lettre, cela signifie tout simplement que l’esprit du malade n’est plus dans le même état, avant de découvrir qu’il est malade et après. Qu’il découvre sa maladie parce que le médecin la lui annonce ou qu’il la découvre de lui-même par les symptômes qu’elle manifeste, cela, à ce niveau, revient au même. Et si l’on se réfère à la définition que donne Spinoza de l’esprit comme idée du corps, devenir malade pour ensuite être malade, c’est nécessairement passer d’une idée du corps à une autre :
Tout ce qui arrive dans l’objet de l’idée constituant l’Esprit humain doit être perçu par l’Esprit humain, autrement dit, il y en aura nécessairement une idée dans l’Esprit : C’est-à-dire, si l’objet de l’idée constituant l’Esprit humain est un corps, il ne pourra rien arriver dans ce corps qui ne soit perçu par l’Esprit[2].
Être malade, c’est, en effet, d’abord se sentir malade, c’est pour reprendre les termes de Georges Canguilhem, sentir que quelque chose ne va pas, la maladie pour Georges Canguilhem c’est « ce qui gêne les hommes dans l’exercice normal de leur vie et dans leurs occupations et surtout ce qui les fait souffrir[3] ».
Pour parler en termes spinozistes, être malade, c’est donc sentir sa puissance d’être diminuer. Autrement, dit être malade relève du vécu et de la subjectivité, tandis qu’avoir une maladie relève plus de l’observation d’un donné objectif qui fait que la maladie peut alors, si elle reste discrète et ne se fait pas sentir, rester une abstraction, être perçue comme une réalité extérieure à la personne malade. Être malade, c’est au contraire ressentir en soi, une diminution de puissance. La maladie n’est plus perçue comme une abstraction, elle est éminemment concrète, elle accompagne tous les instants de notre vie et nous sommes obligés de la subir parfois en permanence.
Interprété en termes spinozistes, être malade consiste donc en une diminution de la puissance du conatus, de cet effort pour persévérer dans l’être qui caractérise tout individu et qui est au fondement même de son unité. Être malade, c’est donc être affecté par une ou plusieurs causes externes qui viennent diminuer notre puissance parce qu’elles viennent semer le trouble dans la structure même de notre individualité. En effet, tout comme la mort, la maladie ne vient jamais du dedans, mais du dehors, elle est toujours la conséquence des causes externes qui viennent perturber le fragile équilibre qui maintient l’unité des différentes parties qui nous constituent. Cela dit, la maladie, considérée sous cet angle, apparaît comme une dimension incontournable de la condition humaine dans la mesure où l’homme, comme tout individu d’ailleurs, est en permanence affecté par des causes externes dont certaines peuvent, certes, augmenter sa puissance, mais dont un grand nombre l’agresse en permanence et finit toujours par venir à bout de lui :
La force par laquelle l’homme persévère dans l’exister est limitée, et la puissance des causes extérieures la surpasse infiniment[4].

Devenir malade : comme dépossédé d’une partie de soi
Pour éviter tout contresens, il convient d’ailleurs de préciser que ce que Spinoza désigne par le terme de conatus n’a rien à voir avec un quelconque élan vital, pas plus qu’il ne consiste dans la puissance d’une volonté dont serait détenteur le sujet. La traduction par effort pourrait, en effet, conduire à une interprétation volontariste du conatus qui serait en totale contradiction avec le véritable sens de ce terme dans la pensée de Spinoza. Une interprétation vitaliste tout autant que volontariste du conatus relèverait donc du pur et simple contresens. Le conatus n’est rien d’autre que l’effet mécanique de la convenance entre les différentes parties qui constituent un individu plus grand et plus complexe.
En ce sens devenir malade consiste à se trouver comme dépossédé d’une partie de soi. Alors que jusqu’à présent le corps avait le sentiment de fonctionner de manière relativement autonome et de n’obéir qu’à la seule nécessité de sa nature, il s’aperçoit soudain qu’il est un corps affecté, un corps soumis à des causes externes qui viennent déranger son fonctionnement et qui pourraient même aller jusqu’à le détruire. La personne qui devient malade découvre alors la vulnérabilité humaine qui est la conséquence de sa servitude. Parce que l’homme, comme toute chose singulière, est soumis à des causes externes, il est sans cesse menacé d’être détruit par d’autres individus qui peuvent venir ébranler l’équilibre interne de sa complexion qui est l’origine de son conatus. Prendre ainsi conscience de sa vulnérabilité en découvrant que l’on est malade, parce que l’on souffre dans sa chair, ou parce que le médecin nous l’apprend, présente le plus souvent une dimension cataclysmique. Alors que jusqu’à présent la vie s’était déroulée apparemment sans encombre, nous découvrons soudain que nous ne sommes plus maîtres du jeu, que cette puissance que nous sentions s’exprimer en nous se trouve désormais soumise à des puissances autres qui sont susceptibles de la détruire.
En conséquence, la maladie n’est jamais simplement une affection du corps, elle se manifeste aussi, comme nous l’avons souligné plus haut, sous la forme d’affects concernant l’esprit. Non pas que le corps agirait sur l’esprit et que la maladie dont il est atteint viendrait contaminer nos idées. Dans la mesure où l’esprit est l’idée du corps en acte, il ne peut y avoir d’action du corps sur l’esprit ou de l’esprit sur le corps puisqu’il s’agit en réalité de la même chose envisagée selon deux attributs distincts :
Le corps ne peut déterminer l’Esprit à penser, ni l’Esprit déterminer le Corps au mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d’autre (si ça existe) [5].
En revanche, dans la mesure où toute affection du corps à son corrélat dans l’esprit et réciproquement, on peut comprendre en quoi la maladie même si elle semble tout d’abord toucher le corps peut également se manifester sous la forme d’affects qui peuvent venir troubler l’esprit, c’est-à-dire l’idée que nous nous faisons de ce corps qui n’est autre que celui que nous ressentons. Le corps dont l’esprit est l’idée, n’est pas en effet le corps en général, le corps objet, mais le corps vécu, le corps propre. Comme l’écrit Spinoza, il s’agit d’un corps existant en acte :
L’objet de l’idée constituant l’Esprit humain est le Corps, autrement dit une manière de l’Étendue précise et existant en acte, et rien d’autre [6].
Mon esprit n’est autre que l’idée ce corps que je vis et que je ressens à chaque instant de mon existence. Mon esprit actuel n’est autre que l’idée de ce corps tel qu’il est actuellement, et à tout changement en mon esprit correspond une modification de mon corps et réciproquement [7].
Lire la suite de cet article, le mois prochain.
Pour aller plus loin :
[1] Spinoza, Éthique, seconde partie, Scolie de la proposition XLIX, Texte et traduction nouvelle par Bernard Pautrat, Seuil, Paris, 1988, p. 195.
[2] Ibid., p. 115.
[3] Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, PUF, 10° édition, « Quadrige », Paris, 2005, p. 52.
[4] Spinoza, Éthique, quatrième partie, Proposition III, Op. cit., p. 349.
[5] Spinoza, Éthique, troisième partie, Proposition III, Op. cit., p. 207.
[6] Spinoza, Éthique, seconde partie, Proposition XIII, op. cit., p. 117.
[7] Lire sur ce sujet mon article : « Qu’est-ce que l’idée d’un corps en acte », Revue de l’enseignement philosophique, 63e année – Numéro 4, juin 2013 – aout 2013, p. 43 – 48.
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS, Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de ManagerSante.com
Biographie de l'auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il a publié plusieurs ouvrages :
– le 25 Septembre 2018 intitulé ” Ce que peut un corps”, aux Editions l’Harmattan.
– un ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un dernier ouvrage, sous la Direction de Jean-Luc STANISLAS, publié le 04 Octobre 2021 chez LEH Edition, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins.
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019