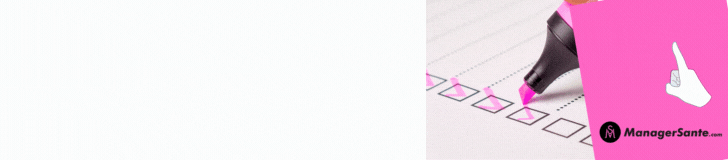Nouvel article d’ Agnès VANDEVELDE-ROUGALE, docteure en anthropologie et sociologie, chercheuse associée au LCSP à Université Paris Cité, extrait de son dernier ouvrage intitulé « Mots & illusions : quand la langue du management nous gouverne », publié aux éditions 10-18 (2022) .
Elle est membre du Comité de rédaction de la revue ¿Interrogations?, membre du Conseil d’administration du Réseau international de sociologie clinique et du comité de recherche « sociologie clinique » de l’Association internationale de sociologie.
La question de la puissance des mots retient l’attention des dominants comme des dominés. D’ailleurs, au premier abord, ce sont des mots, davantage que des formes grammaticales, qui sont perçus comme emblématiques d’un jargon managérial et utilisés ou critiqués à ce titre, même si ce jargon se caractérise aussi par l’emploi de certaines formes verbales et syntaxiques telles que l’indicatif plutôt que le conditionnel, l’affirmation plutôt que la négation, l’exclamation plutôt que l’interrogation…
La presse managériale se fait régulièrement l’écho de ces mots, en relevant ceux – en particulier néologismes et anglicismes – qui sont perçus comme caractéristiques du langage corporate et en proposant d’en clarifier le sens. Cela met en lumière le fait que le langage est toujours en mouvement[1], mais manifeste simultanément l’idée, largement partagée, que les significations des mots pourraient être fixes ou fixées.
Or les mots définissent des catégories de pensée, liées aux représentations qui s’y attachent, et celles-ci peuvent varier en fonction des locuteurs et des situations. Les mots peuvent alors alimenter des malentendus quand les représentations divergent entre des interlocuteurs sans qu’ils en aient conscience, constituer des terrains de lutte autour de ce que serait le « vrai sens », comme accompagner la diffusion des représentations des dominants. Ces caractéristiques inhérentes à la dynamique langagière contribuent au pouvoir du discours managérial, tant sur les individus et les groupes qu’au niveau sociétal.
Mots et sens ! Entre pari et lutte
La communication repose au quotidien sur un pari implicite, celui du partage d’un référentiel langagier commun. Josiane Boutet[2], sociolinguiste, parle de « contrat social tacite entre les locuteurs ». Elle souligne la dimension symbolique des mots, qui contribuent aux représentations qu’on construit du réel, et leur dimension pratique, en tant que « guides pour la perception du monde et pour l’action ». Ces deux dimensions peuvent faciliter la communication mais aussi alimenter les malentendus et les luttes de pouvoir, quand les locuteurs ne s’accordent pas sur le sens. Alice Krieg- Planque[3], chercheuse en information-communication, pointe ainsi qu’« une bataille sémantique permanente oppose les pouvoirs dominants qui tentent d’imposer leurs mots à des contre-pouvoirs qui essayent de développer et diffuser un vocabulaire alternatif, chacun visant à créer des catégories pour penser le monde ». Cette lutte de pouvoir peut aussi se manifester par une appropriation des mots de la lutte, tant par les dominés (par exemple quand ils associent une valeur positive à des catégories sociales habituellement dévalorisées[4]), que par les dominants, qui instrumentalisent la critique pour maintenir leur domination.
L’une des caractéristiques du capitalisme est sa capacité à intégrer les critiques sociales à son profit[5]. La notion de responsabilité sociale ou de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, par exemple, apparaît pour le moins ambiguë. Le chercheur en sciences de gestion Yvon Pesqueux[6] relève quelle offre « le support d’une vision managériale fédératrice » qui confond « responsabilité sociale et réceptivité sociale » : une action RSE doit être perçue, reconnue comme telle ; elle vise un public (par exemple, les consommateurs ou les salariés) davantage qu’elle ne s’inscrit dans une définition collective des priorités*[7]. La prise en compte de problématiques sociales, environnementales et de bonne gouvernance, qui répond à la quête de sens des individus, s’inscrit dans des stratégies de positionnement concurrentiel (y compris dans le cadre des stratégies de « marque employeur* [8]» pour attirer des talents) et de gestion des risques.
En matière langagière, l’absorption de la critique sociale peut se traduire par une diminution de la portée de certains mots quand ils sont repris par le langage managérial. La sociologue Laure Bereni[9] a ainsi montré que « la transformation d’une contrainte juridique, l’anti-discrimination, en catégorie managériale, la diversité, au cours de la seconde moitié des années 2000 en France […] a reposé sur l’euphémisation des dimensions juridiques et militantes du cadre antidiscriminatoire au profit d’une définition imbriquée dans la logique de l’intérêt économique ». Et comme souvent en matière de valeurs prônées dans la communication institutionnelle des organisations, elle a constaté « l’écart entre l’ambition des discours affichés et le caractère très partiel des mesures effectivement mises en œuvre pour prévenir et sanctionner les discriminations».
Pour autant, l’intégration de la critique par le management n’est pas sans effet. L’évolution des discours s’accompagne aussi de modifications des pratiques, même si elles sont moins ambitieuses ou moins rapides que ce que pourraient laisser imaginer ou espérer ces discours. Ainsi, des propos et comportements sexistes courants dans le monde du travail il y a vingt ans en France sont aujourd’hui moins tolérés, même s’ils n’ont pas disparu, et les managers comme les managés y sont davantage sensibilisés. La rhétorique de la diversité trouve un écho dans des actions militantes de sensibilisation et de prévention au sein de certains secteurs d’activité depuis plusieurs années. C’est par exemple le cas en archéologie, où l’association Archéo-Éthique et le collectif Paye ta truelle créés en 2017 ont engagé des actions pour lutter contre le sexisme et les discriminations, mais aussi contre leur déni, entre autres au moyen de la signature d’une « charte de bonne conduite » engageant tant les responsables des chantiers archéologiques que les fouilleurs[10]. L’inscription par le législateur des propos ou comportements sexistes dans l’article du Code du travail définissant le harcèlement sexuel[11], entré en vigueur en mars 2022 en France, devrait conforter ces évolutions.
Des mots mobilisateurs
Le management vise la conduite des individus dans des actions collectives, et certains mots semblent être de puissants outils pour mobiliser les acteurs. C’est notamment le cas de mots ou expressions qui associent activités professionnelles et valeurs sociétales, tels que « justice » pour la magistrature ou « soin » pour les soignants. Ces mots, qui disent des idéaux, mobilisent les individus au service de ceux-ci, jusqu’à amener les plus consciencieux à s’investir toujours plus, y compris pour réduire l’écart entre discours et pratiques, au risque du burn-out. Les propos sur le mal-être au travail peuvent révéler cette tension entre idéal (matérialisé dans des mots ou expressions-clés) et réalité de l’activité professionnelle. Parmi d’autres, on peut citer l’allocution de rentrée du procureur général près la Cour de cassation François Molins[12] en janvier 2022, qui montre le pouvoir mobilisateur de l’idée de justice pour continuer à travailler en dépit du manque de moyens. Il signale « une passion pour la justice qui nous a, peut-être à tort, conduits à accepter trop longtemps ce qui ne devait pas l’être, c’est-à-dire l’insuffisance chronique et l’inadéquation des moyens qui nous sont donnés au quotidien pour remplir nos missions et qui n’ont pu en réalité être menées à bien que grâce au dévouement sans limite des magistrats et des fonctionnaires de justice ».
L’écart entre les mots et la réalité peut conduire certains à s’indigner contre des discours perçus comme mensongers, mais ces discours ne semblent pas perdre toute crédibilité ni tout pouvoir mobilisateur pour autant. L’indignation, en même temps quelle dénonce l’écart, montre aussi le maintien de la croyance en la possibilité d’une concordance entre ce qui est dit et la réalité. Un ingrédient s’ajoute alors pour conforter le pouvoir mobilisateur des mots : le temps et, plus précisément, le futur, avec la croyance en là possibilité d’une concrétisation des discours à l’avenir. Les mots continuent à soutenir l’engagement : on n’y croit plus (pour le présent), mais on y croit encore (pour le futur). Ainsi, trois experts démissionnaires de l’Observatoire national de la qualité de vie au travail (QVT) des soignants clament dans une tribune[13] en janvier 2022 que « la rhétorique ne suffit plus » : ils disent leur indignation face au non-respect des engagements pris par le gouvernement, mais ils manifestent aussi leur croyance dans la possibilité qu’un jour « la QVT passe des discours aux actes ».
Des mots comme supports de croyance
L’éclairage des sciences humaines et sociales sur la croyance aide à comprendre le pouvoir mobilisateur des mots du management. En effet, le discours managérial, qui relève de l’exercice du langage mais aussi de celui du pouvoir, a doublement affaire avec elle. La croyance sous-tend l’exercice du langage : c’est parce que l’on croit qu’un mot peut désigner quelque chose, porte un sens suffisamment partagé, que l’on parvient à communiquer. Alors même qu’aucun mot ne peut parfaitement rendre compte de la réalité, on utilise les mots comme si c’était le cas. En retour, les mots contribuent à façonner la réalité en donnant à celle-ci un support : la matérialité du mot qui s’écrit et se prononce. Les mots portent ainsi avec eux une certaine vision du monde ; ils confortent la croyance dans le pouvoir du langage de dire le réel, mais aussi la croyance dans une certaine vision du réel, qui en dissimule d’autres aspects.
Une croyance repose sur trois éléments essentiels[14] : la parole d’un autre faisant autorité ; un support qui permet de faire le lien avec ce qui ne peut être vu ; l’existence de « non-initiés et mystifiés » ou d’institutions soutenant la croyance, même contredite par la réalité. Par exemple, la croyance en la présence d’esprits peut reposer sur une parole d’autorité (telle celle d’un maître du rituel), des masques rituels qui matérialisent la présence des esprits, et l’existence de cérémonies impliquant des non-initiés qui y croient.
Ces éléments se retrouvent dans le discours managérial. D’une part, il est relayé par une parole d’autorité ; non pas une parole donnée ou révélée, comme dans le cas des religions, mais une parole portée par des figures d’autorité, dominantes dans la société contemporaine (paroles de dirigeants, de managers ou de coachs, écrits d’experts relayés par la littérature et la presse managériale et de développement personnel…). Comme l’a souligné le sociologue Pierre Bourdieu[15], en matière de domination sociale, le pouvoir des mots est intriqué à celui des locuteurs. Le langage managérial tire ainsi un pouvoir certain du fait même d’être associé au pouvoir économique et financier, contribuant réciproquement à la légitimation de ceux qui le mobilisent. Cette dynamique est susceptible de favoriser l’apprentissage et l’emploi de la rhétorique managériale par ceux qui souhaitent être reconnus comme managers ou futurs managers, mais aussi être entendus par les managers.
D’autre part, sa matérialisation dans des supports variés (communication institutionnelle des organisations en mots et en images sur leurs sites Internet, mises en scène dans le cadre d’événements corporate, articles de presse, posts sur les réseaux sociaux…) fait de ce discours un support concret de la croyance. Ainsi, même si la parole a pu perdre de l’importance dans les sociétés modernes, au profit du « visible, où ce qui est cru, ce n’est plus la parole mais des faits, des images, des preuves ou des évidences[16] », des mots peuvent soutenir la croyance comme le font les masques rituels de certaines tribus traditionnelles. C’est par exemple le cas de mots qui expriment des valeurs sociétales (justice, égalité, excellence, bonheur…) et donnent du sens à l’action des individus, ou encore de mots qui font écho à son désir de puissance et de reconnaissance (autonomie, responsabilité, éthique… ).
Enfin, la croyance dans les promesses du discours managérial est soutenue par les institutions et par des non-initiés. On peut penser à l’influence de l’école sur la promotion de l’excellence et du mérite individuel, et sur l’intériorisation par les élèves de la logique d’évaluation. Ou encore, aux dispositifs de conseil en évolution professionnelle accompagnant l’accès ou le retour à l’emploi et mettant l’accent sur « la capacité de développer un projet de soi », proposant ainsi un « encadrement instrumental de la réflexivité biographique » que dénonce le sociologue Marc Glady[17]. On peut également penser aux jeunes diplômés entrant dans le monde professionnel, confiants dans la possibilité d’assurer une qualité de travail à la hauteur de leur ambition s’ils s’en donnent les moyens, indépendamment des moyens qui leur seront octroyés pour travailler. Cette croyance, qui contribue à leur engagement, permet que la croyance en un idéal professionnel reste agissante dans la société, même si des travailleurs plus expérimentés sont conscients du fait que le manque de moyens et la logique productiviste peuvent en contrarier l’atteinte.
« L’acte de croire se construit ainsi en dialectique avec le reste du groupe. Il faut un autre à convaincre pour se convaincre soi-même, d’où également l’importance du prosélytisme », précise l’anthropologue Nathalie Luca[18]. C’est sans doute un des facteurs expliquant que d’anciens cadres deviennent coachs, pour en aider d’autres à fonctionner à des places qu’ils ont quittées, renforçant par-là l’accent sur la maîtrise, la responsabilité individuelle et l’épanouissement personnel… De même qu’un individu peut en mystifier un autre, il peut aussi se mystifier lui- même, dans un clivage entre une part de lui qui souhaite croire et une autre qui, confrontée à la réalité, ne croit plus. Ce clivage produit des effets dans la réalité qui, en retour, alimentent le maintien de la croyance. Frédéric Lambert[19], chercheur en information-communication, parle de « demi-croire », de « soumission consentante » plus ou moins feinte qui permet à chacun de jouer un rôle dans la société et est essentielle au fonctionnement du collectif. Par exemple, jouer le jeu de l’évaluation dite objective au moyen d’indicateurs prédéfinis peut permettre d’obtenir une reconnaissance dans le système managérial, même si on ne croit pas en la pertinence des indicateurs choisis pour évaluer l’activité et son « excellence ». On peut ainsi dénoncer le système de l’évaluation bibliométrique*[20] de la recherche, tout en cherchant à publier dans des revues classées dans l’espoir d’obtenir un poste ou une progression de carrière[21], c’est-à-dire en faisant confiance à un système dans lequel une part de soi ne croit pas ou ne croit plus.
Dans un monde incertain, les promesses de croissance et de maîtrise du discours managérial peuvent être rassurantes, alimentant l’envie de les croire et contribuant à la diffusion des principes gestionnaires et néolibéraux. Ce faisant, le langage managérial participe au façonnage d’un imaginaire[22] partagé, qui donne du sens aux expériences subjectives et aux pratiques sociales. Il joue ainsi un rôle essentiel dans l’organisation sociale contemporaine et en dissimule certains aspects.
Notes :
[1] * En effet, le fait que les mots se déplacent d’un champ à l’autre (comme le mot « résilience », de la physique des matériaux à la psychologie individuelle puis aux organisations) et d’une langue à l’autre (par exemple de l’anglais au français ou vice versa), comme le fait qu’ils aient plusieurs sens ou encore changent de sens au fil du temps ou de la position sociale des locuteurs, relèvent du fonctionnement normal du langage.
[2] J. Boutet, Le Pouvoir des mots, Paris, La Dispute, 2010.
[3] A. Krieg-Planque, « Lutter au sujet du langage fait partie du combat idéologique », entretien avec A. Berthier, Agir par la culture, 2018, https://www.agirparlaculture.be/alice-krieg-planque- lutter-au-sujet-du-langage-fait-partie-du-combat-ideologique/.
[4] J. Butler, Le Pouvoir des mots. Discours de haine et politique du performatif, Paris, éditions Amsterdam, 2004.
[5] L. Boltanski et E. Chiapello, Le Nouvel Esprit du capita¬lisme, Paris, Gallimard, 1999.
[6] Y. Pesqueux, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) comme discours ambigu », Innovations, n° 34, 2011, p. 37-55.
[7] * Par exemple, l’accent peut être mis sur la réduction des emballages de fruits pour préserver l’environnement (visibilité immédiate aux yeux des consommateurs susceptibles d’acheter les produits), sans prendre en compte la question de l’empreinte carbone (en continuant à proposer à la vente des fruits hors saison, produits sous serres chauffées ou importés par bateau ou par avion).
[8] * La notion de « marque employeur » renvoie à la construction d’une image positive d’une organisation auprès de ses salariés comme des candidats potentiels, afin de la rendre attractive pour recruter, encourager l’engagement des salariés dans l’activité et limiter l’absentéisme ou le turn-over. Elle implique d’associer des actions relevant de la « gestion des ressources humaines » (RH) et de la communication.
[9] L. Bereni, « “Faire de la diversité une richesse pour l’entre-prise”. La transformation d’une contrainte juridique en catégorie managériale », Raisons politiques, n° 35, 2009, p. 87-105.
[10] Association Archéo-Ethique : https://archeoethique.wixsite. com/association ; collectif Paye ta truelle : https ://payetatruelle. wixsite.com/projet.
[11] Article L1153-1 modifié par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ LEGIARTI000043893894.
[12] F. Molins, « Allocution de rentrée 2022 », 10 janvier 2022, www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/01/10/fran- cois-molins-allocution-de-rentree-2022.
[13] P. Colombat, É. Galam et M. Sibé, « À l’heure du burn-out et du Covid, la rhétorique ne suffit plus ! », tribune, France Info, 8 janvier 2022 : www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/ tribune-a-l-heure-du-burn-out-et-du-covid-la-rethorique-ne- suffit-plus-l-alerte-des-trois-experts-demissionnaires-de-l-ob- servatoire-national-de-la-qualite-de-vie-au-travail-des-soi- gnants_4909199.html.
[14] O. Mannoni, «Je sais bien mais quand même », dans Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre Scène [1969], Paris, Le Seuil, 1985, p. 9-33.
[15] P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001.
[16] J.-P. Bouilloud, « Du monde de la parole au règne du visible. La revanche de saint Thomas », dans Les Tyrannies de la visibilité. Être visible pour exister ?, dirigé par N. Aubert, Tou¬louse, Érès, 2011, p. 53-76.
[17] M. Glady, « “On va arrêter de se raconter des choses qui ne servent à rien”. Le barrage à la subjectivité dans les pratiques discursives d’accompagnement des évolutions professionnelles », Langage et société, n° 158, 2016, p. 17-34.
[18] N. Luca, « L’entre-deux temps du croire », Nouvelle Revue de psychosociologie, n° 16, 2013, p. 17-35.
[19] F. Lambert, Je sais bien mais quand même. Essai pour une sémiotique des images et de la croyance, Le Havre, Non Standard, 2013.
[20] * Évaluation quantitative basée sur le nombre de publications (bibliométrie de production) et leurs citations (bibliométrie d’impact), privilégiant les publications dans les revues scientifiques internationales, et ignorant certaines dimensions de la recherche (le nombre de publications ne dit rien de l’originalité des travaux d’un chercheur par exemple) comme certaines facettes de l’activité d’enseignant-chercheur (responsabilités pédagogiques, suivi des étudiants…).
[21] B. Soulé, « Les impacts d’une évaluation bibliométrique standardisée : le cas des publications de sciences sociales au sein d’une section universitaire multidisciplinaire », Nouveaux Cahiers de la recherche en éducation, vol. 22, n° 3, 2020, p. 110-131.
[22] F. Giust-Desprairies et C. Faure, Figures de l’imaginaire contemporain, Paris, EAC, 2015.