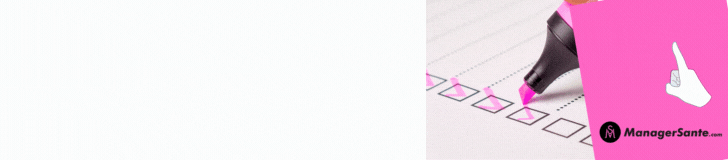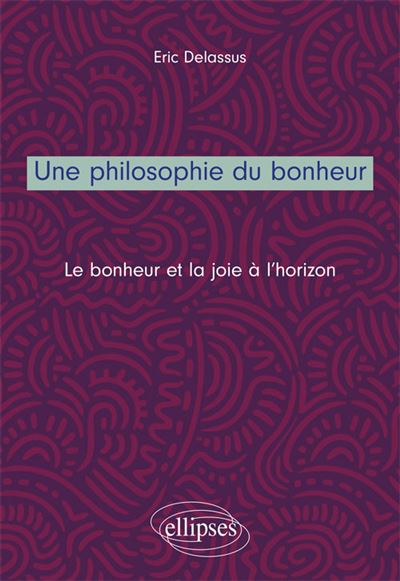N°70 Septembre 2023
Nouvel Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School).
Il est co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Octobre 2021 chez LEH Edition, sous la direction de Jean-Luc STANISLAS, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins
La puissance de chacun augmente d’autant que s’accroît celle des autres hommes
Ainsi, si l’on confronte la lecture des textes politiques à celle de l’Ethique, on remarque que si dans l’état de nature « les gros poissons mangent les petits », en revanche, l’homme guidé par la raison, dont le portrait se dessine progressivement dans l’Ethique, est loin d’être indifférent aux autres hommes et est animé par le souci de leur être utile, car il a compris que sa puissance dépend de celle de ses semblables et qu’elle s’accroît d’autant que la leur augmente. Il est donc animé par le désir de rendre raisonnable le plus grand nombre possible d’hommes, même s’il a conscience de la difficulté à libérer la multitude de la servitude et de la faire accéder à la sagesse :
croire que l’on peut amener la multitude, ou ceux qui sont tiraillés de toutes parts dans le jeu des affaires publiques, à vivre selon le seul précepte de la raison, c’est rêver de l’âge d’or des poètes, c’est-à-dire d’une fable[1].
On peut donc considérer que, si la fonction de la politique est d’inciter les hommes à se conduire comme s’ils étaient vertueux, même lorsqu’ils ne le sont pas, le rôle de l’éthique consiste plutôt à faire en sorte que, dans le cadre des institutions établies le plus grand nombre puisse progresser vers la vertu. Il importe d’ailleurs de souligner ici que l’institution et le maintien de la société civile est comprise comme une nécessité, à tel point d’ailleurs que celle-ci ne peut jamais être dissoute par les hommes en raison de la conscience qu’ils ont de leur faiblesse et de leur vulnérabilité. Spinoza écrit dans le Traité politique :
Et comme la crainte de la solitude habite tous les hommes – puisque personne dans la solitude n’est assez fort pour se défendre et se procurer tout ce qui est nécessaire à la vie – il s’ensuit que les hommes aspirent par nature à la société civile, et ne peuvent jamais l’abolir complètement[2].
Il n’y a donc pas de coupure entre éthique et politique puisque la première exigence de la vie de l’homme que guide la raison est le respect des lois de l’État afin de faire régner la justice et la concorde dans la Cité. En d’autres termes, les hommes ont besoin les uns des autres et ils doivent pour cela se soucier les uns des autres. Peut-on alors s’autoriser à dégager de la philosophie de Spinoza une éthique de la sollicitude ?
Si la réponse à une telle question n’a rien d’évident, c’est que le souci de l’autre dans l’éthique spinoziste est totalement indissociable du souci de soi puisque l’intérêt que chacun manifeste envers ses semblables est tout d’abord déterminé par la recherche de son utile propre. Par conséquent, si chacun cherche à augmenter la puissance et la perfection des autres hommes, c’est avant tout parce qu’il a compris que plus les autres gagnent en perfection plus les conditions seront favorables à l’augmentation de la sienne propre. Peut-on, dans ces conditions, parler d’une réelle sollicitude ? Ne s’agit-il pas plutôt, tout simplement, d’un intérêt bien compris ? Cette question concerne le statut qu’il faut accorder à l’altérité dans la pensée spinoziste. On remarquera d’ailleurs que Spinoza ne parle jamais d’autrui, mais toujours des autres hommes. Il est vrai que les questions de l’altérité ainsi que de l’intersubjectivité ne sont pas celles que se posent la philosophie du XVIIe siècle, mais n’est- il pas permis, malgré tout, d’essayer de dégager une conception implicite d’autrui et de l’altérité de l’éthique spinoziste ?

La dimension relationnelle de l’homme
L’homme, pour Spinoza, est comme tout mode, comme toute manière d’être de la substance, un être relationnel. Tout homme, quel qu’il soit, ne peut exister et se développer qu’en s’inscrivant dans un réseau de liens l’unissant à la nature tout entière. C’est d’ailleurs, comme cela est précisé dans le Traité de la réforme de l’entendement, de la compréhension de ces liens que dépend notre salut. Spinoza affirme en effet dans l’exposé programmatique qui débute ce traité que cette compréhension est le moyen par lequel nous pouvons acquérir une nature supérieure à celle qui est initialement la nôtre, celle qu’il désigne par le terme de servitude dans lEthique.
Voici, ce que Spinoza écrit dans le Traité de la réforme de l’entendement :
Tout ce qui peut être un moyen d’y parvenir (à cette nature supérieure) est appelé un vrai bien ; et le bien suprême est de parvenir à jouir d’une telle nature, avec d’autres individus, s’il se peut. Ce qu’est cette nature, nous le montrerons en son lieu : c’est la connaissance de l’union qu’a l’esprit avec la Nature tout entière[3].
Il est important de préciser ce point pour éviter le contresens qui consiste à interpréter Spinoza comme une sorte de stoïcien qui nous inviterait à vivre en accord avec la nature. Or, pour Spinoza, une telle injonction n’a absolument aucun sens, puisqu’elle suppose qu’une vie en désaccord avec la nature serait possible, ce qui, de son point de vue, est une totale ineptie. Nous sommes toujours en accord avec la nature dans la mesure où nous sommes, quoi que nous fassions, toujours déterminés par ses lois et qu’il est totalement impensable d’échapper aux lois de la nature. En revanche, ces lois ou plutôt leurs effets, nous pouvons les vivre d’une manière plus ou moins satisfaisante, et nous les subissons en général de manière insatisfaisante lorsque nous ne les comprenons pas. Il ne s’agit donc pas de vivre en accord avec la nature, cet accord existe de fait, mais de comprendre en quoi consiste cet accord. Et comme les idées sont corrélées aux affects, cette compréhension sera source de joie et nous permettra de vivre plus heureusement cet accord. Aussi, pour ce qui concerne notre sujet, ce qu’il s’agit ici de comprendre, c’est la nature des liens qui nous unissent aux autres hommes, et cela afin de nous unir à eux de telle sorte que s’établissent entre eux la concorde et l’entraide. Il s’agit de vivre en bonne intelligence, en tous les sens de cette expression, avec les autres hommes, c’est-à-dire en bons termes, mais en bons termes parce qu’on a compris comment nous sommes reliés les uns aux autres, pourquoi nous ne pouvons nous passer les uns des autres.
La conception de l’homme qui se dégage de la pensée de Spinoza est, par conséquent, celle d’un être, ou plutôt d’un étant relié. Un individu humain ne peut vivre qu’insérer dans un tissu relationnel l’unissant à d’autres individus. Chaque homme n’est qu’un mode de la substance, une manière d’être de Dieu, il lui est donc totalement uni et ne peut augmenter sa puissance d’être et d’agir, accroître sa perfection, qu’en entretenant un fort lien de solidarité avec ses semblables. Si, précisément, Spinoza recourt fréquemment à la formule « à l’homme, rien de plus utile que l’homme », c’est parce que, tout simplement, comme nous l’avons déjà souligné, les hommes ne peuvent vivre seuls et sont dépendants les uns des autres. Il importe d’ailleurs de préciser que c’est lorsque les hommes s’unissent de manière fortement solidaire qu’ils parviennent à sortir de la servitude. Dans l’état de nature initial, les hommes sont ennemis les uns des autres, ils s’imaginent que leurs puissances sont en concurrence. Chacun y perçoit la présence de l’autre comme une limitation de sa puissance, ce qui fait que le plus souvent, les hommes croient que pour accroître leur puissance, il suffit de limiter et réduire celle des autres. À l’inverse, dans l’état civil, c’est la conjugaison des forces qui permet aux hommes d’augmenter leur puissance d’être et, par conséquent, d’agir. Mais dans la société politique cette conjugaison de forces se fait encore sous la contrainte des lois, ce qui est un progrès, mais un progrès qui en appelle un autre, celui qui conduit à la vie éthique, à la vie animée par le désir de se rendre utiles aux autres, par le désir d’augmenter sa puissance en contribuant à l’augmentation de celle des autres hommes.
En ce sens, l’éthique spinoziste fait partie de ces éthiques qui remettent en question l’idée d’un homme qui serait, par définition, autonome, autosuffisant et pouvant jouir d’une maîtrise de lui- même le rendant quasiment indépendant du monde extérieur. En tant qu’il naît dans la servitude, l’homme est d’abord un être qui subit, un être soumis à l’action des autres choses par lesquelles il est affecté, ce qui a le plus souvent pour conséquence d’augmenter sa tristesse. En effet, les causes externes par lesquelles l’homme est affecté ont souvent, pas toujours il est vrai, pour conséquence de diminuer sa puissance, d’accroître sa souffrance et de le faire agir, par ignorance, contre son véritable intérêt. Cette dépendance relativement au monde extérieur signifie également que les hommes sont tous dépendants les uns des autres, qu’ils doivent s’entraider pour parvenir à la satisfaction de leur désir à l’intérieur d’une existence limitée. Néanmoins, l’illusion du libre arbitre a pour conséquence de lui faire oublier cette dépendance et le conduit à considérer les autres hommes, non comme des soutiens auxquels il peut recourir, mais comme des concurrents à éliminer, ce qui augmente son degré de servitude au lieu de le diminuer, comme il se l’imagine. Or, dans la mesure où les hommes sont unis à la nature tout entière, ils sont nécessairement unis les uns aux autres et ne peuvent s’affirmer que dans la dépendance réciproque. Il est donc nécessaire que les hommes prennent conscience de cette dépendance pour accroitre leur puissance. Cette connaissance qui participe de celle des causes qui les déterminent rend les hommes plus libres, à la condition qu’elle ne se réduise pas à la seule contemplation de leur impuissance, ce qui en ferait une cause de tristesse :
Quand l’Esprit imagine son impuissance, par là même il est triste[4].
Il est donc nécessaire que cette prise de conscience prenne une forme plus positive et relève d’une connaissance plus rationnelle pour qu’elle puisse procurer de la joie à celui qui est en mesure de comprendre en quoi sa puissance peut augmenter d’autant qu’il est disposé à se lier d’amitié avec d’autres hommes et à les aider. Si cette dépendance est perçue et vécue comme une limitation dont on souhaiterait pouvoir se défaire, elle ne pourra donner lieu qu’à un affect de tristesse, en d’autres termes à une diminution de puissance. En revanche, pour celui qui comprend la nécessité d’une telle dépendance, pour celui qui parvient à en produire une idée adéquate et qui la perçoit comme une expression de la puissance de Dieu et par conséquent comme une perfection, elle ne sera plus vécue comme une faiblesse et la perception qu’il en aura sera d’autant plus joyeuse.
Quand l’Esprit se conçoit lui-même, lui et sa puissance d’agir, il est joyeux : et l’Esprit se contemple nécessairement lui-même quand il conçoit une idée vraie ou adéquate[5].
Comprendre cette dépendance réciproque, n’est-ce pas finalement pour l’homme une manière de parvenir à la saisie intellectuelle de la nécessité de sa propre nature et nourrir ainsi le désir de se rendre librement utile aux autres par la prise de conscience d’une indispensable solidarité entre les hommes ? Ne faut-il pas voir dans cette connaissance l’origine de cette force d’âme que Spinoza définit comme un composé de fermeté et de générosité :
Toutes les actions qui suivent des affects se rapportant à l’Esprit en tant qu’il comprend, je les rapporte à la Force d’Âme, que je divise en Fermeté et en Générosité. Car par Fermeté j’entends le Désir par lequel chacun s’efforce de conserver son être sous la seule dictée de la raison. Et par Générosité, j’entends le Désir par lequel chacun, sous la seule dictée de la raison, s’efforce d’aider tous les autres hommes, et de se les lier d’amitié[6].
Envisagée au travers de cette notion de force d’âme ou de fortitude, la dépendance mutuelle des hommes les uns envers les autres peut plus facilement être perçue comme une source de puissance que comme une faiblesse, car c’est elle qui rend nécessaire l’amour qui unit les hommes et les rend
plus forts. Spinoza souligne déjà dans le Court Traité, cette nécessité de l’amour lorsqu’il explique pourquoi nous ne pouvons nous en libérer et en quoi cela nous est favorable :
Il est donc nécessaire de ne pas en être libéré, car, étant donné la faiblesse de notre nature, nous ne pourrions exister sans jouir de quelque chose à quoi nous unir et par quoi nous renforcer[7].
Cette faiblesse de notre nature vient de ce que chaque homme, comme tout mode d’ailleurs, ne peut exister qu’en étant relié à autre chose que lui-même et que s’il s’unit à des choses périssables, il ne fait que contribuer à l’aggravation de sa faiblesse :
Concernant les périssables (puisque, comme il a été dit, nous devons nécessairement, de par la faiblesse de notre nature, aimer quelque chose et nous y unir pour exister), il est clair qu’en les aimant et en nous unissant à eux nous nous ne renforçons en aucun cas notre nature, parce qu’ils sont eux-mêmes faibles et qu’un invalide ne peut en soutenir un autre[8].
Il est vrai qu’à l’époque au cours de laquelle Spinoza écrit ces lignes, il n’a probablement pas encore élaboré la notion de conatus. Il lui est donc plus difficile de penser la manière dont les hommes peuvent se libérer de la servitude. Il a cependant compris en quoi la condition humaine ne pouvait se comprendre qu’en termes de dépendance, et que le salut, loin de consister dans la suppression de cette dépendance, ce qui est de toute façon impossible, réside plutôt dans la manière dont elle est vécue. La pire des servitudes consisterait d’ailleurs à croire que l’on peut mettre fin à cette dépendance, puisque cette croyance participerait de l’illusion du libre arbitre qui, elle-même, repose sur l’ignorance des causes qui nous déterminent qui est, précisément, à l’origine de la servitude humaine. Aussi, pour mieux vivre cette dépendance, pour mieux appréhender les liens par lesquels notre esprit est uni à la nature tout entière, est-il nécessaire de s’interroger sur le bien-fondé de ce vers quoi notre désir s’oriente. C’est cette question que Spinoza va aborder dans Le traité de la réforme de l’entendement, lorsqu’il affirme que notre salut dépend de ce à quoi nous sommes attachés par l’amour :
En outre, tous ces maux semblaient être nés de ce que toute la félicité ou toute l’infélicité est située en cela seul : dans la qualité, semble-t-il, de l’objet auquel nous adhérons par l’amour[9].
Cette réflexion sur ce que vise le désir, sur ce qu’il prend pour objet va aboutir à la thèse selon laquelle, seul l’amour pour une chose éternelle peut nous satisfaire :
…l’amour pour une chose éternelle, et infinie, nourrit le cœur de la joie seule, la joie même, exempte de toute tristesse, ce qu’il faut fort désirer et rechercher de toutes ses forces[10].

Conclusion provisoire
Cette affirmation de Spinoza nécessite une explication pour éviter toute confusion. On pourrait croire, en effet, que cet amour pour une chose éternelle et infinie est supérieur à toute autre forme d’amour et que par conséquent, il surpasse l’amour pour les autres hommes. En réalité, il n’en est rien, cat cet amour enveloppe l’amour pour les autres hommes et l’amour pour les autres est corrélatif à l’amour pour cette chose éternelle et infinie. Il est impossible à qui n’aime pas les hommes d’aimer cette chose éternelle et infinie et réciproquement. C’est d’ailleurs à cette seule condition que l’amour des hommes les uns pour les autres ne se réduit pas à l’effort d’un invalide pour en soutenir un autre. Pour que l’amour pour les autres hommes ne soit pas vain, il faut nécessairement qu’il procède, d’une manière ou d’une autre, de l’amour de Dieu. Autrement dit, pour se lier aux autres hommes d’un amour durable et efficace, c’est-à-dire par lequel la puissance des uns et des autres se trouve accrue, il faut qu’il procède de la connaissance des liens par lesquels notre esprit est uni à la nature tout entière. Comme la connaissance de ces liens nous conduit à vivre joyeusement cette dépendance nécessaire au tout dont nous ne sommes qu’une infime partie, elle nous permet de vivre plus heureusement nos relations aux autres hommes.
Lire la suite de cet article, le mois prochain.
Pour aller plus loin :
[1]aité politique, Op. cit., chapitre 1, p. 93.
[2]id., chapitre VI, P. 141.
[3] Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Texte établi par Filippo Mignini, Traduction par Michelle Beyssade, P.U.F., 2009, p. 71.
[4] Spinoza, Éthique, Troisième partie, Proposition LV, Op. cit., p. 289.
[5] Spinoza, Éthique, Troisième partie, Démonstration de la proposition LVIII, Op. cit;, p. 299.
[6] Spinoza, Éthique, Troisième partie, Scolie de la proposition LIX, Op. cit., p. 301.
[7] Spinoza, Court Traité, Chapitre V, §5, in Premiers écrits, PUF, 2009, p. 285.
[8]id., p. 287.
[9] Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Op. cit., p. 41.
[10]id.
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS, Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de ManagerSante.com
Biographie de l'auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il a publié plusieurs ouvrages :
– le 25 Septembre 2018 intitulé ” Ce que peut un corps”, aux Editions l’Harmattan.
– un ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un dernier ouvrage, sous la Direction de Jean-Luc STANISLAS, publié le 04 Octobre 2021 chez LEH Edition, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins.
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019