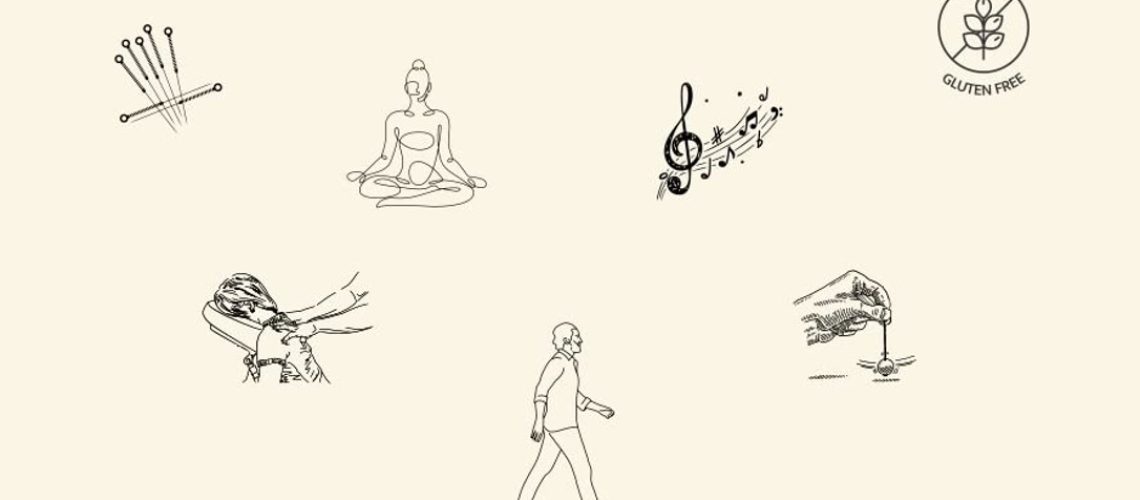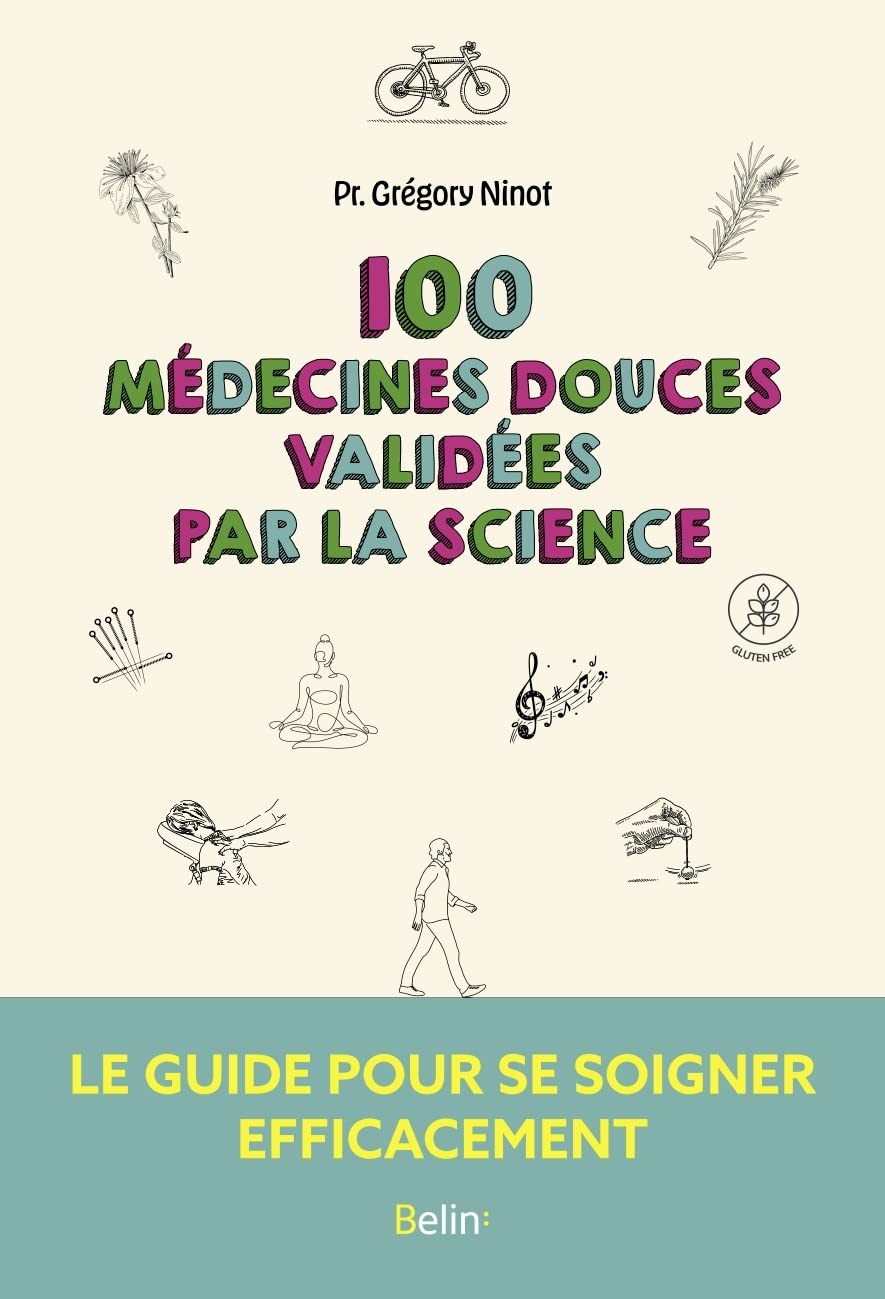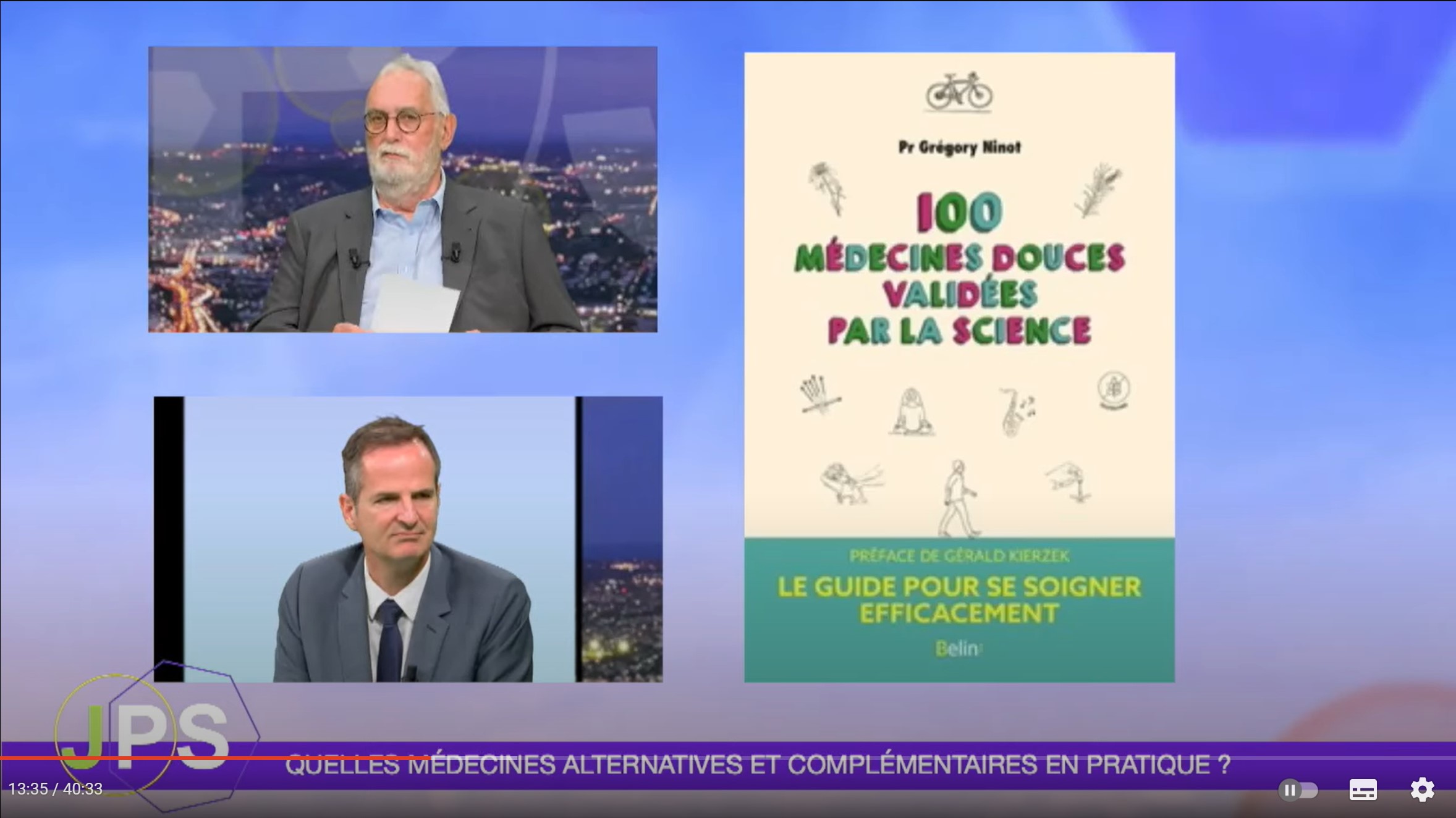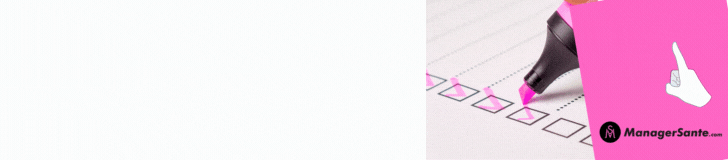Nouvel article du Professeur Grégory NINOT, co-directeur de l’institut Desbrest d’épidémiologie et de santé publique de Montpellier.
Professeur à l’université de Montpellier, chercheur à l’institut du cancer de Montpellier et président de la Non-Pharmacological Intervention Society, il se consacre depuis une trentaine d’années à l’évaluation des médecines douces.
Il est auteur d’un ouvrage publié en 2022 intitulé « 100 médecines douces validées par la science » (Edition Belin), faisant l’objet de la publication d’un extrait introductif dans cet article.
Parler de médecines douces, c’est souvent ne pas savoir pas de quoi on parle. Consciemment ou non, on mélange des techniques, des ingrédients, des disciplines, des préceptes, des habitudes, des approches, des modes de vie, des philosophies, des cultes…
Les exemples sont nombreux: cocktails vitaminiques antifatigue, poudres minérales détox, extraits de plantes facilitant le sommeil, gélules anticholestérol à base de champignon, ampoules fortifiantes d’oligo-éléments, comprimés tonifiants, bagues magnétiques amaigrissantes, gélules anti-âge, crèmes minceur, huiles essentielles anti stress, tisanes apaisantes, thérapies par réalité virtuelle, hypnoses, yogas, programmes de marche nordique, ostéopathies, soins thermaux, méditations d’inspiration religieuse, musicothérapies, acupunctures… et leurs mises en œuvre sont tout aussi variées.
Comment s’y retrouver en l’absence de classification scientifique ment établie et de nomenclature ? Chaque utilisateur a tendance à valider telle ou telle pratique sur la base de son expérience. Si elle est réussie, il s’arroge alors le droit et la compétence de la recommander à ses proches ou sur les réseaux sociaux avec la formule magique : « au pire, cela ne te fera pas de mal ! » Ainsi se propage la prétendue recette miracle. L’expérience singulière devient vérité générale et des communautés se créent, par-delà les frontières et les réglementations.
Vaste nébuleuse
Du côté des autorités sanitaires, la situation n’est guère plus claire. Le ministère de la Santé utilise la formulation « pratiques de soins dites non conventionnelles », sans les lister. Il mentionne sur son site Internet que « ces pratiques sont diverses », parfois appelées « médecines alternatives », « thérapies complémentaires » ou « médecines naturelles ». Il précise que « leur point commun est qu’elles ne sont ni reconnues, au plan scientifique, par la médecine conventionnelle, ni enseignées au cours de la formation initiale des professionnels de santé », ce qui est inexact en tout point à ce niveau de généra- lité. La Haute Autorité de santé (HAS) appelle ces pratiques des «thérapeutiques non médicamenteuses», le Service de santé britannique parle de « médecines alternatives et complémentaires », tandis que le National Center for Complementary and Intégrative Health des États-Unis préfère les termes de «santé intégrative et complémentaire », englobant trois catégories : les produits naturels (herbes, minéraux, vitamines, probiotiques…), les pratiques psychocorporelles (chiropraxie, ostéopathie, acupuncture, tai chi, pilâtes…) et les autres approches (médecines traditionnelles…). Le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis opte, lui, pour l’appellation « médecines complémentaires et intégratives ». Là, si le terme « intégratif » renvoie à une prise en compte de la globalité du patient, rien ne précise de quelle manière les thérapies sont priorisées, ni leur utilisation en fonction du temps, pas plus que leurs toxicités mutuelles. La précision n’est pas davantage de mise avec l’OMS qui propose le concept de « médecines traditionnelles et médecines complémentaires », sans en définir le périmètre. Elle inclut là encore toute sorte de techniques, de méthodes et d’approches thérapeutiques, mais aussi des systèmes médicaux complets du diagnostic à divers traitements invasifs et non invasifs, comme la médecine chinoise. Partout on est confronté à cette vaste nébuleuse où se mêlent des approches diagnostiques, préventives, thérapeutiques, éducatives et philosophiques. De quoi s’y perdre.
Une simple recherche sur Internet permet également de repérer des dizaines d’appellations similaires aux médecines douces : actes de soin, approches non pharmacologiques, autosoins, cures naturelles, dispositifs d’accompagnement, interventions psychosociales, méthodes de réhabilitation, pratiques de santé positive, protocoles paramédicaux, remèdes naturels, soins adjuvants, soins centrés sur la personne, soins de support, et j’en passe. Finalement, la multiplication des appellations quasi synonymes de médecines douces entretient le doute sur la pertinence de ces méthodes pour la santé, et tend à discréditer les professionnels sérieux qui les conseillent et les exercent. Et nous n’en sommes qu’à l’appellation générique. Allons plus loin.
Les confusions augmentent encore si l’on se concentre sur une partie des médecines douces. Prenons l’exemple des disciplines liées aux plantes. On y retrouve pêle-mêle la phytothérapie, l’aromathérapie, la naturopathie, la gemmothérapie, la mycothérapie, l’herbothérapie, pour ne citer que les plus connues. On pourrait faire de même avec les thérapies manuelles, de l’acupuncture à la kinésithérapie en passant par la massothérapie, la kinésiologie, la mésothérapie, la réflexologie, l’ostéopathie, la chiropraxie… Si l’on approfondit une discipline comme la massothérapie en faisant l’inventaire des différentes méthodes de massage à visée de santé, le nombre décuple à nouveau. On dénombre, entre autres, les massage amma, ayurvédique, balinais, biokinergique, cachemirien, californien, Chi Nei Tsang, coréen, drainage lymphatique, do in, Gua Sha, Jin Shin Jyutsu, Kobido, Lomilomi (ou hawaïen), pierres chaudes, oriental, shiatsu, suédois, thaïlandais, Tok Sen, Tui Na…
En résumé, pas facile d’y voir clair. Même un rapport du Sénat publié en 2013 s’y perd entre approches universitaires, disciplines para- médicales, professions de santé, méthodes, techniques, ingrédients, approches diagnostiques, arts de vivre, médecines traditionnelles et pratiques sectaires condamnées[1]. À se demander à qui profite le flou… En tout cas, pas à ceux et celles qui ont besoin d’être guidés dans leurs choix et leurs pratiques de santé.
En finir avec l'essai-erreur
Sans information fiable, l’utilisateur des médecines douces en est réduit à trouver par lui-même la solution qui lui convient le mieux par la multiplication d’essais-erreurs. Que de pertes de temps, de déconvenues, d’argent dépensé inutilement, d’errances thérapeutiques desquelles chacun pourrait pourtant se prémunir s’il trouvait sans tarder la ou les méthodes adaptées à son problème de santé. Dans un monde numérique où la désinformation et la publicité font des ravages, cela devrait même s’apparenter à un droit pour en finir avec des tâtonnements ayant coûté la vie à trop de personnes et ayant eu trop de séquelles pour d’autres. Cela ne se termine bien sûr pas toujours de façon aussi tragique, mais la prolifération des offres assorties de conseils plus ou moins bien intentionnés, entretient la mécanique de l’essai-erreur.
L’autre logique perverse est celle du témoignage, du retour d’expérience, dont le plus fréquemment entendu est : « cela me fait du bien ». Un avis subjectif qui est trop souvent compris comme incontestable. En s’appuyant exclusivement sur des sélections de témoignages, on s’expose à des leviers pseudo-scientifiques, aux erreurs de raisonnement et aux biais méthodologiques, volontairement ou non. Sans remettre en question la bonne foi des témoins, les raccourcis pour croire à la généralisation de l’efficacité d’une méthode de soin deviennent évidents. Juxtaposez une recette traditionnelle ou inventée contre un problème de santé, un mécanisme d’action biologique utilisant des termes complexes et vaseux et une référence bibliographique trouvée sur Internet : une nouvelle médecine douce est née. Reste à partager quelques témoignages triés sur le volet à des médias avides de nouveauté et de spectaculaire, et le tour est joué. Plus c’est gros, plus cela paraît défier un complot ayant voulu cacher la thérapie miracle, plus cela passe. Avec le concours d’influenceurs efficaces, la rumeur de guérison devient alors virale. Rien n’y fait et surtout pas la parole d’un expert qui s’évertue à décortiquer la complexité d’un phénomène et termine souvent son discours par les incertitudes qu’il reste à lever. Face à la parole percutante d’un patient satisfait de la thérapie, il est désarmé.
Sans évaluation, les médecines douces resteront ces sujets polémiques sur lesquels s’opposent les « pour » et les « contre ». Ces derniers les assimileront à des placebos en rappelant que l’histoire de la médecine a connu de multiples falsifications tandis que les « pour » citeront de leur côté des cas de guérison spontanée de malades condamnés. Parole contre parole, croyance contre croyance, opinion contre opinion. Avec en filigrane le fait que les médecines douces attirent fréquemment des individus friands d’explications paranormales, de témoignages douteux, d’amalgames improbables ou de manipulations en tout genre. Tout cela compromet les chances d’intégration de pratiques comme méthodes conventionnelles au sein de parcours de soins dans un secteur médical soumis à de forts lobbys économiques, politiques et corporatistes.
Heureusement, depuis une dizaine d’années, six types d’acteurs font pression pour accélérer l’évaluation rigoureuse des médecines douces. En premier lieu les patients, à travers des associations d’usagers qui exigent de connaître les véritables effets des pratiques, les risques encourus et les contraintes d’usage. Également des professionnels de la santé sérieux qui souhaitent proposer à leurs patients des pratiques fondées sur des preuves scientifiques pour se différencier de médecines non évaluées. Les questions de santé exigent d’être précis, en se basant sur des données fiables, solides et reproductibles. Pour chaque méthode utilisée, les bénéfices et les risques doivent être connus des professionnels, comme des usagers, et le recours à telle ou telle intervention, s’inscrire dans un parcours individuel de santé, ajusté à l’évolution de la situation et aux préférences des patients. Des chercheurs, convaincus aujourd’hui par nombre d’études, sont, quant à eux, désireux de vérifier si des méthodes sont meilleures que d’autres et d’élucider les mécanismes d’actions. Des sociétés savantes encouragent la construction d’arbres décisionnels consensuels de prescription et de bonnes pratiques, c’est-à-dire une grille permettant de décider quelle intervention utiliser, à quel stade d’une maladie et pour quel patient. Au niveau financier, l’Assurance maladie, les mutuelles, les assureurs et les organismes de prévoyance souhaitent préciser les responsabilités de chacun, estimer les risques en cas de problème et rembourser les interventions au meilleur rapport « qualité-prix ». Enfin, confrontés à une transition épidémiologique, sans précédent dans l’histoire de l’humanité à cause du vieillissement de la population et de l’explosion du nombre de maladies chroniques, les politiques s’impliquent comme en attestent différents rapports de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de l’Europe et de l’OMS.
Seules les médecines douces efficaces doivent vous être conseillées et le cas échéant prescrites, en thérapie ou en prévention. Autrement dit, laissons de côté les médecines parallèles, les pratiques occultes, les rituels ésotériques, les sorcelleries, les porte-bonheurs, les talismans, et concentrons-nous sur les pratiques qui ont fait leur preuve pour la santé. Levons les malentendus en ne confondant plus les médecines alternatives (irrationnelles, inexplicables, non reproductibles) et les interventions non médicamenteuses. Ces INM sont des protocoles clairement décrits, fondés sur la science et validés par des données probantes issues d’études cliniques rigoureuses et convergentes. La HAS encourage leur intégration dans le système de santé depuis 2011[2]. Le ministère de la Santé en a fait l’un des objectifs de sa stratégie nationale 2018-2022[3]. L’Europe est au diapason.
L’appellation INM permet de comparer et de hiérarchiser les pratiques. On peut connaître les meilleures et donner des garanties à chaque utilisateur. Une nouvelle gamme de solutions en santé s’ouvre entre les biens et services de consommation courante, d’un côté, et les produits et dispositifs biomédicaux de l’autre. De bonnes habitudes s’installent, une nouvelle culture émerge.
Pourquoi cette appellation ? Le terme « intervention » traduit l’idée d’un protocole précis pour prévenir, soigner ou guérir un problème de santé. On fixe ainsi une durée, un lieu d’application et un contexte d’utilisation par un praticien formé. Quant au qualificatif « non médicamenteuse », il indique des mécanismes d’action non pharmacologiques, faisant appel à d’autres processus biologiques, comportementaux et/ou psychologiques. Les techniques utilisées ne sont en aucune manière invasives comme une chirurgie, une radiothérapie ou une injection de produit. La référence au médicament renvoie au cadre scientifique et sécuritaire qui conditionne leur développement et leur mise sur le marché. En parlant d’INM, on évite le mot « alternatif » qui laisse penser à des pratiques pseudoscientifiques et ésotériques. Les termes « complémentaire », qui donne une impression de secondaire ou d’optionnel, et « intégratif » qui induit une vision tellement large quelle paraît indéterminée, sont également écartés.
Pertinente par sa signification, la dénomination d’« intervention non médicamenteuse » est aujourd’hui largement utilisée dans la littérature scientifique et médicale[4]. Des sociétés savantes, des institutions et des états s’en servent également. Il suffit de taper « non-pharmacological intervention » sur un moteur de recherche pour s’en rendre compte. Plus important encore, ce concept est désormais reconnu et compris par nombre d’usagers appelés à prendre leur santé en main en disposant des meilleurs outils possibles. C’est le cas par exemple avec la Fondation Médéric Alzheimer qui vient de publier en 2021 un Guide pratique pour mieux comprendre, connaître et mettre en œuvre les interventions non médicamenteuses. Un jour, on ne se servira plus que de l’abréviation INM pour les qualifier. Et connaissez-vous la signification exacte d’IBM ou du RER ?
À l’inverse, continuer à parler de médecines douces entretient le flou. Cela les condamne à un statut de médecines au rabais, au mieux accessoires ou de confort. Sortir de cette logique est une évidence pour nombre d’acteurs. Si des INM sont efficaces sur la santé, autant ne plus les confondre avec des médecines alternatives ou parallèles à l’utilité plus que douteuse. Un État a le devoir d’informer ses concitoyens des pratiques les plus sûres et les plus efficaces. Les soins ayant pris le chemin de la science doivent ainsi devenir conventionnels et tous les autres doivent rester non conventionnels.
La science est en mesure de le permettre si on lui donne les moyens. En France, le professeur Bruno Falissard a montré la voie, avec une douzaine d’expertises réalisées avec son équipe INSERM entre 2010 et 2020, à la demande du ministère de la Santé.
Beaucoup l’ont oublié, mais l’efficacité de nombreux traitements biomédicaux utilisés actuellement faisaient polémiques il y a une cinquantaine d’années. C’est l’instauration d’un consensus international de validation clinique en quatre phases qui a permis de lever les doutes et d’écarter les traitements inefficaces et/ou dangereux. Ce processus unique, rigoureux et transparent de développement, de mise sur le marché et de surveillance[5] dont l’essai clinique est la pierre angulaire, a tout changé.
Un essai clinique suit toujours la même procédure encadrée par les autorités sanitaires et les comités d’éthiques. Dans un essai posant l’hypothèse de supériorité d’un traitement innovant sur le traitement de référence, on compare généralement deux groupes de personnes. Le premier groupe prend le traitement expérimental tandis que l’autre, dit « groupe contrôle » reçoit le traitement de référence, un placebo ou rien. Si les résultats du groupe prenant le traitement expérimental sont meilleurs que ceux du groupe contrôle sur des indicateurs biologiques, psychologiques et fonctionnels, et si les effets secondaires ne sont pas majeurs, alors la démonstration de l’efficacité de ce traite- ment est faite. Un lien de causalité est établi entre l’intervention et l’effet obtenu, sachant que toutes les autres conditions sont similaires par ailleurs.
Ce processus consensuel de développement des produits biomédicaux a fait émerger, à la fin du XXe siècle, le courant dit de la « médecine fondée sur les preuves » ou des « données probantes » {Evidence Based Medicine ou EBM)[6], qui s’est généralisé dans le monde de la santé, de la thérapeutique à la prévention. L’EBM s’appuie sur la notion de reproductibilité des faits. Si plusieurs essais cliniques à la méthodologie similaire obtiennent les mêmes résultats, avec des données qui convergent dans le même sens pour un même marqueur de santé sous l’effet d’une intervention similaire auprès de personnes comparables, alors le lien de causalité est confirmé entre l’intervention et ses effets pour la population testée. On peut ainsi obtenir le plus haut niveau de preuve d’une thérapeutique, accordé à la lecture de revues systématiques compilant tous les résultats de toutes les études réalisées dans le monde et vérifiant les bénéfices et les risques d’une intervention de santé avec une méthodologie similaire. Une fois compilés, les résultats sont comparés dans ce que l’on appelle une méta-analyse. Une analyse statistique de la convergence des résultats concernant les différences obtenues entre les groupes testant un traitement expérimental et les groupes contrôle est réalisée. On y pondère les biais méthodologiques et les degrés d’hétérogénéité des populations et des interventions. Si les résultats vont tous dans le même sens, la relation de causalité avec le bénéfice thérapeutique est confortée par le meilleur niveau de certitude : l’effet sera reproductible pour d’autres personnes aux caractéristiques similaires. À l’inverse, des statistiques non significatives signifient que les résultats vont dans des sens opposés et conduiront à ne pas recommander le nouveau traitement.
Le secteur de la santé s’appuie sur la démarche EBM pour prendre de meilleures décisions et ajuster des protocoles éprouvés aux personnes confrontées à un problème de santé. Cette logique rationnelle tenant compte des préférences du patient et de l’expérience du praticien s’applique aujourd’hui aux INM, selon les recommandations de la HAS et de diverses autorités nationales (Haut Conseil de la santé publique, Institut national du cancer…), européennes (Direction générale de la santé) et internationales (OMS). Sociétés savantes et commissions consultatives pour le remboursement de soin s’en servent pour préconiser des interventions auprès d’une population cible car, depuis une vingtaine d’années, des essais cliniques et des méta-analyses accumulent des données probantes indiscutables sur les INM. Ces preuves étaient le chainon manquant pour la généralisation de leur usage. Avec une particularité pour les INM : les essais cliniques pragmatiques. Ce type d’essai vérifie l’efficacité en vie réelle (« effectiveness ») et non l’efficacité en situation optimale de laboratoire (« ejficacy»). La perception des patients est aussi évaluée, qu’ils s’agissent des bienfaits sur la santé ou des effets indésirables. Ces essais pragmatiques imposent ainsi des mesures qualitatives, donc le recueil du vécu des participants. Pour qu’une INM soit déclarée efficace, elle doit ainsi faire la preuve de son bénéfice sur des indicateurs de santé objectifs et perçus par les patients, tout en identifiant ses risques.
Dans la pratique quotidienne, les données probantes ne remplacent évidemment pas le jugement et l’expérience du professionnel et du patient. L’effet thérapeutique du charisme du praticien et du lien qu’il noue avec son patient va de soi. Mais, si ces conditions d’alliance et de confiance sont nécessaires à la réussite de toute thérapie, elles ne sont ni suffisantes, ni reproductibles d’un praticien à l’autre. Une partie du bénéfice incombera toujours à la qualité de la relation avec votre praticien, qui contribue grandement à l’effet placebo, mais le reste relève de l’intervention. Ce « reste », l’INM, est contrôlable et reproductible. Il peut être décrit, comparé et perfectionné en tant que tel. Avec le temps, des études confirment que l’intervention compte plus que la relation personnelle, y compris dans des domaines où celle-ci est très importante, comme les psychothérapies[7]. Dotées de ce type de données qui indiquent de façon précise ce que l’on peut en attendre, les INM sont désormais à considérer comme des médecines conventionnelles, parfois à usage complémentaire d’autres traitements biomédicaux autorisés et parfois en amont dans la prévention ou en aval dans les soins palliatifs de fin de vie.
Au XXe siècle, l’avènement des biothérapies de masse a diffusé une nouvelle conception de la santé. Comprise à partir de sa racine latine sano – qui signifie réparer -, la santé dépendait d’un ensemble ordonné et stable d’organes, de cellules et de gènes. Avec l’espoir que tout organe pourrait être reconditionné, renforcé, transformé, remplacé pour faire fonctionner cette sublime mécanique en cas de perturbation. Cela a ouvert la porte aux prouesses biotechnologiques, du niveau macroscopique avec les chirurgies, et les prothèses artificielles, à celui microscopique avec les médicaments, les radiothérapies de précision et les thérapies géniques. L’attrait pour cette approche a aussi attisé les fantasmes, concentrant tous les efforts de recherche et tous les investissements, mais on a vu ses limites face à des maladies incurables, chroniques et protéiformes, qui continuent leur progression : diabètes, cancers, maladies cardiovasculaires, obésité, arthroses, allergies, asthmes, dépressions, ou maladies neurovégétatives, par exemple.
Depuis le début du XXIe siècle, se développe une autre manière de concevoir la santé. Elle renvoie cette fois au verbe latin saluto qui signifie garder sain et sauf, c’est à dire préserver. La santé devient alors un bien précieux, fragile, et évolutif, à entretenir en ayant conscience qu’elle est le fruit d’un système complexe, d’interactions entre un organisme et son environnement. De nouvelles connaissances scientifiques ont rétabli un équilibre entre prévention et thérapie, biologie et psychologie, patrimoine génétique et mode de vie, guérison externe et auto- guérison. La santé s’avère plus globale, fruit de nos comportements et de nos décisions. On utilise ainsi en anglais l’expression «one health ». Au règne du technicien spécialiste succède l’impératif d’une approche pluridisciplinaire de professionnels du soin et de la prévention. Côté patient, apparait l’obligation de ne plus être passif mais pleinement engagé, en assumant une part de responsabilité.
Toute thérapeutique engendre des effets indésirables, y compris une médecine douce. Naturel ne signifie pas sans danger. Pour les connaître il faut les relever, soit dans des études, soit en pratique clinique. Compte tenu d’une relative nouveauté et d’une absence de traçabilité dans les dossiers médicaux, les connaissances sont fréquemment très partielles. Les effets secondaires et les risques d’interactions sont encore trop rare- ment recherchés dans les essais cliniques. Finançant eux-mêmes ces médecines, souvent sans prescription, les patients sont peu enclins à signaler à leur médecin et aux autorités un échec, un incident ou un effet secondaire. S’il en existe un, il y a une tendance à le minimiser, ou à l’attribuer à une autre cause.
Conclusion provisoire
Tous les acteurs de la filière des INM fournissent des efforts considérables pour améliorer la situation. Une attention toute particulière est portée sur la dose prescrite, en ayant à l’esprit qu’une INM à base de plantes ou de minéraux comme les compléments alimentaires, ou à base de techniques gestuelles comme les thérapies manuelles, peut s’avérer inoffensive à une certaine dose, bénéfique pour la santé à une autre, et mortelle à une troisième. Un programme d’activité physique pratiqué de manière trop intensive peut provoquer des blessures et des séquelles graves. Il faut s’en préserver, et pour cela, les INM respectent un cahier des charges pour un objectif de santé visé. Une exigence pour devenir un des piliers d’une nouvelle approche de la santé, plus intégrative.
Lire la suite de cet article, le mois prochain.
Notes :
[1] SÉNAT, Rapport 480 au nom de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, Paris, Sénat, 2013.
[2] HAUTE Autorité de SANTÉ, Développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées, Paris, HAS, 2011.
[3] MINISTÈRE de la Santé, Stratégie Nationale de Santé2018-2022, Paris, Ministère de la Santé, 2018.
[4] Boutron, Altman D. G., Moher D., Schulz K. F. et Ravaud P., «CONSORT statement for randomized trials of nonpharmacologic treatments: a 2017 update and a CONSORT extension for nonpharmacologic trial abstracts», Ann Intem Med, vol. 167, 2017, p. 40-47.
[5] BOUVENOT et VRAY M., Essais cliniques: Théorie, pratique et critique, Paris, Lavoisier, 2006.
[6] Sackett L., Rosenberg W. M., Gray J. A., Haynes R. b. et Richardson W. S., «Evidence based medicine: what it is and what it isn’t», BMJ, vol. 312, 1996, p. 71-72.
[7] Haug, Nordgreen T., ÔST L. G. et Havik O. E., «Self-help treatment of anxiety disorders : a meta-analysis and meta-regression of effects and potential mode- rators», Clin Psychol Rev, vol. 32, 2012, p. 425-445.