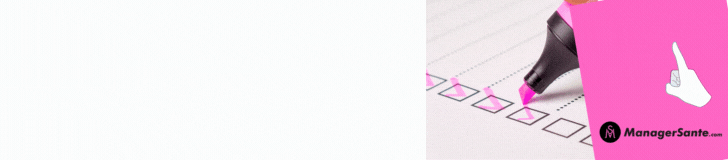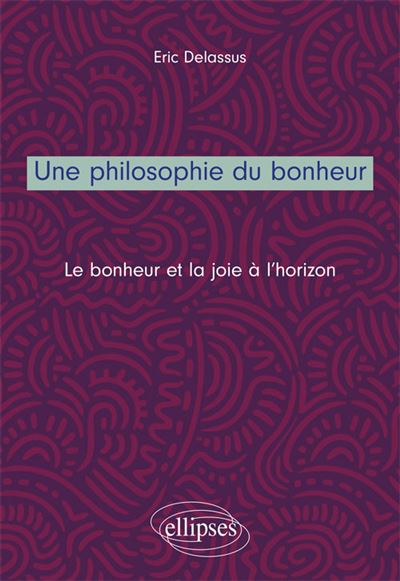N°71 Octobre 2023
Nouvel Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School).
Il est co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Octobre 2021 chez LEH Edition, sous la direction de Jean-Luc STANISLAS, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins

Vulnérabilité et servitude
Relire la 2ème partie de cet article.
Il est indiscutable que « nous pâtissons en tant que nous sommes une partie de la Nature, qui ne peut se concevoir par soi sans les autres[1] ». Cependant, ce n’est pas à ce niveau que se situe notre véritable servitude. La servitude ne vient pas seulement de ce que nous sommes déterminés par des causes externes, mais surtout de ce que nous l’ignorons. C’est d’ailleurs en raison de cette ignorance, qui fait que la conscience que nous avons de nous-mêmes repose sur des idées inadéquates, que nous sommes soumis à des affects que nous sommes impuissants « à maîtriser et contrarier ». En revanche qui a, non seulement conscience de sa servitude, mais en connaît les véritables causes, est en mesure de mieux s’en libérer. Non pas en éliminant totalement les causes qui agissent sur lui, mais en se trouvant disposé, par cette connaissance même, à ne plus être affecté de la même manière par elles. Ainsi, il ne se trouve plus dans un état de totale passivité face à l’action qu’elles exercent sur lui, mais la compréhension à laquelle il est parvenu par la réflexion en modifie leur effet.
Ainsi, une personne qui, par exemple, développera des sentiments ou des opinions racistes parce qu’elle aura été agressée par une autre personne différente d’elle par l’origine ou la couleur de peau, si elle parvient par la réflexion à comprendre la véritable origine de son opinion et son absence de fondement rationnel, elle n’en sera pas moins affectée par l’agression qu’elle a subie, mais les affects qui en résulteront seront de nature différente. Au lieu d’être envahie par un affect de haine et un désir de vengeance, elle ne ressentira plus qu’un désir de justice.
De ce point de vue, nous pouvons considérer que la connaissance nous libère progressivement de la servitude qui est notre condition native, puisque nous naissons ignorants des causes des choses.
Néanmoins, si par la connaissance la servitude diminue, nous n’en sommes pas moins vulnérables pour autant, dans la mesure où ces causes continuent toujours d’agir sur nous. Par conséquent, si nous comprenons mieux notre dépendance aux choses et aux autres hommes, celle-ci ne disparait pas pour autant, ce qui explique les limites de notre puissance :
Mais la puissance de l’homme est extrêmement limitée, et infiniment surpassée par la puissance des causes extérieures ; et par suite nous n’avons pas le pouvoir absolu d’adapter à notre usage les choses qui sont en dehors de nous. Et pourtant, c’est d’une âme égale que nous supporterons ce qui nous arrive en contradiction avec la règle de notre utilité, si nous sommes conscients du fait que nous nous sommes acquittés de notre tâche, que la puissance que nous avons n’est pas allée jusqu’à nous permettre de l’éviter, et que nous sommes une partie de la nature tout entière, dont nous suivons l’ordre[2].
Il est donc permis de penser que si la vulnérabilité ne disparaît pas avec la servitude étant donné que « La force par laquelle l’homme persévère dans l’exister est limitée, et la puissance des causes extérieures la surpasse infiniment. »[3], elle ne sera pas vécue selon les mêmes modalités en raison de la compréhension que nous pouvons acquérir de sa nature. Autrement dit comprendre pourquoi nous sommes vulnérables, nous rend finalement plus puissants, ces deux notions ne s’opposent pas dans la mesure où la puissance de l’homme peut sans contradiction être pensée comme une vulnérabilité comprise et assumée. C’est cette absence de contradiction entre puissance et vulnérabilité qui m’a d’ailleurs permis de penser une éthique médicale spinoziste[4] – éthique destinée d’ailleurs tout autant aux médecins qu’aux malades – dans laquelle je tente de démontrer que la connaissance des causes qui nous déterminent n’est certainement pas une garantie contre la souffrance ou la maladie, mais nous donne, en revanche, la force de les accepter et, en même temps, de les affronter plus activement. C’est en vivant activement notre vulnérabilité, parce que nous comprenons en quoi elle s’inscrit dans la nécessité même de notre condition, que nous progressons vers une plus grande liberté. Nous devenons ainsi plus aptes à supporter cette condition et surtout plus puissants pour agir afin d’en réduire les effets. C’est de cette manière qu’un homme qui se pense comme un individu vulnérable parmi d’autres hommes vulnérables peut ressentir le désir de venir en aide à ceux avec qui il partage cette condition. Étant donné que se penser comme vulnérable consiste justement à se penser comme un être essentiellement relationnel. Cette dimension foncière de la condition humaine ne peut s’appréhender que dans un contexte social et politique, ce qui invite nécessairement à mener une réflexion sur les rapports entre éthique et politique dans la pensée spinoziste. Réflexion qui rejoint celle que conduit Spinoza lui-même lorsqu’il aborde la question du rapport entre justice et charité.
En effet, les règles par lesquelles s’organisent la société politique, les règles de droit qui définissent ce qu’est la justice sont indispensables à une vie harmonieuse entre tous les membres de la cité.
Cependant, si elles sont nécessaires, elles ne sont pas pour autant suffisantes pour contribuer au bonheur des hommes. Il est donc nécessaire de développer d’autres vertus qui peuvent venir parfaire les bénéfices apportés par les lois.
Justice et charité

La justice telle que la conçoit Spinoza s’éloigne progressivement du schéma contractualiste qui est encore présent dans le Traité théologico-politique mais qui n’est plus celui auquel il se réfère dans le Traité politique.
Dans le Traité théologico-politique, le passage à l’état civil résulte d’un accord que les hommes passent entre eux après avoir pris conscience du caractère insupportable de l’état de nature :
Si nous considérons également que, sans un secours mutuel, les hommes vivraient nécessairement de façon très misérable et sans pouvoir cultiver la raison comme nous l’avons montré au chapitre V, nous verrons très clairement que pour vivre en sécurité et le mieux possible, ils ont nécessairement dû s’accorder mutuellement et que, pour y parvenir, ils ont dû faire en sorte que le droit que chacun avait par nature sur toute chose soit exercé collectivement et ne soit plus déterminé désormais par la force et l’appétit de chacun, mais par la puissance et la volonté de tous ensemble[5].
En revanche cet aspect contractuel de la constitution de la société disparaît totalement dans le Traité politique. Comme le fait remarquer Lucien Munier-Pollet dans son livre sur la philosophie politique de Spinoza :
Dans ce texte (le Traité politique), ce qui frappe d’emblée est la disparition du contrat en tant que moment constitutif de l’État. Certes, le mot contrat pourra se retrouver, mais c’est de façon tout à fait accidentelle. Les textes qui concernent la sortie de l’État de nature et l’entrée dans la Cité ne font aucune allusion à un engagement ou à une promesse quelconque des individus. La genèse est ici d’origine toute naturaliste et d’allure radicalement mécanique[6].
Dans le Traité politique, en effet, le passage de l’état de nature à l’état civil s’accomplit selon un processus naturel et quasi-mécanique comme le souligne Alexandre Matheron :
Telle est donc la genèse de l’État : passage non plus de l’indépendance à la dépendance, mais de l’interdépendance fluctuante de l’état de nature à l’interdépendance consolidée par quoi la société politique peut se définir. Passage non recherché au départ, qui ne répond à aucune intention, mais qui découle quasi-mécaniquement de l’interaction aveugle des désirs et des pouvoirs individuels[7].
Dans une certaine mesure, on peut considérer que, dans l’état de nature comme dans l’état civil, les rapports humains sont essentiellement des rapports de force. Aussi, ces deux états ne se différencient que par les modalités selon lesquelles de ces rapports se mettent en place. Alors que dans l’état de nature initiale les forces s’affrontent et que le rapport est donc antagoniste, dans l’état civil, qui reste un état naturel, les forces tentent de se conjuguer, parce que les individus ont découvert à force d’expérience que l’union présente plus d’avantages que d’inconvénients :
Puisque les hommes, comme nous l’avons dit, sont conduits par l’affect plus que par la raison, il s’ensuit que la multitude s’accorde naturellement et veut être conduite comme une seule âme sous la conduite non de la raison mais de quelque affect commun : crainte commune, espoir commun, ou impatience de venger quelque dommage subi en commun[8].
On quitte donc l’hypothèse contractualiste qui présente un caractère fictif et artificiel, parce qu’elle suppose de la part des individus une décision autonome et rationnelle. En réalité, la constitution naturelle de la société repose uniquement sur la recherche par les individus de leur utile propre. Ces individus prennent conscience progressivement de la nécessité de s’associer les uns aux autres pour augmenter leur puissance d’être et d’agir en recherchant l’utile commun :
Ainsi, Spinoza voit sans doute le défaut de l’artificialisme hobbien qui l’avait guidé dans le Tractatus Theologico-politicus. Le contrat est doublement fictif : il suppose un homme seul et il le suppose rationnel. Le contenu de la promesse avons nous dit est la reconnaissance d’autrui, or cela ne peut venir d’emblée. Ce que l’expérience révèle c’est que l’union fait la force. Cette expérience seule est réelle et c’est d’elle seule que l’on peut engendrer l’État[9].
C’est pour cette raison que Spinoza peut affirmer que le droit de nature est maintenu dans la cité. Cette conception totalement naturaliste de la constitution du corps social ne provient d’aucune manière d’une valeur accordée à autrui en tant que tel, mais se fonde sur le seul intérêt. C’est pourquoi, il est difficile d’affirmer qu’il y a chez Spinoza, comme chez Aristote, une sociabilité naturelle de l’homme qui serait par nature un animal politique. On peut cependant souligner que cette manière de concevoir la formation de la société civile pose les bases d’une certaine solidarité entre les hommes qui en recherchant leur utile propre découvre peu à peu la nécessité d’agir dans le sens de l’utile commun. Aussi, à la différence des théories libérales qui lui seront postérieures Spinoza ne prétend pas que la convergence des intérêts particuliers va nécessairement dans le sens de l’intérêt général, mais à l’inverse que c’est la recherche de l’utile commun qui va dans le sens de l’utile propre. En effet, l’augmentation de la puissance de chacun est d’autant plus grande que celle des autres hommes augmentent. Dans une société où tous les hommes seraient guidés par la raison, ou en tout cas tous agiraient en obéissant aux principes de justice et de charité, l’autre ne serait plus perçu comme un obstacle à l’expression de la puissance de chacun, mais, au contraire, comme celui dont le comportement conforme à la raison est la condition même de l’accroissement de cette puissance. C’est pourquoi de cette solidarité issue tout d’abord de l’intérêt peut naître un réel intérêt pour autrui qui, malgré sa fragilité, n’en est pas moins capable d’évoluer vers une certaine forme de sollicitude. Cette fragilité est avérée par les événements politiques d’une grande violence qu’a pu observer Spinoza au cours de son existence dans les Provinces-Unies, la manière dont furent exécutés les frères De Witt en est le triste exemple. Aussi, cette fragilité nécessite-t-elle le recours à la loi et à l’autorité politique pour maintenir autant que possible la paix intérieure et créer les conditions permettant aux hommes de cultiver le désir de venir au secours des plus vulnérables et de s’entraider. Spinoza considère donc que les principales vertus de l’homme honnête et désireux de vivre en bonne intelligence avec ses semblables sont la justice et la charité. C’est d’ailleurs la conjugaison de ces deux vertus qui constitue pour Jacqueline Lagrée le véritable amour du prochain. En effet, celle-ci écrit dans son article « Spinoza et l’amour du prochain » :
Les textes disent clairement qu’il (l’amour du prochain) consiste tout entier dans la justice et la charité. Reste à comprendre le sens exact de ce syntagme et à voir entre justice (rendre à chacun le sien) et charité (aimer et aider sans réserve) lequel commande et détermine l’autre[10].
Aussi, n’est-ce pas sans raison que Spinoza, conscient que la répartition équitable des biens et des pouvoirs dans la société ne peut seulement résulter de la bonne volonté des uns des autres, place la justice en premier dans ce couple de vertus. C’est d’abord le respect de la loi et la force des institutions qui permettent la concorde dans la cité en obligeant les hommes à se comporter comme s’ils étaient vertueux, même lorsqu’ils ne le sont pas. Spinoza va donc assigner à l’Etat la charge de venir en aide à ceux qui sont les plus pauvres :
Les hommes sont vaincus, en outre, également par la largesse, et surtout ceux qui n’ont pas de quoi se procurer le nécessaire pour subsister. Et pourtant, porter secours à chaque indigent dépasse de loin les forces et l’utilité d’un simple particulier. Car les richesses d’un particulier sont bien loin de pouvoir y fournir. En outre, la faculté d’un seul est trop limitée pour qu’il puisse s’attacher d’amitié tous les hommes ; et donc le soin des pauvres incombe à la société tout entière, et concerne seulement l’utilité commune[11].
On peut voir dans ces quelques lignes les germes de ce que l’on appellerait aujourd’hui une politique sociale qui élargirait la sollicitude au-delà de la sphère privée en mettant en place un dispositif institutionnel dont la fonction serait de répondre aux besoins des plus vulnérables. Cette nécessité de faire assurer par l’Etat le « soin des pauvres » confirme d’ailleurs ce que fait remarquer Jacqueline Lagrée à propos du rapport étroit qui unit justice et charité, car pour Spinoza, il semblerait que le premier acte de charité qu’un homme puisse accomplir consiste dans le respect des lois, c’est-à-dire dans la justice.
Mais cela ne signifie pas pour autant que les mesures de justice fondées sur la loi suffisent et qu’il ne faut pas leur ajouter d’autres éléments. Autrement dit, ne faut-il pas, pour que règne la concorde entre les hommes, joindre au respect des lois, la sollicitude envers autrui qui est peut-être l’autre nom que l’on peut donner à la charité. Si la loi et nécessaire, elle n’est pas pour autant suffisante pour rendre effectifs le respect mutuel et la considération envers les autres hommes. Aussi, pour maintenir la concorde entre les hommes, est-il également nécessaire de maintenir et de cultiver l’esprit d’entraide par lequel s’affirme la conscience que nous avons d’être reliés les uns avec les autres et la nécessité de nous rendre utiles les uns envers les autres de façon à augmenter la puissance de chacun. C’est cette idée qu’exprime Spinoza dans le scolie de la proposition XVIII d’Éthique IV que nous avons cité en introduction et dans lequel Spinoza souligne l’utilité de l’homme pour l’homme.
Conclusion provisoire
En mettant en œuvre, par des institutions adaptées, une justice qui ne prétend pas refléter des principes absolus, universels et transcendants, mais qui consistent en un ensemble de lois s’accordant aux conditions concrètes dans lesquelles vivent les hommes ; en vivant selon une éthique qui n’est autre que l’expression du désir de vivre libre de l’homme guidé par la raison qui a compris que l’utilité propre et commune nécessite qu’il forme un ensemble solidaire avec les autres hommes, les hommes créent les conditions d’une vie sociale source de joie pour tous, c’est-à-dire source d’une augmentation de perfection.
Lire la suite de cet article, le mois prochain.
Pour aller plus loin :
[1] Spinoza, Éthique, Quatrième partie, Proposition II, Op. cit., p. 349.
[2] id., Appendice, Chapitre XXXII, p. 477.
[3]id., Proposition III, p. 349.
[4]ic Delassus, De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011.
[5] Spinoza, Traité théologico-politique, Op. cit., p. 511.
[6] Lucien Munier-Pollet, La philosophie politique de Spinoza, Op.cit. , p. 121.
[7] Alexandre Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Éditions de minuit, 1988, p. 327.
[8] Spinoza, Traité politique, Op. cit., chapitre VI, p. 141.
[9] cien Munier-Pollet, La philosophie politique de Spinoza, Op. cit., p. 122.
[10] Jacqueline Lagrée, « Spinoza et l’amour intellectuel du prochain », in Spinoza, philosophe de l’amour, sous la direction de Chantal Jaquet, Pascal Séverac, Ariel Suhamy, Publications de l’Université de Saint Étienne, 2005, p. 99.
[11] Spinoza, Éthique, Quatrième partie, Appendice, Chapitre XVII, Op. cit., p. 467.
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS, Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de ManagerSante.com
Biographie de l'auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il a publié plusieurs ouvrages :
– le 25 Septembre 2018 intitulé ” Ce que peut un corps”, aux Editions l’Harmattan.
– un ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un dernier ouvrage, sous la Direction de Jean-Luc STANISLAS, publié le 04 Octobre 2021 chez LEH Edition, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins.
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019