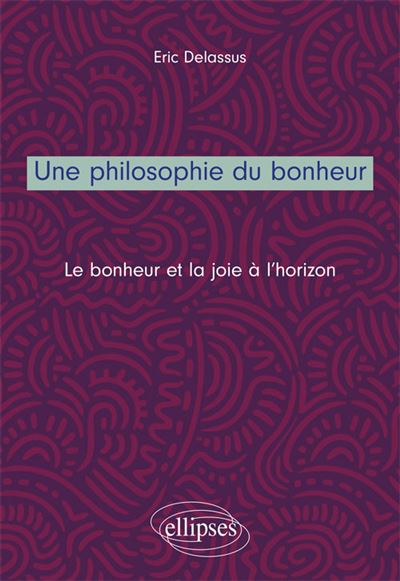Nouvel Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School). Il est co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un nouvel ouvrage publié depuis le04 Octobre 2021 chez LEH Edition, sous la direction de Jean-Luc STANISLAS, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins
Ce nouvel article est publié dans le cadre de d’une Journée d’études au Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson avec l’intervention du Professeur Eric, DELASSUS, le 14 octobre 2021 sur le thème : «Autoriser, s’autoriser, être autorisé, qu’est-ce qui fait autorité ? ».
N°56, Mai 2022
Avant toute chose, il convient de procéder à une précision d’ordre sémantique. Le titre de cette communication peut laisser penser que l’autorité n’a rien à voir avec le pouvoir et qu’elle ne constitue pas, dans son exercice réel, un véritable pouvoir. En réalité – mais le caractère nécessairement concis d’un titre ne permet pas de telles nuances – j’entends et j’entendrai tout au long de cette communication, par autorité un pouvoir non-coercitif et à l’opposé, je désignerai par pouvoir, toute force contraignante pouvant imposer à une ou plusieurs personnes d’agir contre leur gré, que cette contrainte soit perçue consciemment ou non, sur ceux sur qui elle s’exerce. Ainsi, le pouvoir du guru qui manipule les consciences de ses disciples n’a, selon moi, rien à voir avec une autorité véritable, il s’agit d’un pouvoir qui contraint insidieusement les individus sur lesquels il s’exerce. Je m’efforcerai donc de défendre ici la thèse selon laquelle l’exercice de l’autorité libère et s’oppose à l’exercice du pouvoir qui n’a d’autre but que de contraindre.
Cela étant dit, je préciserai aussi que le contenu de cette communication n’est rien de plus que le fruit d’une réflexion inachevée, car je me suis vite aperçu au cours de celle-ci et de mes lectures que le problème est, comme toujours, bien plus complexe qu’il n’y parait. Il s’agit plutôt d’une succession de réflexions et d’interrogations que j’ai tenté de mettre en ordre et de justifier tant bien que mal. Je ne suis donc pas certain que mon propos fera autorité. J’espère que pour le moins, il ne vous ennuiera pas.
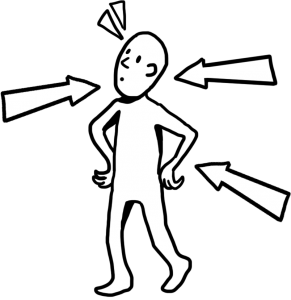
Il est courant de parler aujourd’hui d’une crise de l’autorité.
C’est même devenu une « tarte à la crème » dès que l’on aborde cette question. Celle-ci ne serait plus reconnue ni respectée et il serait donc nécessaire de la restaurer. Il est vrai qu’aujourd’hui ceux qui sont censés la détenir sont parfois en difficulté par rapport à ceux envers lesquels ils devraient l’exercer. Les parents, les enseignants, les forces de l’ordre et tous les représentants de la puissance publique sont parfois bien en peine de faire reconnaître leur légitimité face à certaines populations qui les perçoivent plus comme des agresseurs que comme des protecteurs. Il ne faut certes pas noircir le tableau à l’excès et il y a encore parmi nos contemporains bon nombre de personnes qui savent encore reconnaître une autorité légitime, mais il est vrai également que celle-ci est parfois difficile à exercer et que sa légitimité est difficile à justifier. On peut également souligner que l’exercice de l’autorité est parfois difficile à assumer et qu’il est parfois ingrat de faire preuve d’autorité. Ainsi, certains parents ont parfois du mal à assumer leur rôle et à exercer leur autorité, de peur d’être mal perçus par leurs enfants et de ne plus être aimés par eux. On a tous connu des parents-copains qui au bout d’un certain temps se trouvent dépassés par leur progéniture, parce qu’ils ne sont pas parvenus à exercer cette autorité. Autorité souvent réclamée par l’enfant qui a besoin de repères et qui veut savoir jusqu’où il peut aller, parfois jusqu’où il peut aller trop loin. L’absence d’autorité peut alors être perçue comme une forme de mépris ou comme la manifestation d’un manque d’affection ou d’une affection qui ne parvient pas à s’exprimer de manière adéquate.
Il semble donc nécessaire pour y voir plus clair de commencer par définir plus précisément ce qu’est l’autorité, afin de pouvoir la reconnaître et l’exercer de manière plus judicieuse. Au nom de quoi obéit-on à une autorité et de quel droit s’autorise-t-on à faire preuve d’autorité ? Ce sont ces deux questions que nous allons nous efforcer de traiter ici, afin de montrer principalement que l’autorité n’est pas le pouvoir au sens où faire preuve d’autorité, ce n’est pas être autoritaire ou faire preuve d’autoritarisme, mais bien au contraire agir pour permettre à la liberté de l’autre de s’exprimer, pour augmenter sa puissance et non pour la soumettre et la réduire.
Dans son Dictionnaire philosophique, André Comte-Sponville définit l’autorité comme :
Le pouvoir légitime ou reconnu, ainsi que la vertu qui sert à l’exercer. C’est le droit de commander et l’art de se faire obéir.[1]
Reste à déterminer ce qui rend cette autorité légitime et en quoi consiste cette vertu qui permet de l’exercer. C’est là que la tâche devient plus difficile. Dans le même ouvrage, l’autoritarisme est défini comme :
« Abus d’autorité, le plus souvent fondé sur la croyance naïve qu’elle pourrait suffire. C’est trop demander à l’obéissance, toujours nécessaire, jamais suffisante. »[2]

Où se situe la limite en l’autorité et l’autoritarisme ?
Ici, à nouveau, une difficulté apparaît. Où se situe la limite en l’autorité et l’autoritarisme ? L’auteur de cette définition laisse ici entendre que l’autoritarisme proviendrait d’une autorité qui prétendrait se suffire à elle-même, ce qui sous-entend que la source de l’autorité lui serait extérieure. C’est donc cette source qu’il nous faut trouver.
Pour Hannah Arendt, nous serions coupés de cette source. C’est pourquoi, elle ne pose pas la question de savoir ce qu’est l’autorité, mais ce qu’elle fut. Dans la mesure où, selon Arendt, la source de l’autorité serait la tradition, et parce que la modernité a rompu avec cette tradition en la remettant en question, l’autorité aurait disparu. Aussi, dans la mesure où il serait impossible de revenir à cette tradition abandonnée, il serait également impossible de restaurer l’autorité.
Si l’on s’accorde avec Hannah Arendt pour faire reposer l’autorité sur la tradition, il est vrai que celle-ci ne fonctionne plus. Le crédit qui était accordé autrefois à l’expérience, à ce qui s’enracine dans le passé et dans ce qui a contribué à la fondation de notre civilisation s’est progressivement amenuisé avec l’avancée de la modernité qui se définit précisément comme rupture. Ainsi, aujourd’hui, le fait d’être avancée en âge, d’avoir de l’expérience et d’entretenir des liens avec le monde passé ne confère plus beaucoup d’autorité. Loin de là, il faut aujourd’hui innover, aller de l’avant et celui dont le regard s’attarde trop sur le passé est vite considéré comme dépassé. La caricature de cet état d’esprit consiste dans le jeunisme qui pose la jeunesse comme modèle pour les générations antérieures alors que la tradition voudrait plutôt que ce soit l’inverse. Ce phénomène est d’ailleurs fort problématique, puisqu’en posant la jeunesse comme le prototype auquel doivent se conformer toutes les générations, les plus jeunes d’entre nous ne trouvent finalement plus de repères. Ils n’ont plus de modèles auxquels s’identifier ou auxquels s’opposer pour se construire. Ils ne peuvent plus s’identifier qu’à leur propre image, puisqu’elle est la seule qui fasse autorité.
Cette tendance s’enracine dans la manière dont s’est initiée la rupture qui a produit la modernité. Ainsi, par exemple, la philosophie cartésienne, et tout ce qu’elle a pu engendrer, se caractérise par une refondation complète de l’édifice de la connaissance remettant en question l’autorité de la scolastique, cette philosophie qu’on enseignait dans les universités médiévales et qui s’était constituée à partir de la pensée d’Aristote. La pensée moderne est d’ailleurs celle qui mit fin au règne de l’argument d’autorité, le fameux Aristoteles dixit, au sujet duquel André Comte-Sponville écrit, toujours dans son Dictionnaire philosophique, qu’il consiste à « prendre une autorité (un pouvoir, une tradition, un auteur reconnu ou consacré…) pour un argument », et qu’il considère comme une « Double faute : contre l’esprit, qui se moque de l’autorité, et contre l’autorité, qui doit avoir de meilleurs arguments ».
Par conséquent, cette crise de l’autorité dont on nous rebat régulièrement les oreilles, résulterait peut-être plus d’un changement de paradigme que d’une totale disparition de celle-ci. Il ne s’agirait plus de se conformer à la tradition, mais de n’obéir qu’à ce qui se justifie selon des arguments. C’est d’ailleurs qu’exprime Montaigne dans cet extrait de ses Essais cité par André Comte-Sponville :
Toute inclination et soumission est due aux rois, écrit Montaigne, sauf celle de l’entendement. Ma raison n’est pas duite [habituée] à se courber et fléchir, ce sont mes genoux.[3]
Ainsi présentée, l’autorité ne trouverait plus sa source que dans le respect de notre seul entendement, de la seule raison qui est en nous et n’aurait pas à se fier à autre chose.
Cela étant dit, ce n’est pas parce que l’autorité est initialement enracinée dans la tradition qu’elle doit être confondue avec le pouvoir coercitif. Hannah Arendt dénonce d’ailleurs une telle confusion :
Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué.[4]
Mais Hannah Arendt rejette également l’idée selon laquelle l’autorité reposerait sur la persuasion qui s’appuie sur des arguments :
L’autorité, d’autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l’égalité et opère par un processus d’argumentation. Là où on a recours à des arguments, l’autorité est laissée de côté. face à l’ordre égalitaire de la persuasion, se tient l’ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. s’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être en l’opposant à la fois à la contrainte par force et la persuasion par arguments.[5]
Autrement dit, il y aurait contradiction à vouloir penser une autorité qui serait uniquement fondée en raison, car cette dernière supposerait une égalité entre celui qui fait autorité et celui qui lui obéit. Or, il est vrai, que faire autorité, c’est être perçu comme supérieur par celui qui reconnaît cette autorité.

En quoi consiste cette supériorité ?
Toute la question est alors de savoir en quoi consiste cette supériorité, si elle n’est pas de l’ordre d’un pouvoir, car comme le précise Hannah Arendt, l’obéissance à l’autorité n’est jamais contraignante, elle est nécessairement librement consentie :
L’autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté, …
Elle suppose une certaine confiance de la part de celui qui obéit envers celui qui exerce l’autorité. L’exemple type de cette relation est peut-être celui du lien qui unit le maître et l’élève. Il est vrai qu’aujourd’hui, on n’utilise plus guère ce couple de termes, on parle plutôt d’enseignant et d’apprenant ou pire, on qualifie celui qui transmet le savoir et les savoirs-faire de « formateurs », comme si ceux à qui il s’adresse n’étaient qu’une matière informe qu’il faudrait modeler. Ce renoncement à la référence au couple maître – élève repose en réalité sur une confusion et une incompréhension, car il assimile ce couple à celui du maître et de l’esclave. Le maître est identifié à celui qui commande, qui s’impose arbitrairement et qui exerce un pouvoir sur l’autre. Or, ce que l’on oublie, c’est que le mot de « maître » n’a pas le même sens dans les deux couples de termes. Dans le couple maître – esclave, le maître est le dominus, celui qui domine et qui s’impose par la force, celui qui contraint la liberté de l’autre. En revanche, dans le couple maître -élève, le maître est le magister, celui qui par son autorité et sa supériorité initiale, parce qu’il en sait plus que son élève, s’efforce, non pas de rabaisser l’autre en le maintenant dans une posture de soumission, mais au contraire de le faire progresser. C’est d’ailleurs là le sens du terme d’élève. L’élève, c’est celui que l’on élève, au sens où l’on s’efforce d’augmenter ses capacités, de faire croître ce qu’il y a en lui d’aptitudes. C’est en ce sens que le maître instruit son élève. Il ne se contente pas de le gaver de savoir, il s’efforce surtout d’édifier de l’intérieur un esprit, une liberté, de favoriser le développement d’un être.
Le maître n’a d’ailleurs jamais aussi bien réussi sa tâche que lorsque son élève le dépasse. Mais même lorsque ce dépassement a lieu, il n’en perd pas pour autant son autorité, l’élève lui sera toujours reconnaissant de ce qu’il lui aura apporté.
Cela ne viendrait-il pas de ce que la relation d’autorité serait d’abord une relation de confiance ? Accepter d’obéir librement à quelqu’un nécessite que l’on ait confiance en cette personne, que l’on croit en elle. Confiance qui, d’ailleurs, repose également sur la confiance que le maître ressent envers son élève. On ne peut enseigner, instruire, guider l’autre que si l’on croit en lui. Comme l’affirme Alain dans l’un de ses Propos, la confiance en l’élève est la source de son succès :
Si je crois que l’enfant que j’instruis est incapable d’apprendre, cette croyance écrite dans mes regards et dans mes discours le rendra stupide ; au contraire, ma confiance et mon attente est comme un soleil qui mûrira les fleurs et les fruits du petit bonhomme.[6]
Cette confiance est peut-être aussi l’une des sources de l’autorité. Si celui qui se prétend un maître méprise son élève, ce dernier le craindra probablement, mais il ne le respectera pas, il ne fera qu’obéir stupidement et échouera dans ses tentatives pour accomplir ce qu’on lui demande sans qu’on le croie vraiment capable de l’effectuer. À l’inverse, l’élève en qui l’on espère, sera mieux disposé à croire dans la capacité du maître à l’élever et aura suffisamment foi en lui pour favoriser le développement de certaines de ses aptitudes. Il n’y a donc pas que de la raison dans l’autorité, il y a aussi des affects, de l’intuition, du ressenti. Faire autorité, c’est aussi l’inspirer, c’est inspirer confiance par la confiance en l’autre. Envisagée ainsi, l’autorité n’est pas un pouvoir, mais une puissance, elle est la puissance d’augmenter la puissance de l’autre. À plusieurs reprises Spinoza, dans ses œuvres, distingue le pouvoir (en latin potestas) et la puissance (potentia). Par cette distinction, il nous permet de mieux comprendre en quoi le goût du pouvoir est en réalité un symptôme d’impuissance. En effet, celui qui aime le pouvoir pour lui-même, celui qui jouit de l’emprise qu’il peut exercer sur autrui, n’est autre que celui qui, parce qu’il se sent faible, n’a d’autre solution pour se sentir fort que de rabaisser l’autre, de l’empêcher de développer ses aptitudes et de manifester ainsi sa puissance d’agir[7]. C’est en ce sens que l’autorité se distingue de l’autoritarisme qui consiste uniquement à jouir de la domination que l’on exerce sur autrui, tandis que l’autorité s’exerce pour autrui. Il s’agit d’agir sur autrui pour augmenter sa puissance. Par conséquent, on peut s’interroger quant à savoir si la crise de l’autorité dont il était question au tout début de cette réflexion n’est pas due à une confusion entre autorité et pouvoir. Autant ceux qui se plaignent que l’autorité n’est pas reconnue que ceux qui ont des difficultés à l’assumer, lorsqu’ils doivent l’exercer ont tendance à la confondre avec un pouvoir qui ne parvient pas à se légitimer et qui ne réussit donc pas à faire autorité.

Entre autorité et « phronesis »
Aussi, l’autorité ne peut-elle être que bienveillante[8], ce qui ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être exigeante. Bien au contraire, l’exigence, lorsqu’elle signifie que l’on croit en l’autre et que l’on espère de lui quelque chose, comme le souligne Alain, dans la phrase citée précédemment, est aussi une manifestation de bienveillance. Veiller au bien de celui sur qui on a à exercer une certaine autorité peut consister à exiger de lui qu’il donne le meilleur de lui-même. Mais faut-il encore être en mesure d’évaluer ses aptitudes, car l’exigence ne doit pas dépasser les capacités de l’autre au risque de le mettre en échec et de le réduire à l’impuissance.
Par conséquent, l’autorité suppose également une certaine sagacité, c’est-à-dire une certaine aptitude à cerner judicieusement ce qui fait la singularité de l’autre sur qui elle doit s’exercer. Faire preuve d’autorité, faire autorité et être reconnue détenteur d’une autorité légitime, n’est-ce pas faire preuve de cette vertu que les Grecs de l’antiquité appelaient phronesis et qu’Aristote a magistralement décrite dans Éthique à Nicomaque à travers le personnage du phronimos, l’homme prudent. Cette vertu, qu’un commentateur d’Aristote, Pierre Aubenque, qualifie « d’habileté des vertueux »[9], relève d’une certaine intelligence du singulier, d’une certaine aptitude à appréhender les personnes et les situations de telle sorte qu’on soit en mesure d’agir toujours de la meilleure façon qui convient. Le terme même de phronesis est d’ailleurs traduit d’au moins deux manières, soit par « prudence » (traduction Tricot, Vrin), soit, par « sagacité » (traduction Bodeus, Garnier), on peut d’ailleurs y ajouter celle qu’on trouve dans un texte d’Hannah Arendt, La crise de la culture, dans lequel le mot « phronesis » est traduit par « insight » qui donne en français « perspicacité »[10]. Dans toutes ces traductions, on trouve l’idée d’une certaine forme d’intuition qui permet d’aboutir à une connaissance qui n’est pas la science, qui a pour objet le général, mais qui relève d’une sagesse pratique qui permet de toujours savoir comment agir durant le temps qui convient et au moment qui convient (le kairos). Ainsi, toujours dans Éthique à Nicomaque, Aristote expose comment faire un bon usage de la colère[11]. En effet, celui qui ne se met jamais en colère peut passer pour un lâche, il acceptera, par exemple, de se faire humilier sans réagir. À l’opposé, celui qui se met en colère sans raison valable et de manière inconsidérée se comportera comme une brute sans discernement. En revanche, écrit Aristote, celui qui saura se mettre en colère au moment qui convient et durant le temps qui convient saura se faire respecter. Aussi, même si Aristote n’emploie pas le terme, on pourra dire que ce dernier saura faire preuve d’autorité. Sa colère sera froide, mesurée, elle saura faire prendre conscience à celui à qui elle est destinée, qu’il est allé trop loin.
Il ne s’agit là, bien entendu, que d’un exemple et l’autorité ne peut se réduire au bon usage de la colère, mais ce qu’illustre cet exemple, c’est que l’autorité n’est pas obéissance à une personne, mais à une règle, à un principe que cette personne parvient à incarner à un certain moment et d’une manière adaptée aux circonstances. Faire preuve d’autorité, peut-être est-ce d’abord faire comprendre à l’autre qu’il n’agit pas en adéquation avec lui-même et qu’en réalité, il n’agit pas librement, mais en se laissant abuser par ses opinions, ses passions, une idéologie, par une instance qui le fait réagir de manière inappropriée ? C’est aussi lui montrer comment devenir lui-même, l’inviter à la réflexion, à la remise en question, comme pouvait le faire Socrate qui, sans jamais donner de réponse aux questions qu’il soulevait, conduisait son interlocuteur à affiner son jugement et à penser avec plus de cohérence. Socrate répondait d’ailleurs aux sophistes qui s’agaçaient de devoir reconnaître les insuffisances de leur discours ou à ses interlocuteurs qui se sentaient dans l’incapacité de remettre en question ses arguments, que ce n’était pas à lui Socrate qu’ils acquiesçaient, mais à leur propre entendement et à la vérité[12]. Et c’est d’ailleurs, ce qui fait la différence entre Socrate et les sophistes. Alors que pour les sophistes, le langage est un instrument de pouvoir au moyen duquel ils manipulaient l’opinion, Socrate s’appuyait sur l’autorité du logos pour accompagner ses interlocuteurs et les rendre aptes à penser par eux-mêmes.

Autorité et liberté d’agir
C’est en ce sens que l’autorité libère. Alors que le pouvoir impose ou interdit, l’autorité autorise, c’est-à-dire qu’elle accorde un droit, une liberté. Il ne faut pas oublier que dans autorité, il y a « auteur ». L’acte d’autoriser consiste donc au bout du compte dans l’acte par lequel on rend l’autre auteur, auteur de ses actes et de ses pensées. Il est d’ailleurs important de souligner ici l’origine étymologique du terme d’« autorité », qui vient du latin augere qui signifie « augmenter ». Cette étymologie peut donner lieu à deux interprétations. Soit ce qui augmente n’est autre que le pouvoir de celui qui dispose de l’autorité, soit c’est la puissance de celui sur qui elle s’exerce. Dans cette deuxième interprétation, la confusion de l’autorité et du pouvoir n’est plus possible. Celui qui dispose de l’autorité n’est pas celui qui commande ou qui impose, il est celui qui crée les conditions pour que l’autre progresse et se développe ou du moins pour qu’il puisse se maintenir dans un certain équilibre et s’inscrive dans un ordre qui lui permet d’avoir le sentiment d’être lui-même.
C’est un peu ce rôle que remplit le chef dans les sociétés traditionnelles qu’a étudiées Pierre Clastres et qui l’on conduit à penser que ces sociétés se sont construites contre l’État[13]. Alors que ces sociétés ont longtemps été qualifiées de primitives, parce qu’on interprétait leur organisation comme rudimentaire, comparée à celle de nos sociétés jugées plus développées, Pierre Clastres montre, au contraire, que ces sociétés sont tout aussi complexes, mais que leur complexité et d’une autre nature et qu’elle se sont constituées pour éviter que se mettent en place des rapports de pouvoir comparables à ceux que l’on peut rencontrer dans les sociétés organisées à partir d’un État fort s’appuyant sur une hiérarchie pyramidale. Cependant, si ces sociétés se protègent des dérives d’un pouvoir suprême excessivement contraignant, elles ne se passent pas pour autant de chef. Mais il s’agit d’un chef dont la fonction n’est pas de commander (à l’exception des périodes de crise, principalement en cas de guerre). S’agit-il, comme l’écrit Pierre Clastres, d’un pouvoir sans autorité, ou d’une autorité qui serait d’une autre nature que l’exercice d’un pouvoir de contrainte ?
La seconde possibilité semble recevable, si l’on considère que son autorité – qui fait qu’il est reconnu comme chef, la reconnaissance étant consubstantielle à l’autorité, une autorité non reconnue n’est finalement pas une autorité du tout – réside dans sa puissance à maintenir la structure du groupe sans avoir à commander.
Lire la suite de cet article, le mois prochain.
Pour aller plus loin :
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS, Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de ManagerSante.com
Biographie de l'auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il a publié plusieurs ouvrages :
– le 25 Septembre 2018 intitulé ” Ce que peut un corps”, aux Editions l’Harmattan.
– un ouvrage publié en Avril 2019 intitulé «La philosophie du bonheur et de la joie» aux Editions Ellipses.
Il est également co-auteur d’un dernier ouvrage, sous la Direction de Jean-Luc STANISLAS, publié le 04 Octobre 2021 chez LEH Edition, intitulé « Innovations & management des structures de santé en France : accompagner la transformation de l’offre de soins.
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019
Résumé : Et si le bonheur n’était pas vraiment fait pour nous ? Si nous ne l’avions inventé que comme un idéal nécessaire et inaccessible ? Nécessaire, car il est l’horizon en fonction duquel nous nous orientons dans l’existence, mais inaccessible car, comme tout horizon, il s’éloigne d’autant qu’on s’en approche. Telle est la thèse défendue dans ce livre qui n’est en rien pessimiste. Le bonheur y est présenté comme un horizon inaccessible, mais sa poursuite est appréhendée comme la source de toutes nos joies. Parce que l’être humain est désir, il se satisfait plus de la joie que du bonheur. La joie exprime la force de la vie, tandis que le bonheur perçu comme accord avec soi a quelque chose à voir avec la mort. Cette philosophie de la joie et du bonheur est présentée tout au long d’un parcours qui, sans se vouloir exhaustif, convoque différents penseurs qui se sont interrogés sur la condition humaine et la possibilité pour l’être humain d’accéder à la vie heureuse. (lire un EXTRAIT de son ouvrage)

ManagerSante.com soutient l’opération COVID-19 et est partenaire média des eJADES (ateliers gratuits)
initiées par l’Association Soins aux Professionnels de Santé
en tant que partenaire média digital

Parce que les soignants ont plus que jamais besoin de soutien face à la pandémie de COVID-19, l’association SPS (Soins aux Professionnels en Santé), reconnue d’intérêt général, propose son dispositif d’aide et d’accompagnement psychologique 24h/24-7j/7 avec 100 psychologues de la plateforme Pros-Consulte.