N°28, Août 2019
Article écrit par Eric, DELASSUS, (Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges et Docteur en philosophie, Chercheur à la Chaire Bien être et Travail à Kedge Business School). Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est publié en Avril 2019, portant le titre suivant : « La philosophie du bonheur et de la joie : le bonheur à l’hôrizon« , aux Editions Ellipses
Relire la première partie de cet article
La première chose à faire consiste, me semble-t-il, à ne pas réduire les relations humaines dans le monde du travail à des relations uniquement de type contractuel et qui s’établiraient entre des personnes considérées comme parfaitement autonomes.
Il importe également de tenir compte de tout ce qui relève du désir des uns et des autres, de leurs affects et de le faire en connaissance de cause plutôt que de le faire sans réellement s’en rendre compte. Cette dimension affective des relations humaines ne doit pas s’appuyer sur une éthique purement compassionnelle, il ne s’agit pas nécessairement de ressentir ce que l’autre ressent, mais de comprendre ce qu’il ressent pour adapter son attitude à ce qui fait sa singularité à tel ou tel moment de la relation que l’on établit avec lui.
En quoi la question du « sens au travail » est-elle si indispensable dans les relations professionnelles ?
Cette approche doit se mettre en place pour chacun des acteurs, quelle que soit sa position dans l’organigramme. Prendre en considération la vulnérabilité des personnes signifie tout autant prendre soin des individus que des relations de dépendance qu’ils entretiennent entre eux et qui fondent cette vulnérabilité.
C’est pourquoi, il faut penser le monde du travail, qui est avant tout un monde. d’interdépendance, selon d’autres paradigmes. Comme cela à été développé plus haut, le travail n’est pas seulement une activité visant le profit, il doit aussi avoir pour objectif d’être utile aux autres.
Pour que le travail puisse être une source de joie, il est nécessaire qu’il prenne sens, c’est-à-dire qu’il ne soit pas simplement l’activité par laquelle on gagne sa vie – ou par laquelle on la perd à la gagner – ce qui est le propre de l’aliénation au travail. Or, pour que le travail prenne sens, il importe que le travailleur sache à quoi le relie son travail, qu’il en connaisse la raison d’être et que celle-ci n’entre pas en contradiction avec ses convictions et les valeurs morales dans lesquelles il se reconnaît.
C’est en ce sens que l’éthique des entreprises n’est pas un vain mot, car c’est en respectant un certain nombre d’exigences éthiques que l’entreprise évite d’imposer à ses employés des situations dans lesquelles ils se trouvent confrontés à des conflits intérieurs insolubles. Certains scandales récents dans l’industrie pharmaceutique ou automobile ont dû tarauder la conscience de nombreux employés de ces firmes qui se trouvaient tiraillés entre la nécessité de suivre les directives de leur hiérarchie pour conserver leur emploi et leur réticence à accomplir des actions totalement en contradiction avec leurs convictions profondes.
Donner du sens au travail, c’est d’abord aider la personne au travail à percevoir clairement à quoi son activité est relié. Ici encore, la notion de relation est fondamentale. Il n’y a, en effet, de sens que dans la relation, parce que c’est la relation qui produit le sens.
- La notion de sens renvoie tout d’abord aux cinq sens, autrement dit à ce par quoi nous sommes reliés à nous-mêmes et au monde.
- Elle désigne également la direction, l’orientation, ce vers quoi nous allons, ce qui relie notre action à une finalité.
- Enfin, le sens se définit comme signification, comme la relation entre un signifiant et un signifié, relation qui, comme l’a découvert Ferdinand de Saussure, le fondateur de la linguistique, constitue le signe linguistique qui est union d’un signifiant et d’un signifié.
Autrement dit, le sens, c’est ce qui fait signe, ce qui nous appelle et nous invite à nous exprimer. On peut donc en inférer que donner sens au travail consiste à faire en sorte qu’il nous fasse signe et qu’il nous appelle, qu’il nous invite à entrer en relation avec les autres et à nous exprimer. Sans cela, le travail n’est plus qu’une activité pauvre en sens et qui risque fort de rendre fou.
Imposer aux travailleurs des exigences de rentabilité en réduisant au maximum la dimension relationnelle de son activité est souvent à l’origine d’une terrible souffrance.
Ainsi, par exemple, dans le domaine de la santé, l’introduction d’un management d’inspiration taylorienne qui va jusqu’à définir la durée d’une toilette pour un patient génère une grande frustration ainsi qu’une immense culpabilité chez les soignants. On pourrait en dire autant de l’employé qui n’a plus le temps de discuter avec ses clients ou ses collègues parce qu’il ne doit avoir pour seul objectif que la rentabilité de l’entreprise et non l’utilité sociale de son activité. Il ne s’agit pas, bien évidemment, de faire comme si une entreprise, ou tout autre forme d’organisation, ne devait pas respecter un certain nombre d’exigences d’ordre économique.
Il s’agit tout simplement de donner à l’économie du sens et de la remettre sur ses pieds au lieu de la faire marcher sur la tête. Il s’agit tout simplement de prendre conscience qu’une économie durable et sensée doit d’abord être au service des hommes et non considérer que les hommes doivent être à son service. Pour cela, il faut avoir en tête que travailler consiste d’abord à se rendre utile aux autres.
Qu’est-ce que la notion de « capabilité », ou le fait de se rendre utile aux autres ?
C’est avant tout – et c’est là que Spinoza peut venir à notre secours – contribuer à l’augmentation de leur puissance d’agir. En ce sens, le manager doit être celui qui doit contribuer à ce que chacun – lui et ceux dont il a la charge – puisse dans son travail sentir augmenter sa puissance d’agir, c’est-à-dire sentir s’accroître en lui sa capacité à produire en lui et hors de lui des effets positifs, principalement à sentir qu’en développant sa puissance, il contribue à faire progresser celle des autres.
C’est, par exemple, le sentiment que ressent l’enseignant qui parvient à faire comprendre à un élève ou un étudiant une chose que ce dernier ne parvenait pas à assimiler jusque là. Le succès de son enseignement, grâce à la mise en œuvre de ses compétences pédagogiques, s’accompagne de la perception d’une augmentation de puissance dont les effets ont également contribué à l’accroissement de la puissance de compréhension de l’élève. On pourrait sur ce point rapprocher la notion de puissance de celle de « capabilité » élaborée et développée par l’économiste Amartya Sen ainsi que par la philosophe américaine Martha Nussbaum :
Il existe désormais un nouveau paradigme théorique dans le monde de la politique du développement. Connu sous le terme d’« approche du développement humain », « approche de la capabilité » ou « approche des capabilités », il commence par une question toute simple : qu’est-ce que les gens sont réellement capables de faire et d’être ?[1]
C’est pourquoi, il convient de distinguer nettement la puissance du pouvoir. Lorsque l’enseignant contribue à faire progresser son élève ou lorsque le manager parvient à motiver le collègue qu’il doit accompagner en lui faisant comprendre le sens de la tâche qu’il doit accomplir, ni l’un ni l’autre n’exerce un pouvoir au sens où il n’impose rien à qui que ce soit, ils ne font l’un et l’autre que recourir aux ressources internes de la personne avec laquelle ils travaillent pour l’aider à progresser.
D’ailleurs, le pouvoir, lorsqu’il est exercé par goût de dominer autrui, est plus un symptôme d’impuissance que de puissance.
C’est lorsqu’un sujet se sent dans l’incapacité de sentir fort par lui-même en faisant appel à ses propres ressources qu’il risque de faire usage du pouvoir dont il dispose pour compenser cette faiblesse en diminuant la puissance de l’autre au lieu de la favoriser. C’est ainsi que l’autorité se transforme en autoritarisme. Lorsqu’une impuissance s’imagine qu’elle pourra se transformer en puissance en diminuant la puissance des autres.
Le seul moyen de sortir d’un tel cercle vicieux est d’ailleurs d’assumer pleinement sa vulnérabilité. Car il n’y a pas d’incompatibilité entre puissance et vulnérabilité. Si nous sommes dépendants les uns envers les autres, c’est que nous avons besoin des autres hommes pour voir notre puissance d’agir augmenter. C’est là la grande leçon de Spinoza qui nous aide à comprendre que dans une société humaine la puissance des uns augmente d’autant que s’accroît celle des autres.
Quels sont les quatre principes fondamentaux du « care » ?
En ce sens les éthiques du care sont également des éthiques de la puissance. C’est pourquoi, comme le fait remarquer Fabienne Brugère, on peut interpréter le care sous la forme qu’il peut prendre aujourd’hui dans les diverses théories qui le place au cœur de l’éthique comme une réactualisation du conatus spinoziste. Le terme de conatus désignant chez Spinoza l’effort par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son être, effort qui prend chez l’homme la forme du désir considéré comme étant l’essence même de l’homme comme puissance d’agir :
Elle (l’éthique du care) réactualise, en ce sens, le conatus spinoziste, puissance d’agir qui n’est rien de substantiel ni de souverain et peut être fait comme défait dans son rapport aux autres. Avec l’éthique, il n’existe pas de prééminence de l’esprit sur le corps, et les valeurs morales ne sont pas intangibles. Plutôt que de parler du bien et du mal hors de tout contexte, il est plus juste d’évoquer des rapports, et donc du bon et du mauvais[2].
Envisagé sous cet angle, les éthiques du care ne peuvent plus être taxée d’éthiques n’envisageant les rapports humains que sous un jour purement compassionnel. Bien au contraire, elles peuvent être considérées comme des éthiques de la puissance ainsi que de la responsabilité. Dans la mesure où nous sommes tous dépendants les uns des autres, nous sommes tous également responsables les uns des autres comme l’affirment Bérénice Fisher et Joan Tronto qui définissent ainsi les quatre principes fondamentaux du care :
- l’attention : «se soucier de»
- la responsabilité : «prendre en charge»
- la compétence : «prendre soin», le travail effectif qu’il est nécessaire de réaliser
- la capacité de réponse : «recevoir le soin»
Joan Tronto définit d’ailleurs le care de la manière suivant :
Une activité caractéristique de l’espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre «monde» de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités (selves) et notre environnement, que nous cherchons à tisser ensemble dans un maillage complexe qui soutient la vie[3].
Assumer sa vulnérabilité ne signifie donc pas faire preuve de faiblesse, mais plutôt s’affirmer en tant personne humaine se définissant de manière principalement relationnelle et soucieuse de cultiver les liens qui l’unissent aux autres personnes humaines, ce qui ne peut que donner lieu à un mode de fonctionnement plus collaboratif et coopératif[4].
Il n’y a donc rien de contradictoire à parler d’une puissance dans la vulnérabilité, d’une puissance de l’homme vulnérable qui augment d’autant que cette vulnérabilité est assumée pour soi et pour autrui.
Le manager peut-il alors exprimer sa vulnérabilité pour affirmer son autorité ?
Ainsi, le manager qui adopte une telle disposition éthique se met en situation de percevoir la vulnérabilité de ceux qui l’accompagnent avec sollicitude et parallèlement, il se sent en droit de demander de l’aide lorsqu’il se sent en difficulté. Il peut ainsi travailler à maintenir, consolider ou restaurer les liens qui sont la condition de toute forme de vie sociale (confiance, sollicitude, empathie, respect de l’autre et de soi-même).
Il peut ainsi exercer son autorité avec bienveillance, dans la mesure ou autoriser ne signifie pas exercer sa domination sur autrui, mais plutôt – et ce n’est pas simplement jouer sur les mots que dire cela – agir de façon à rendre l’autre auteur de ses actes et des opérations qu’il doit effectuer dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Lorsque le manager exerce son autorité sur celui qu’il accompagne, il l’aide à devenir l’auteur de ce qu’il entreprend. Autrement dit, il contribue à l’augmentation de sa puissance d’agir.
Exercer sa puissance tout en assumant sa vulnérabilité, c’est aussi se mettre en capacité de résoudre les situations conflictuelles sans chercher à accuser qui que ce soit, mais en s’efforçant plutôt de comprendre l’autre, en appliquant cette formule que j’emprunte à Spinoza et que j’essaie de faire mienne : Ne pas rire des actions des hommes, de ne pas les déplorer, encore moins de les maudire — mais seulement de les comprendre[5]. Ce qui signifie, entre autres, pour ce qui concerne notre sujet, qu’il convient avant tout de rechercher les causes des problèmes pour parvenir à débloquer les situations difficiles.. Adopter cette posture nécessite donc d’être à l’écoute de l’autre et principalement de son désir, non pour manipuler celui-ci, mais pour l’aider à s’accomplir dans un cadre professionnel.
Manager, c’est aider l’autre à satisfaire son désir dans un contexte professionnel, et l’une des meilleures manières d’atteindre cet objectif consiste, comme nous l’avons souligné plus haut, à faire en sorte que la personne se sente utile et parvienne ainsi à donner du sens à la tâche qu’elle accomplit.
En conclusion, prendre en compte la vulnérabilité de chacun, faire preuve de care – qui ne signifie pas simplement prendre soin, mais qui évoque aussi la sollicitude et l’importance accordée à autrui – peut contribuer à faire évoluer les relations humaines à l’intérieur des entreprises et des organisations en faisant en sorte que le monde du travail ne se réduise pas à un univers de subordination et parfois même de servitude, mais se transforme de manière à ce qu’y règnent la collaboration et la coopération et que chacun puisse y trouver une source d’épanouissement, et même, pourquoi pas, de joie, dans la mesure ou la créativité pourra y trouver l’occasion de s’exprimer.
En effet, peut-être est-il plus judicieux de parler de joie par le travail que de bonheur au travail. Le bonheur désigne un état de satisfaction qui ne fait pas simplement intervenir les conditions dans lesquelles on exerce son activité professionnelle, il suppose aussi d’autres conditions qui rendent possible un accord intérieur – dans l’idée de bon / heur, il y a l’idée d’une heureuse rencontre. En revanche, l’idée de joie est beaucoup plus relative, elle correspond chez Spinoza à l’idée d’un affect qui accompagne nécessairement toute augmentation de puissance.
C’est pourquoi lorsque je réussis quelque chose, lorsque je parviens à comprendre ce que je n’étais pas parvenu à comprendre jusque-là, lorsque je parviens à atteindre un objectif ou à réaliser un projet, lorsque je fais preuve de créativité ou d’inventivité, je ressens de la joie. Donner les moyens à l’homme au travail de ressentir de la joie, peut-être est-ce là la véritable mission de celui qu’on désigne par le terme de manager – mais peut-être faudra-t-il dans un avenir plus ou moins proche lui trouver un autre nom – et qui doit principalement être à l’écoute du désir de ceux qu’il dirige pour être en mesure de donner du sens à leur action.
Pour aller plus loin :
[1] Martha C. Nussbaum, Capabilités – Comment créer les conditions d’un monde plus juste ?, Traduit de l’anglais par Laurence Chavel, Climats, 2012, p. 10
[2] Fabienne Brugère, L’éthique du care., Que sais-je ? P.U.F., Paris, 2011, p. 40
[3] Joan Tronto, « Care démocratique et démocratie du caPre », in Qu’est-ce que le care ?, sous la direction de Pascal Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2009, p. 37.Assumer sa vulnérabilité
[4] Éric Delassus, « Coopérer pour mieux soigner », (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01552328/document)
[5] Spinoza, Traité politique, Chapitre premier, § 5, Puf, 2005, p. 91
N’hésitez pas à partager cet article
Nous remercions vivement notre spécialiste, Eric, DELASSUS,Professeur agrégé (Lycée Marguerite de Navarre de Bourges) et Docteur en philosophie , co-auteur d’un nouvel ouvrage publié en Septembre 2018 intitulé « Ce que peut un corps » aux Editions l’Harmattan, de partager son expertise en proposant des publications dans notre Rubrique Philosophie & Management, pour nos fidèles lecteurs de www.managersante.com
Biographie de l’auteur :
Professeur agrégé et docteur en philosophie (PhD), j’enseigne la philosophie auprès des classes terminales de séries générales et technologiques, j’assure également un enseignement de culture de la communication auprès d’étudiants préparant un BTS Communication.
J’ai dispensé de 1990 à 2012, dans mon ancien établissement (Lycée Jacques Cœur de Bourges), des cours d’initiation à la psychologie auprès d’une Section de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale.
J’interviens également dans la formation en éthique médicale des étudiants de L’IFSI de Bourges et de Vierzon, ainsi que lors de séances de formation auprès des médecins et personnels soignants de l’hôpital Jacques Cœur de Bourges.
Ma thèse a été publiée aux Presses Universitaires de Rennes sous le titre De l’Éthique de Spinoza à l’éthique médicale. Je participe aux travaux de recherche du laboratoire d’éthique médicale de la faculté de médecine de Tours.
Je suis membre du groupe d’aide à la décision éthique du CHR de Bourges.
Je participe également à des séminaires concernant les questions d’éthiques relatives au management et aux relations humaines dans l’entreprise et je peux intervenir dans des formations (enseignement, conférences, séminaires) sur des questions concernant le sens de notions comme le corps, la personne, autrui, le travail et la dignité humaine.
Sous la direction d’Eric Delassus et Sylvie Lopez-Jacob, il vient de co-publier un nouvel ouvrage le 25 Septembre 2018 intitulé » Ce que peut un corps », aux Editions l’Harmattan,
DECOUVREZ LE NOUVEL OUVRAGE PHILOSOPHIQUE
du Professeur Eric DELASSUS qui vient de paraître en Avril 2019
Résumé : Et si le bonheur n’était pas vraiment fait pour nous ? Si nous ne l’avions inventé que comme un idéal nécessaire et inaccessible ? Nécessaire, car il est l’horizon en fonction duquel nous nous orientons dans l’existence, mais inaccessible car, comme tout horizon, il s’éloigne d’autant qu’on s’en approche. Telle est la thèse défendue dans ce livre qui n’est en rien pessimiste. Le bonheur y est présenté comme un horizon inaccessible, mais sa poursuite est appréhendée comme la source de toutes nos joies. Parce que l’être humain est désir, il se satisfait plus de la joie que du bonheur. La joie exprime la force de la vie, tandis que le bonheur perçu comme accord avec soi a quelque chose à voir avec la mort. Cette philosophie de la joie et du bonheur est présentée tout au long d’un parcours qui, sans se vouloir exhaustif, convoque différents penseurs qui se sont interrogés sur la condition humaine et la possibilité pour l’être humain d’accéder à la vie heureuse. (lire un EXTRAIT de son ouvrage)
Et suivez l’actualité sur www.managersante.com,
Officiel du Salon Européen #SANTEXPO
Cliquez sur les étoiles et votez :
[Save the date]
pour l’édition 2019
Notre plateforme média digitale managersante.com®
est un des partenaires du










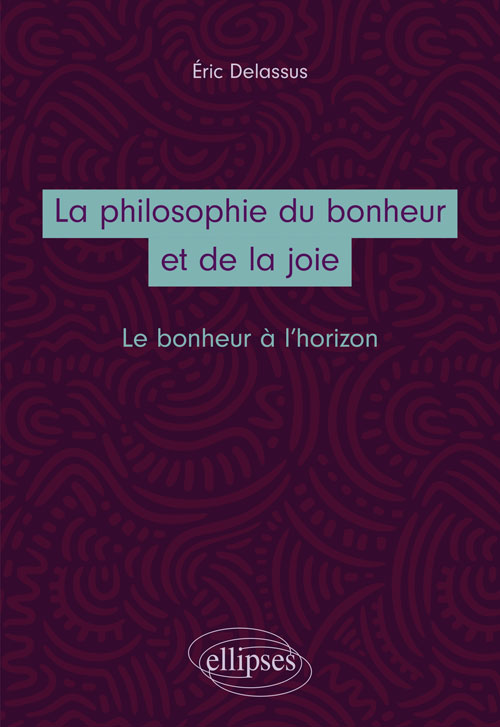






3 réponses
Je partage votre concept de causalité vu sous un angle philosophique et comprends qu’il renvoie aux interactions entre différents types de facteurs de nature différentes.
Mais mon propos concerne plus particulièrement la manière dont les managers appréhendent les problématiques au quotidien et se comportent dans la recherche de solutions. Dans la pratique, ils dialoguent avec leurs interlocuteurs en partant d’un problème et dérivent, à deux ou à plusieurs, le plus souvent pour désigner la personne ou l’entité qu’ils considèrent comme la cause de la situation négative. Ce qui revient à désigner implicitement un « coupable ». Par ailleurs, chacun se croit légitime pour établir ce qui, à son avis, s’avère la véritable cause. Plus il y a de personnes concernées par de tels échanges plus il émerge différentes causes et il apparaît une sorte de chaos relationnel. Il s’en suit des incompréhensions, des frustrations et parfois des conflits inter-individuels.
C’est de manière pragmatique en les aidant à passer d’une approche causale à une approche systémique qu’il me paraît possible de les aider à éviter ces travers.
Il est vrai que si nos réflexions se rejoignent, elles se déroulent néanmoins sur des terrains bien différents. Celui de la philosophie et celui de la pratique managériale. Quand des échanges se situent à des niveaux d’ordre différent, ll n’est pas très facile de progresser ensemble. Seule une position méta de notre part nous permet de comprendre le point de vue de l’autre. Et c’est ce que nous parvenons à faire.
Merci d’avoir bien voulu répondre à mon commentaire initial.
Vous indiquez, professeur Eric Delassus : “qu’il convient avant tout de rechercher les causes des problèmes pour parvenir à débloquer les situations difficiles”.
Je voudrais apporter un autre regard pour accéder aux situations vécues comme complexes par les managers. La complexité est un concept difficile à saisir. Les économistes, les spécialistes de la bourse, les experts en épidémiologie ou en météorologie, les sondeurs et j’en passe, utilisent des outils d’analyse et de modélisation très sophistiqués pour tenter de faire des prévisions dans ces domaines complexes. Si leurs modèles et leurs résultats étaient fiables, cela se saurait !
J’affirme, sans trop de risque d’erreur, que la complexité est impossible à saisir et à maîtriser. Elle traduit l’état d’un système dans lequel circulent de nombreux flux, diversifiés, multidirectionnels et dont les infinies combinaisons confèrent à ce système des profils différents dans le temps.
Dans les systèmes à composantes humaines comme une entreprise, une entité, une équipe, des relations patient/soignant, plus la marge d’initiative de chacun est importante, moins les comportements sont prévisibles. Ainsi, sont mis en jeu un tel nombre de variables qu’elle dépasse nos capacités d’analyse et a fortiori de prévision comportementale.
La complexité ne réside pas uniquement dans les caractéristiques des personnes ou des groupes, elle existe également dans le regard porté par les managers sur leurs situations managériales. Pour les gérer, ils ont besoin de trouver une autre façon de penser et d’agir en rupture totale avec leurs cadres habituels de pensée. C’est ce que je suggère en m’appuyant sur une logique systémique.
Dans la logique “psycho-analytique, agir consiste d’abord à fouiller le passé pour rechercher les causes et trouver des explications au problème, à examiner l’histoire du système pour le comprendre, à se positionner ensuite comme si la résolution du problème était l’objectif à atteindre. Dans cette logique, le but est bien l’identification des causes ou du coupable, considérée comme nécessaire à la résolution du problème. En fait, elle entraîne bien souvent les protagonistes à basculer dans la complexité tout en générant de nombreuses tensions entre les personnes concernées.
A l’inverse, la logique systémique, se focalise sur l’objectif à atteindre au-delà du problème. On évite de s’appesantir sur ses causes pour privilégier une dynamique orientée vers l’avenir en identifiant ce que le système obtiendrait si la situation était résolue. Ainsi, elle postule que la recherche d’explications d’un dysfonctionnement entre des personnes ou des entités n’est pas nécessaire pour le résoudre. Les actions du présent se définiront à partir du futur souhaité.
Une observation pendant de longues années des comportements de managers pour résoudre des situations problématiques entre deux ou plusieurs personnes m’ont conforté dans le fait que la recherche de causes d’une situation pour la résoudre généraient trop souvent des effets négatifs, alors que la logique systémique entraînant les acteurs dans une dynamique positive et non culpabilisante, générait des relations plus sereines, tout en facilitant l’atteinte des améliorations souhaitées de manière rapide et efficace.
Bonjour et merci pour ce commentaire. Il me semble que votre manière d’aborder les problèmes n’entre pas vraiment en contradiction avec le point de vue que je défends dans cet article dans la mesure où – et peut-être aurais-je dû le le préciser plus explicitement – la conception de la causalité à laquelle je fais référence n’est pas nécessairement mécanique et linéaire, mais renvoie plutôt aux interactions entre différents types de facteurs de natures différentes. Certes, il n’es pas possible d’identifier toutes les causes de manière analytique et ce n’est pas exactement ce que je préconise en m’inspirant, entre autres, de la pensée de Spinoza. Je suis d’ailleurs un peu gêné lorsque vous utilisez le terme de « coupable », car justement mon approche ne consiste pas à désigner des responsabilités individuelles, mais plutôt à tenter de saisir la logique réticulaire d’où émerge une situation qui peut présenter un caractère problématique. Les « causes » qui interagissent ne sont pas seulement antécédentes et peuvent aussi présenter une dimension immanente du fait de la dynamique générée par les actions en retour qui produisent un certain nombre d’effets qui peuvent aussi présenter une dimension causale. Dans une telle appréhension des choses, il n’y a pas d’un côté les causes et les effets, mais un même phénomène est toujours à la fois cause et effet et son action ainsi que les modifications qu’il subit peuvent se percevoir selon une multiplicité de formes. Quoiqu’il en soit, lorsque je parle de cause, il ne s’agit en aucune manière de les limiter aux seules intentions individuelles qui ne sont le plus souvent que des épiphénomènes.